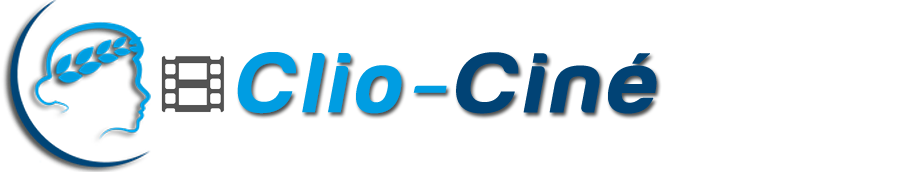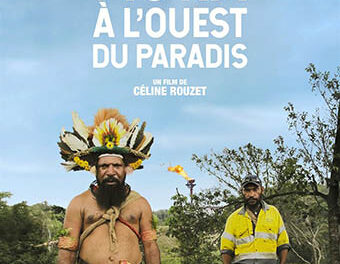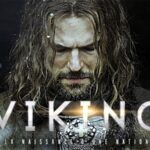Cette série en cinq épisodes s’intéresse aux grands vents qui animent la planète. Comme évoqué dans chaque introduction, chaque vent offre un souffle pouvant être bienfaiteur ou dévastateur et modèle les paysages.
Les contenus proposés permettent d’interroger, qui plus est dans notre contexte de changement climatique, la façon dont les hommes s’accommodent du passage de ces vents. Une étude comparative peut s’avérer tout à fait riche et opportune.
Quatre des cinq épisodes sont décrits ici, j’ai raté celui sur le chinook des Rocheuses. À noter que la série n’est plus accessible sur le site de Arte.
Grands vents : Sirocco, le vent mauvais
C’est le vent violent par excellence, celui qui génère les tempêtes de sable.
Il est gênant pour l’élevage de bétail qui doit être abrité. Les chameliers aussi. Mais les dromadaires ont deux rangées de cils et savent fermer leurs narines.
Les maisons sont creusées à travers la falaise, les ksars. La température monte jusqu’à 50 degrés mais les maisons restent fraiches.
Le vent nait au Sahara. Une masse d’air chaud produite par le sable surplombe le désert. Si une zone de basse pression méditerranéenne se forme à proximité, elle aspire cette masse d’air chaud vers le nord, le vent ainsi formé est sec et chaud, le coup de sirocco. Il peut atteindre 100 km/h par rafales. Du sable très fin est soulevé et se retrouve jusque dans les maisons. Une barrière végétale censé bloquer le sable a vu celui-ci s’y agglomérer jusqu’à former une dune qui perturbe l’accessibilité des habitants. Les serpents s’y engouffrent.
La végétation est atteinte aussi. Les oliviers voient leurs racines mises à nue avec la violence du souffle. On parle d’érosion éolienne, la couche superficielle est balayée alors que celle-ci est la plus nutritive pour l’arbre.
La simulation en laboratoire montre la circulation précise des grains de sable : les plus fins, les poussières de sable restent en suspension sur plusieurs jours.
Le vent propage les incendies par la sécheresse et décuple leur intensité. Il y a une corrélation nette entre la puissance du Sirocco et les dégâts observés.
Malgré tout, les poussières atténuent le réchauffement climatique.
Le sirocco peut amener une perturbation du système aérien mais maintenant on a des modèles de prévention de la circulation de ces nuages.
A Palerme, l’architecture s’est adaptée avec, sur une bâtisse, une « chambre de Sirocco » construite au XVIème siècle : une sorte de conduit percé par endroits pour aspirer et contenir l’air. La température y était également plus fraiche.
A Venise, les compositeurs ont été inspiré par les vents : Vivaldi qui rend hommage au sirocco dans « Les quatre saisons ».
Le vent amplifie aussi les marées et les inondations peuvent survenir. Malgré tout, les poussières enrichissent les eaux.
Encore plus au Nord, dans les Alpes, il recouvre la neige et la perturbe : le 6 février 2021 fut une attaque mémorable. La neige assombrie absorbe l’énergie solaire et donc va fondre plus vite.
Grands vents : Mousson, le souffle providentiel
En Inde, ce vent saisonnier humide souffle du Sud au Nord. Il apporte ¾ de la ressource en eaux pour les cultures dans ces espaces.
Le tonnerre et les grenouilles qui coassent sont des signes annonciateurs au printemps.
Au printemps, l’air au sol s’échauffe tandis que l’air frais de l’Océan Indien descend et c’est la différence de pression entre les deux qui génère le déplacement d’une grande masse d’air de l’Océan vers la Terre. Le vent est attiré par le continent et va traverser l’Inde durant l’été. Sa durée et son intensité varient.
Vasco de Gama a embarqué un pilote arabe au Kenya qui l’a guidé, en fin connaisseur de ce vent, pour arriver en Inde.
Le vent porte des libellules qui effectuent une migration à l’échelle de plusieurs générations.
Les Ghats occidentaux voient la mousson se transformer, l’humidité se déverse sur les versants exposés. Une forte biodiversité en est née : la forêt tropicale indienne. La moitié des arbres y sont endémiques, certains arbres se dressent à 45 m de haut !
Ensuite, délesté de son trop plein d’eau, le vent repart plus sec et plus vif dans les terres via le secteur de Palakkad, il accélère.
Ainsi les hommes ont pu s’en servir pour développer l’énergie éolienne. Certains villages ont même pu se développer grâce à lui et devenir autosuffisants : l’argent économisé peut construire les infrastructures et augmenter les ressources.
Le cerf-volant est prisé côté loisirs. Les festivals dédiés existent et sont des transmetteurs de cette tradition.
Le vent est aussi célébré comme une divinité sous un axe religieux, les croyant souhaitent le mariage heureux et la fertilité.
Des BD et comics locaux vénèrent des super héros porteurs de la mousson.
Vers le golfe du Bengale, il y a rencontre avec les cyclones. D’avril à décembre, il y a forte probabilité de risques meurtriers. Mais la mousson arrive à briser les cyclones.
Ensuite, le vent devient l’allié des pêcheurs, la mousson devient pacificatrice. Elle fait pénétrer l’eau douce dans l’eau de mer et donc l’enrichit en nutriments, ce qui attire les poissons.
La mousson refait ensuite le plein d’humidité et file vers les frontières de l’Himalaya : en remontant, le vent reprépare des pluies. Les dictons populaires évoluent et témoignent du changement climatique : la forte imprévisibilité et les excès. Inondations et glissements de terrain nuisent aux populations.
Le Brahmapoutre peut aussi déborder de son lit et exposer les animaux des réserves voisines à des crues très dangereuses : des rhinocéros peuvent se voir isolés et fuir vers des zones moins proches de l’eau mais hélas riches de braconniers.
Grands vents : Alizés, le souffle du voyage
De l’Europe vers l’Amérique, via l’Atlantique, soufflent les alizés.
Les navigateurs de la route du Rhum cherchent à les rejoindre pour être poussés. Trois chemins sont possibles. La route médiane est la plus courte mais n’en bénéficie pas avant la fin, la route sud rencontre tôt les Alizés mais rallonge la distance, la route Nord ne rejoint les alizés que tardivement également.
Le secret des alizés est connu au XVème siècle. Les Européens cherchent à aller en Inde et doivent passer par le terrible Cap Bojador et c’est là qu’ils découvrent ces vents puissants, jusqu’à franchir l’Atlantique.
Les alizés prennent corps entre l’anticyclones des Açores (haute pression) et le Pot-au-Noir (basse pression) et bougent avec les saisons. Leur sens varie aussi en fonction de l’hémisphère.
Aux Canaries, les genévriers se sont courbés à l’extrême avec la puissance des Alizés et ainsi évitent de casser. L’arbre Garoé, situé aussi sur le passage du vent, permet de faire ruisseler l’eau contenue dans les nuages que celui-ci pousse. Ainsi la vie a été possible dans cet espace peu accessible.
La biologie marine est également favorisée par le rôle du vent via le phénomène d’upwelling (la couche d’eau chaude limitrophe du rivage est poussée vers le large laissant sa place à une couche d’eau froide venant du fond et riche en nutriments, développant en cela une grande variété d’espèces).
Des puffins centrés juvéniles sont visibles au Cap Vert et devront migrer vers l’Afrique pour rejoindre leurs parents. Ils se servent de l’orientation des alizés des deux hémisphères pour s’y rendre et retourner aux Canaries en décrivant un parcours en forme de « huit » de 12000 kilomètres.
Toujours aux Canaris, dans les montagnes escarpées, les habitants ont développé une langue traditionnelle sifflée qui peut porter via le vent justement.
Les alizés transportent aussi les poussières du continent africain. On parle d’un alizé spécifique qui souffle sur le continent et qui se nomme l’harmattan. Durant la saison sèche (novembre à mai), le vent souffle fort en provenance du Sahel et du Sahara. Le vent peut servir à séparer la poussière des ressources (céréales) et aider les paysans dans leurs tâches. Les nutriments contenus dans la poussière sont ensuite soufflés sur le littoral et retombent dans l’Océan limitrophe favorisant, là-aussi, le développement d’espèces.
Bien au-delà, la puissance des alizés assure la pérennité de l’Amazonie : luxuriante et pourtant ayant pris corps sur un sol très pauvre. La croissance des plantes là-bas est rendue possible grâce aux poussières minérales qui s’y déposent en continu.
Vers les Antilles, les alizés, dans leur zone de rencontre, sont tumultueux. On appelle ça « les grains » qui peut nuire aux navigateurs au cours d’un puissant coup de vent isolé.
La tendance est au ralentissement des alizés avec le changement global, cela réduirait la biodiversité locale avec moins de poussières transportées. Un autre volet est d’ordre radiatif : les particules en suspension renvoient le rayonnement solaire et l’atténue…Donc moins de poussières signifiera une hausse de la température.
Grands vents : Mistral, le souffle du maître
Il prend naissance au nord de la vallée du Rhône et souffle sur plus de 300 kilomètres jusqu’à la Méditerranée.
De manière touristique, il permet le vol de planeurs.
Le vent frappe le mont Ventoux en se refroidissant. L’anticyclone atlantique rencontre la dépression venant du golfe de Gênes : le mistral nait de cette différence de température et de pression. Il souffle à 50 km/h en moyenne mais des rafales peuvent être bien plus fortes.
Les villages ont été aménagés en conséquence : des ferronneries spécifiques de clocher peuvent laisser passer le vent. Le vent emporte aussi de minuscules morceaux de pierre à travers les âges et érodent les bâtisses.
Si le ciel est rouge, le mistral soufflera le lendemain.
Les pompiers surveillent fortement le mistral. Il sèche la végétation et forme un espace fermé qui peut retenir les feux démarrés pouvant durer plusieurs jours.
Le vent fait frotter les fruits entre eux, ce qui les rend inesthétiques et impropres à la vente.
Plus au sud, vers les Alpilles, des haies de cyprès, ont été plantées pour se protéger du vent. Le vent assèche les sols après les fortes pluies, il chasse la pourriture grises des vignes des Baux, ce qui ravit les viticulteurs locaux.
Les sédiments transportés abrasent les massifs calcaires, les traces sont visibles dans les couches géologiques.
Arrivé à la Méditerranée, il souffle entre Montpellier et Toulon, débarrassé des obstacles du relief.
Dans les lagunes, le sel peut s’évaporer, aidé par le vent, des bassins aménagés par l’homme.
Le mistral fait également souffler les ailes des moulins.
A partir de la montagne Sainte-Victoire, le vent fonce vers la mer. L’amarrage des bateaux de croisière n’est pas facilité.
En longeant le littoral vers Toulon, le mistral, grâce à l’upwelling, favorise le brassage des nutriments. Mais les épisodes de chaleur sont plus fréquents qu’avant et sont néfastes pour certaines espèces comme les gorgones ou les éponges qui se détériorent et meurent.
Le mistral baisserait en intensité selon les prévisions établies jusqu’en 2050.