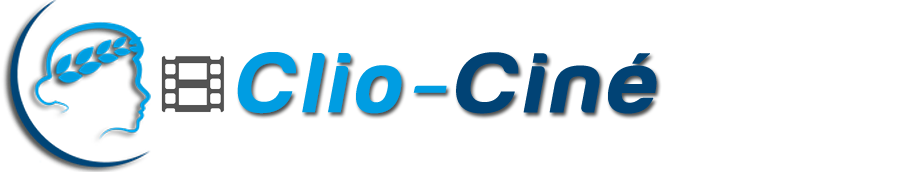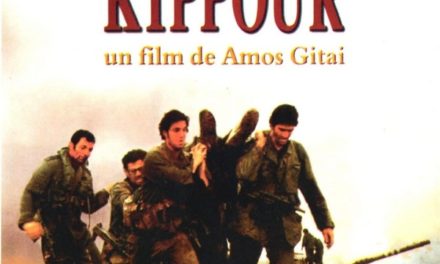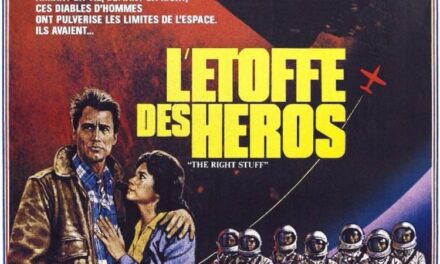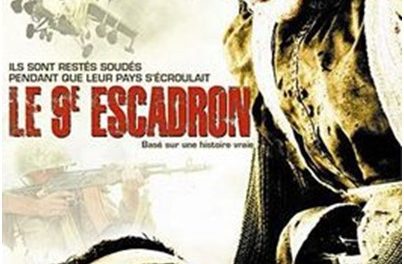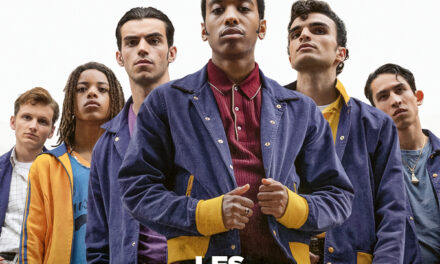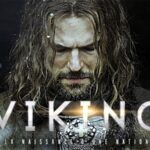Avec The Brutalist, Brady Corbet livre un film à l’architecture complexe, ambitieuse et périlleuse, à la fois dans sa forme et dans son ambition. Sur 3h35, il déploie une fresque en bas relief où l’architecture devient le prisme d’un récit plus large sur l’exil, la mémoire, l’identité et l’amour. Je pourrai enfoncer la porte ouverte d’un film en béton brut, à la fois rugueux, froid, mais porteur d’une promesse de durabilité et d’élévation. Mais si le clin d’œil au brutalisme, ce style architectural au cœur du film, est ici évident, sortir de la salle avec des réponses définitives à nos questions est une gageure.
The brutalist, une narration éclatée au service du trauma
Le film suit László Toth, un architecte juif hongrois, rescapé des camps, qui tente de se reconstruire aux États-Unis. Bardy Corbet inscrit son personnage dans une fresque historique, où la promesse du rêve américain se heurte à l’implacable réalité du capitalisme, dans une Amérique toute puissante au sortir de la seconde guerre mondiale.
Comme l’ont relevé plusieurs critiques, le récit joue sur une narration fragmentée, marquée par des ellipses violentes et un montage immersif. Ce choix formel, loin d’être un simple artifice, sert une mémoire traumatique d’un personnage joué par un grand Adrian Brody. L’oscar ne sera pas loin. Le passé ne disparaît jamais complètement. Il s’immisce dans le présent à travers des détails, des silences, des absences et des questions sans réponses. Cette construction, ces moments où l’on est absorbé et où les questions fusent dans notre esprit, campé au fond du fauteuil, son de purs moments de plaisir cinématographiques.
L’un des aspects les plus marquants du film réside assurément dans sa structure sonore et visuelle. Corbet joue sur des éléments déstabilisants : bruits parasites, dialogues volontairement décalés par rapport à l’image, superposition de voix off et d’actualités radiophoniques. L’on suit la Grande histoire à travers celle d’un homme qui essaie de survivre. La création d’Israël, la mise en place de la Guerre froide, le débat entre Kennedy et Nixon sont autant de jalons perceptibles au milieu du chaos d’un artiste tourmenté. Cette approche permet de soutenir une sensation de décalage permanent, illustrant la difficulté du protagoniste à s’intégrer dans un monde qui refuse d’accueillir pleinement son histoire. Et ça, disons le tout net, c’est très réussi. Et puis il y a cette bibliothèque, fascinante.
L’architecture comme métaphore de la reconstruction
László est un architecte génial, broyé par la folie nazie, incapable de reconnaître un talent car dévorée par ses logiques destructrices totales. À travers lui, le film interroge la brutalité du monde d’après guerre, sur l’aridité radicale du modernisme architectural. Il pose la question de la place d’un créateur dans une société qui privilégie la rentabilité à la quête de sens. En cela, The Brutalist dialogue avec d’autres œuvres marquantes du cinéma américain, notamment l’immense There Will Be Blood qui est sur ma liste 2025 de films à revoir, ou encore The Master du même Paul Thomas Anderson.
Joué avec une intensité glaçante par Guy Pearce, le personnage de Harrison, mécène manipulateur et incarnation d’un capitalisme dévorant, sublime le film, surtout dans sa seconde partie. Comment un étranger pourrait-il espérer s’intégrer réellement, même s’il est plaisant de l’exhiber devant ses amis, ses pairs, pour apparaître l’intellectuel qu’il n’est pas vraiment ?
L’artiste total et le mécène absolu
Les scènes où l’on voit la construction de l’édifice central du film sont particulièrement réussies. De la boue aux fondations, des maquettes aux immenses piliers de béton s’élevant vers le ciel, Brady Corbet parvient à faire de l’architecture un objet cinématographique à part entière. Ces séquences, soutenues par une musique enveloppante, illustrent un travail réellement captivant. On part ainsi, les sens en éveil, avec le cinéaste au fond de cette Pennsylvanie, berceau d’une Amérique vorace, dans un voyage de trois heures qu’un – étrange – entracte vient scinder en deux moments. Et c’est là quelles choses se compliquent.
La lumière s’offre lorsqu’on lève les yeux
Un moment de cinéma enthousiasmant, mais aussi bien imparfait
Si The Brutalist est une œuvre de haute volée, elle n’est pas sans défauts. Difficile de ne pas voir dans The Brutalist une fresque ambitieuse sur l’arrachement, l’exil et la reconstruction personnelle. Mais à trop vouloir marteler son message, le film se perd parfois dans les dédales de son projet.
La première partie installe efficacement une tragédie intime et politique, où le déracinement de László, ce juif hongrois rescapé de la Shoah, s’écrit dans les vapeurs de l’alcool, de l’héroïne, des fumées de la ville et le béton. On suit avec fascination son ascension contrariée, enserrée dans une sorte de lutte de classes implacable où un cousin se voulant plus américains que ses clients, peut s’avérer être une béquille bien fragile. La soupe populaire, le sort des Noirs, des étrangers, la vie dans les bars poisseux, les lettres vers l’autre côté du rideau de Fer jusque-là, tout va bien. Puis arrive la deuxième partie, après l’entracte donc, où la subtilité s’efface assez vite sous les coups de boutoir d’une démonstration trop appuyée.
Que manque-t-il ? Sans doute un peu de finesse et d’ambiguïté. La subtilité n’est pas de mise : l’Amérique blanche, protestante et capitaliste n’est qu’un bloc de béton froid hostile, et László n’y est qu’un pantin broyé. Le saut temporel imposé par la narration peine à convaincre car László semble incapable de croiser la moindre belle âme dans son travail. Sa femme, Erzsébet Toth, jouée par une surprenante (c’est un compliment) Felicity Jones, le porte à bout de bras, malgré son handicap, handicap que affecte aussi sa douce Zsófia.
La femme et l’homme, l’amour absolu au cours d’une vie dévorante
Pour un peu on se croirait dans un épisode de Rémi sans famille ou dans du Zola martelé sans fioriture, avec une famille qui ne peut avoir de chance, qui ne peut connaître le bonheur. Le mirage lointain de la guerre, des camps, est assurément la clé de lecture voulue. Mais on aurait aimé, tout de même, un peu plus de nuances pour cette famille rongée par les souvenirs inscrits dans leur chair et dans leur âme. Cette seconde partie est bien poisseuse. Certaines scènes sont de trop. De la même façon retrouver Zsófia pour son grand départ vers une nouvelle vie, avide d’argumenter soudainement, fait trop Deus Ex Machina pour convaincre pleinement.
Le film enfonce le clou avec son antagoniste, Harrison, caricature du mécène abusif. Son pouvoir et sa fascination pour László ne font aucun doute, mais la mise en scène ressasse cette domination avec une insistance pesante, allant jusqu’à une scène de trop, dont la brutalité forcée annihile toute subtilité. Le fils et la fille de Harrison auraient sans doute mérité quelques développements moins simplistes, tout comme Gordon d’ailleurs.
Et que dire du final, où la femme de László, jusque-là écrasée par la maladie retrouve, tel Roosevelt dans le Pearl Harbour de Michael Bay, une force incroyable pour se mouvoir dans un grand moment de cinéma… discutable ?
On sort donc de la séance avec un sentiment étrange, qui ne fait que croître à mesure que le temps file. Il y avait un grand film à faire, mais The Brutalist finit par être prisonnier de son propre système narratif, sacrifiant sa finesse au profit d’une démonstration assénée trop frontalement. C’est un peu comme si le réalisateur a eu peur de ne pas être compris, et s’est évertué à nous guider jusqu’au bout, au cas où.
Malgré ces légers écueils, The Brutalist reste une expérience cinématographique sortant des sentiers battus. Il fait partie de ces films qui divisent, qui exigent un investissement du spectateur, mais qui laissent une empreinte durable.
Pourquoi faut-il voir The Brutalist ?
Parce qu’il rappelle que le cinéma se vit dans une salle, qu’il peut être une expérience sensorielle et intellectuelle qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais cherche à la faire ressentir dans toute sa complexité. Parce qu’il interroge, avec une force rare, la relation entre l’art et le pouvoir, entre la mémoire et l’oubli, entre l’individu et l’Histoire. Parce que je rêve de cette bibliothèque. Et parce que, malgré ses longueurs et ses maladresses, il prouve que le cinéma vit et ne se résume pas à une énième sortie de Marvel.
En parlant de Marvel, The Brutalist a coûté 10 M de dollars, face aux 180 M de Captain America: Brave New World. Et il n’y a pas photo entre les deux films comme quoi, n’en déplaise à Harrison, tout ne se résume pas à l’argent. Mieux, parce que cette histoire est une très belle histoire d’amour, aussi, entre deux être torturés, déchirés par la guerre, à jamais réuni dans le calcaire, l’argile et le marbre. Parce qu’il vaut mieux, enfin, que La Zone d’intérêt si largement mis en avant (avec pourtant, lui aussi, de nombreux défauts) avec qui il entretient un lien qui se dévoile petit à petit, d’un camp à l’autre.
The Brutalist est un voyage qui vaut le détour.