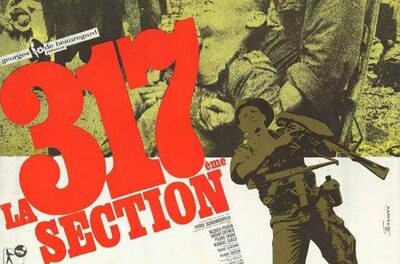« Je ne crois pas qu’il faille respecter à la lettre l’œuvre originale. C’est une simple collaboration »
Orson Welles

Anthony Perkins dans le Procès d’Orson Welles
INTRODUCTION
La version référence du film d’Orson Welles évoquée dans le travail ci-contre est celle de 1963 (114 minutes), éditée en DVD par Studio Canal classique. En effet, la version de 1984 (proposée aussi par le DVD) a amputé le film de son prologue, Devant la loi. Cependant, on ira voir la version de 1984 pour la fin du film : alors que la version de 1963 s’achève sur le plan fixe du nuage de fumée dû aux explosions de dynamite (sur lequel s’inscrivent les mentions du générique), la version de 1984 s’achève elle, sur le dernier tableau de Devant la loi. Ce bouclage du film par un retour sur le prologue renvoie au mystère de la légende qui structure le film.
Le découpage évoqué dans les fiches proposées s’appuie sur le chapitrage de l’édition DVD.
FICHE PROFESSEUR :
La transcription de l’univers de Kafka au prisme de l’Histoire contemporaine.
Problématique : Comment le contexte historique et culturel a t-il influencé le regard et la pensée d’Orson Welles dans son adaptation du roman de Kafka ?
Classes concernées : Ce travail cible essentiellement les classes de terminale littéraire ayant à l’épreuve du bac l’étude comparative du procès de Kafka et de Welles mais il peut aussi concerner les programmes d’histoire contemporaine des classes de troisième, première et terminale toutes séries confondus.
Objectifs :
– Comprendre comment une œuvre s’inscrit dans son temps
– Analyser la transcription des traumatismes du vingtième siècle dans une adaptation cinématographique
Même s’ils ne sont séparés que par une seule génération, Frantz Kafka (1883-1924) et Orson Welles (1915-1985) vivent dans des mondes radicalement différents. En effet, si le premier écrit Der Prozefs en 1914, Orson Welles quant à lui tourne The Trial en 1962 soit près de cinquante ans plus tard. Ainsi, selon l’expression de Gérald Garruti : « ce demi-siècle frénétique creuse un abîme entre deux-âge : l’âge de la calèche et l’âge du nucléaire » . Garutti Gérald, Le procès, Bréal, 2005, p.19.
Cet abîme est d’autant plus important que les démarches créatrices des auteurs semblent aussi s’opposer. En effet, pour écrire Le procès, le romancier ne s’était référé qu’à sa vision singulière. Or pour Welles, l’histoire contemporaine a transformé cette vision personnelle en vérité universelle. Ainsi, cette universalité nouvelle de Kafka est pour Welles un point de départ. Pour en tenir compte et donner toute sa portée à l’adaptation, le cinéaste opère un double mouvement :
– l’intégration de l’Histoire récente dans le film
– l’actualisation technologique
En 1962, Welles évoque très bien lors d’une conférence de presse l’intention d’inscrire son film dans un contexte historique :
« Je voulais peindre un cauchemar très actuel : un film sur la police, la bureaucratie, la puissance totalitaire de l’appareil, l’oppression de l’individu dans la société ».
Le procès de Welles est donc une transposition moderne de l’œuvre littéraire de Kafka. Si l’écrivain rédige son livre à un moment où se profile les défilés patriotiques annonçant la guerre 14-18, Welles inscrit son film dans le contexte de l’après guerre au plus fort de la guerre froide. En effet, si Welles n’a pas gommé les signes qui ancrent son long métrage dans le début des années soixante (vêtements et coiffures de Jeanne Moreau et Romy Schneider, architecture et terrain vague, certes yougoslaves, mais typiques de n’importe quel « grand ensemble » banlieusard de l’Europe de l’après guerre, apparition des premiers ordinateurs dans les grandes entreprises ; Titorelli est censé pratiquer l’« action painting », mouvement pictural américain en vogue de 1947 à 1953), il intègre essentiellement à son film « de manière ponctuelle mais certaine un demi-siècle d’histoire mondiale bureaucratique et technologique, totalitaire et capitaliste, avec une référence forte aux destructions de masse de la seconde guerre mondiale, version Auschwitz et version Hiroshima ». Ibid, p.24..
L’ancrage historique du procès de Welles dans l’univers des régimes totalitaires du XXe siècle.
L’ancrage historique du procès trouve toute sa dimension dans l’univers particulier du film qui fait référence à un univers totalitaire. En effet, au moment des procès de Moscou et de la guerre civile espagnole, Welles a vingt ans. Il est contemporain de la montée des totalitarismes en Europe Si le totalitarisme est un système imposant l’hégémonie de l’Etat sur les individus, Welles n’essaye pas de différencier les principes exclusifs reposant sur la race pour le nazisme, le peuple pour les fascisme et les classes pour le communisme. Le père de Citizen Kane cherche à peindre dans Le procès les composantes communes des régimes totalitaires : Etatisme intégral, idéologie omniprésente, parti unique, contrôle policier, appareil répressif, propagande centralisée, dirigisme économique, violence et terreur..
La référence à l’univers concentrationnaire des régimes totalitaires
Un des principaux traumatisme historique généré par le système concentrationnaire nazi dont Welles hérite est sans nul doute la mise en place d’une destruction massive et industrielle de groupes humains voire de populations entières, considérés comme « sous-hommes » (homosexuels, slaves, opposants politiques, juifs, tziganes…) qui entraîne notamment le génocide de plus de 6 millions de juifs dans les camps de la mort. Ainsi, la vision, avant l’entrée au tribunal, de vieilles personnes presque nues (d’ailleurs le peintre Titorelli porte lui aussi une tunique pyjama de déportés), immobiles, des pancartes au cou, évoque tragiquement un camp de concentration. Ce plan porte dans son silence, son irruption inopinée et son inutilité apparente à la chronologie narrative, les marques du plus profond cauchemar engendré par les régimes totalitaires. Cette citation explicite totalement absente du roman est un geste politique de la part de Welles : « Je pense que chaque fois que le public voit un camp de concentration, quel que soit le prétexte, c’est un pas en avant. Les gens refusent de savoir que ce genre de choses s’est réellement produit » Moi, Orson Welles, p.214..
Le pouvoir de suggestion de cette scène est encore accru par la présence d’une statue voilée, écrasant de sa hauteur les victimes immatriculées, qu’elle semble condamner. Indéterminée, elle peut évoquer toute organisation tyrannique montrant par là que les dérives du système nazi semblent applicables à tout régime totalitaire. En ce sens, tout en inventant une scène à des fins de témoignages historique, Welles marque sa fidélité à la démarche d’abstraction propre à Kafka, qui avait par exemple changé « parti socialiste » en « parti politique » pour gagner en indétermination (III, 77, et le passage supprimé p.298).
La mise en scène de l’appareil policier et judiciaire du procès au service de la grande organisation .
Le contexte de la guerre froide est largement perceptible dans le film de Welles à travers cette sorte de suspicion paranoïaque policière et judicaire généralisée qui évoque les pays du bloc soviétique (pays de l’Est). La persistance des dictatures fascistes en Europe (le franquisme en Espagne évoqué dans La dame de shangaï), le souvenir douloureux du maccarthysme et de sa « chasse au sorcière », présent dans La soif du mal (1958), éveillent chez Welles une méfiance vis à vis des démocraties qui tendent à développer les aspects policiers de l’organisation sociale.
L’arrestation de K. y devient typique du harcèlement intrusif pratiqué par un Etat totalitaire sur l’individu.
En témoigne aussi la scène de l’interrogatoire où est évoquée sous l’angle de la caricature la comédie de la justice (qui n’est pas sans rappeler l’affaire Rosenberg Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés le 19 juin 1953 pour avoir été reconnus coupables d’avoir livrés des secrets atomiques à l’URSS. Condamnés à mort en avril 1951 malgré des preuves fragiles, ils passeront les deux ans qui les séparent de la mort, de procédure en procédure à essayer de se défendre., manifestation la plus symbolique de l’esprit paranoïaque de la guerre froide). Dans son dispositif spatial, dans les questions insistantes et saugrenues du président et dans les réactions intempestives et à contre temps de la salle, la justice sous l’œil de Welles est présentée de façon caricaturale.
Autre signe de réorientation stéréotypée de l’appareil judiciaire : l’assemblée du tribunal est digne d’une réunion de parti unique, parfaitement soudé et dont l’insigne commun est d’emblée explicite dans le film alors qu’apparemment le public est divisé et ne révèle son insigne qu’à la fin de la scène dans le roman : « tout le monde portait de tels insignes » (III, 85-86).
Là où Kafka laissait flotter jusqu’au bout l’ambiguïté sur la nature du public, Welles oriente clairement l’interprétation vers le parti totalitaire dès l’origine.
Par ailleurs, les représentants de l’autorité judiciaire apparaissent dans les deux œuvres dans des attitudes communes : Titorelli peint tous les juges dans la même posture majestueuse et vêtus des mêmes habits d’apparats. Posture d’ailleurs qui n’est pas sans rappeler les peintures officielles des rois de France représentant la monarchie absolue. Cette écriture visuelle fait du lecteur un spectateur de film muet qui voit parler les personnages, mais ne les entend pas. Par ce procédé, une passerelle entre le roman et le film semble tendue sur le fleuve de la critique des autorités judiciaires. Ainsi, signant la ruine de l’idéal humaniste conçu à la Renaissance, la grande organisation dans les marques hypertrophiées de son agencement voit en l’homme non plus un sujet autonome mais le rouage d’une machine anonyme.
Le sacre de la bureaucratie dans les Procès : d’une approche visionnaire à une image contemporaine
La philosophe Anna Arendt évoque ainsi les conséquences de la première guerre mondiale sur l’Empire germanique vaincu : « Ce fut l’effondrement de la tradition -un effondrement qu’il fallait reconnaître comme un fait accompli, une réalité politique, un point de non-retour (…). Du point de vue politique, c’était le déclin et la chute de l’Etat nation, du point de vue social, la transformation d’un système de classes en une société de masse, et c’était spirituellement, l’avènement du nihilisme, qui avait longtemps été l’affaire de quelques uns, mais était devenu alors soudain un phénomène de masse ».
Tous ces phénomènes se conjuguent pour faire de l’organisation bureaucratique le dieu sans visage d’une ère sans valeurs. Kafka ne s’y trompe pas, qui écrit dans une lettre à Felice : « C’est au bureau qu’est le vrai enfer, je n’en crois pas d’autre ».
L’écrivain vit une époque que son contemporain le sociologue allemand Max Weber analyse dans Economie et société comme le sacre de la bureaucratie.
Dans ce système de pouvoir impersonnel devenu une fin en soi, la perte des valeurs au profit des seules procédures accentue le désenchantement du monde. Cette nouvelle religion a pour prêtre le fonctionnaire.
Partout chez Kafka, K. se heurte à la loi et se retrouve broyé dans son étau. « Je ne connais pas cette loi », dira K. ( I,34 ) : véritable devise de l’ère bureaucratique, où nul n’est censé ignorer la loi sans pourtant pouvoir y accéder, comme dans la légende « Devant la loi » (IX, 256-257). A l’âge bureaucratique, l’individu se retrouve ainsi pris entre le devoir de connaître la loi, l’impossibilité de la comprendre et l’interdiction de l’interroger. A lui de justifier son bon droit, sa légitimité et, finalement, son existence.
La grande organisation du Procès de Welles comme en écho à la société de consommation contemporaine (accroissement de la division du travail, essor de la société de consommation, standardisation et massification) semble réduire dans le film l’individu à l’homo economicus, auquel la grande organisation ne reconnaît que deux fonctions : la production et la consommation-contemplation. Au sein de cette grande organisation, fonctionnaires et formulaires sont des rouages interchangeables. La critique de Welles rejoint alors celle de Kafka : « les règlements s’entassent, les formulaires s’empilent. (…) Les bureaucrates sont en fait des maîtres chanteurs. On ne peut jamais s’en débarrasser, plus on leur en donne, plus ils en demandent. Si vous leur remplissez un formulaire, ils en exigent 10 autres » (Moi Orson Welles, p.279).
Par ailleurs, cette extension de l’organisation de masse se matérialise cinématographiquement par le gigantisme des structures visibles. Effectivement, le premier fondé de pouvoir d’une banque autrichienne impériale y devient un « manager » à l’accent américain, cadre supérieur dans une grande entreprise régie par un nouvel ordre technocratique.
En décrivant l’organisation bureaucratique comme destin et en absorbant « le négatif de son temps », Kafka a fait sortir ce temps de ses gonds pour se projeter vers l’avenir. Un demi-siècle plus tard, l’époque a fini par rattraper l’écrivain : le monde de Kafka s’est métamorphosé en monde kafkaïen.
L’actualisation technologique du procès : de l’écran à l’atome.
La grande organisation symbolisant l’univers des régimes totalitaires de l’Histoire contemporaine va de pair avec la mise en place d’un nouvel âge technologique : machine politique et machines tout court y sont indissociables. Ainsi, au cours des années 1945-1965, la troisième révolution industrielle génère l’entrée dans l’âge nucléaire et informatique. L’explosion des médias (radio, cinéma, télévision) et le passage de la suprématie de l’écrit à celle de l’image, radicalise les techniques de contrôle et de destruction massive qui sont à l’honneur dans le film de Welles.
Les marques cinématographiques de l’oppression de l’individu face à la puissance des machines de la société moderne
L’oppression de l’individu dans la société moderne des machines prend diverses formes dans l’œuvre cinématographique.
Tout d’abord, elle se manifeste dans la mise en scène symbolique de l’espace. Ainsi, l’espace professionnel étriqué du roman praguois, avec ses petites salles d’attente et antichambres (VII, 176), ses bureaux clos et contigus et sa promiscuité forcée tout contre le directeur adjoint (III, 72), prend dans Le procès de Welles les dimensions immenses de l’open space sans cloisons (2, 42-43). Dans sa mise en scène du hall aux 700 bureaux de Dactylos dont le cliquetis compose avec l’adagio d’Albinoni une étrange cacophonie, Welles nous présente un monde robotisé. Dans cette perspective, le bureau Kafkaïen à l’instar des Temps modernes de Charlie Chaplin prend l’allure d’une usine à la chaîne. L’immensité et la trop parfaite géométrie du décor du hall révèle d’autant plus son immensité qu’il donne lieu à des plans à la grue virtuoses démarrant du sol et découvrant dans un bref travelling vertical le lieu rappelant Métropolis de Fritz Lang.
Les machines étouffent, l’homme est ensuite happé par les rouages de la modernisation et devient un numéro parmi tant d’autre (thème repris au cinéma dans Brazil de Terry Williams). Mettre en scène un ordinateur est une façon de situer Kafka dans le monde contemporain, mais aussi de montrer l’inutilité de la modernité scientifique devant les problèmes de la conscience humaine
La société des écrans et la manipulation par l’image
La société des écrans et la manipulation par l’image sont représentées dans le film lors de la leçon que l’avocat inflige à K. au cours d’une projection cinématographique à l’aide d’un appareil qui participe de la grande machine.
Par cet ajout, Welles cherche à intégrer le monde du spectacle au cœur de l’action. Ainsi, cette séquence est une scène de cinéma dans le cinéma qui contient une mise en abyme du dispositif cinématographique. Les personnages se trouvent placés à l’intersection de la réalité et de l’illusion selon le mythe de la caverne de Platon. Welles semble ici dénoncer le pouvoir de manipulation des images.
Si la caméra semble épouser le point de vue subjectif de K., elle adopte aussi celui d’une conscience lucide et réflexive qui tient sur la création métadiscursif dépassant le point de vue interne du personnage. Cette voix n’est plus celle du personnage qui rêve, mais celle d’un être omniscient, extérieur à la fiction, qui a la maîtrise du sens. Narrateur au début, le metteur en scène apparaît aussi en tant que personnage actif et autoritaire (l’avocat Hustler), un être qui se trouve partout chez lui dans la grande machine bureaucratique : « Je joue le rôle de l’avocat et j’ai réalisé ce film. Mon nom est Orson Welles » disent les dernières paroles du film.
Le conflit entre K. et l’avocat est traduit par la succession de champs et contrechamps qui fait apparaître K. petit et l’avocat gigantesque, debout sur l’estrade de son lit. L’instance de l’énonciation, qui pouvait donner le sentiment qu’elle détenait une omniscience absolue, se révèle donc mensonge et imposture.
Le cinéma de Welles vise à démasquer les impostures sociales qui cherchent à manipuler l’individu :
« Oui !… Le voilà, le complot ! le vrai complot ! Il s’agit de nous faire croire que le monde entier est dément, informe, absurde, chaotique et imbécile. C’est çà leur but… » dit K. En se dédoublant comme narrateur qui s’adresse au public et comme personnage qui s’adresse à K. dans la fiction, Welles met en cause le dispositif judiciaire comme le dispositif cinématographique. Aucune vérité définitive ne vient clore le film, qui s’achève par une interrogation sur la société et le cinéma comme art de la manipulation mêlant vérité et mensonge.
Dans cette même perspective, servie par une technicienne (« vaguement inquiétante, immuable, cette vénérable dame de science est du type classique de prêtresse servant un millénaire et puissant mystère », disait le scénario de Welles), la machine (au pied de laquelle la femme posait un bol de lait comme pour lui donner à manger !) ne pouvait donner qu’une carte à trous en réponse à K. qui l’avait questionné sur le crime qu’il aurait commis. Interrogée sur le sens de ce code, la technicienne répondait : « le suicide ».
Cette séquence renforçait indéniablement la critique de Welles envers la robotique avilissante : « comme vous le savez, mon propos est toujours dirigé contre la machine et en faveur de la liberté » (interview à la BBC, 1962).
Comme en écho, 5 ans plus tard cette scène pourrait inscrire alors davantage le film dans le genre de la science fiction (on pense notamment à l’ordinateur Hal 9000, personnage clé de 2001, a Space Odyssey de Stanley Kubrick, 1968).
L’âge du nucléaire en images
L’âge du nucléaire est évoqué lors de la mort de K. par le nuage de l’explosion finale. En effet, l’exécution de K. ne se fera pas au couteau comme dans le roman, même si elle en prend le chemin ; l’indécision des bourreaux chez Kafka donnera lieu au même jeu de politesse macabre chez Welles mais la solution finale passera par un bâton de dynamite.
Si la référence à la bombe atomique semble trouver pour certains exégètes une dimension particulière dans cette scène finale, il est souhaitable de ne pas perdre de vue que la même année sort en salle sur le thème de la bombe atomique Doctor Strangelove or how I learned to stop and worrying and love the bomb (Docteur Folamour) de Stanley Kubrick. Ainsi, au moment où Welles monte Le procès, cette menace paraît au bord de se réaliser avec la « crise des fusées » à Cuba, opposant Kennedy à Khrouchtchev.
Pour d’autres, la re-contextualisation de cette scène dans les années soixante renvoi à une image de guerre et a fortiori celle des guerres d’indépendance ou de décolonisation comme celle de l’Algérie ou du Vietnam dans laquelle allaient s’enliser les Etats-Unis.
Pour Welles, la scène de l’explosion finale n’est pas censée évoquer un champignon atomique, mais « toutes les bombes, les bombes atomiques et les autres, toutes les formes d’explosion et de destruction » (Moi Orson Welles, p.293)
En même temps, en un geste paradoxal très wellesien, le cinéaste déplore cette même abstraction qu’il s’est employée à créer : « Je crois que la plus grande faiblesse du film, c’est cette tentative d’universalité. Peut-être que sur un certain plan, un film perd toujours un peu de sa force à se vouloir universel. »
Cependant, contredisant les dénégations universalistes de Welles, le directeur de la photographie Edmond Richard révèle avoir fait sauter de la dynamite pendant une semaine pour obtenir l’image souhaitée par son réalisateur. Or, sa forme suggère un champignon atomique. Elle indique que l’humanité s’est engagée dans l’ère des destructions massives à l’échelle exponentielle. S’il a permis de conclure la guerre, le bombardement nucléaire du Japon en août 1945 (200 000 morts pour deux bombes A) fait aussi entrevoir le risque d’une destruction planétaire totale.
CONCLUSION
Le contexte historique a donc pesé fortement sur la relecture du roman par Welles. En effet, Le procès est sous tendu par les grandes hantises du XXè siècle, celle de l’espace carcéral et concentrationnaire mais aussi celle de l’atomisation nucléaire (traumatisme de Hiroshima et Nagasaki), qui renvoient à la figure de l’inhumain. La fin est orientée à cause des camps de concentration et à travers le plan d’un nuage atomique révèle que l’aventure individuelle s’est muée en cataclysme universel. Si Welles modifie la fin du procès c’est par conscience de la responsabilité historique potentielle de sa représentation :
« je ne pense pas que Kafka aurait défendu cette scène après la mort de six millions de juifs. (…) C’était impossible de voir un homme que le public pourrait considérer comme un juif s’allonger et se laisser tuer de cette façon ».
L’œuvre de Welles trouve donc par comparaison à celle de Kafka une ampleur particulièrement forte qui s’inscrit dans un contexte historique et culturel précis : celui du monde contemporain.
BIBLIOGRAPHIE
– BAZIN André, Orson Welles, RAMSAY Poche Cinéma, 1986.
– DEMAY Marie-Claude et RULLIER Jean-Claude, Le procès Kafka/Welles, langage verbal et images, Ellipses, Paris,2004.
– EVRARD Franck, Le procès, Bertrand Lacoste, Paris, 2004.
– GARUTTI Gérald, Le procès, Bréal, Paris, 2005.
– ISHAGHPOUR Youssef, Orson Welles cinéaste: une caméra visible. I. Mais notre dépendance à l’image est énorme…, La différence, collection Les Essais, 2001.
– Moi Orson Welles, entretiens avec Peter Bogdaniovich, éditions Belfond, 1993.
– NAGEL Elsa, L’art du mensonge et de la vérité: Orson Welles, Le procès et Une histoire immortelle, l’Harmattan éditeur, 1997.
– ZIMMER Jacques et PARRA Danièle, Orson Welles, collection Filmo 13, Edilig, 1985.