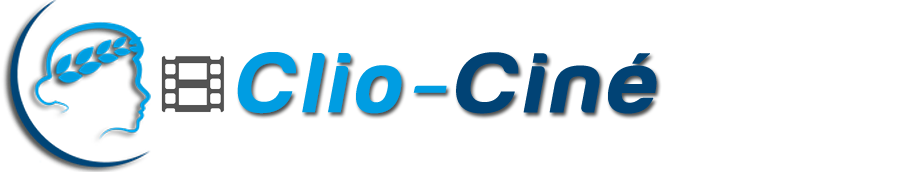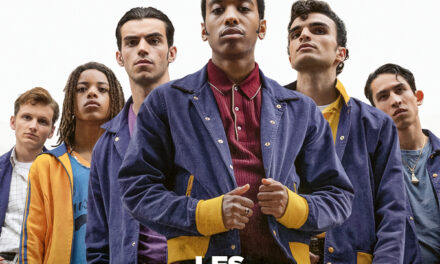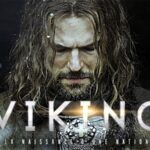The Order ou le passé comme prologue
Le 6 janvier 2021 restera gravé dans l’histoire américaine comme le jour où l’impensable s’est produit : des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis, cherchant à renverser le résultat d’une élection démocratique. Dans le chaos de cette journée, une question hante désormais les esprits : comment en est-on arrivé là ?
Trois ans plus tard, Donald Trump, qui n’a jamais reconnu sa défaite, est revenu au pouvoir en janvier 2025. Cette victoire électorale marque non pas la fin d’une crise, mais peut-être son approfondissement. Les institutions américaines, déjà fragilisées, font face à un défi existentiel : celui de la normalisation d’une violence politique autrefois considérée comme marginale, incarnée par l’assassinat de Charlie Kirk du 10 septembre dernier.
C’est dans ce contexte troublé que sort The Order de Justin Kurzel, un film qui ne raconte pas l’avenir, mais plonge dans le passé pour mieux éclairer le présent. En 1984, dans le Nord-Ouest pacifique américain, un groupuscule néonazi nommé « The Order » terrorisait la région par une série de braquages et d’attentats. Leur objectif ? Financer une insurrection armée contre le gouvernement fédéral. Leur bible ? The Turner Diaries, un roman survivaliste fasciste paru en 1978, qui décrit minutieusement le renversement du gouvernement américain, culminant avec ce qu’ils appellent le « Jour de la Corde » (Day of the Rope) – un génocide planifié. Le livre est interdit en France depuis 1999 mais il n’est pas très compliqué de le trouverArrêté du 21 octobre 1999 portant interdiction de circulation, de distribution et de mise en vente d’une publication …
Quarante ans plus tard, ce même livre était dans les sacs à dos de certains émeutiers du 6 janvier. La boucle, terrifiante, est bouclée.
Justin Kurzel l’a bien compris : en racontant l’histoire de Bob Mathews et de The Order, il ne fait pas de l’archéologie historique. Il offre une autopsie très concrète, incisive, lucide du présent, un diagnostic sans concession de la permanence du danger suprémaciste blanc aux États-Unis. Comme le dit le réalisateur lui-même, c’est l’assaut du Capitole qui l’a convaincu de faire ce film. Parce que l’histoire, loin d’être un prologue, semble être parfois un éternel recommencement.
Le contexte de création du film : Justin Kurzel, chroniqueur de la violence masculine
Justin Kurzel est un réalisateur australien qui s’est imposé comme l’un des cinéastes contemporains les plus pertinents pour explorer la violence, la masculinité toxique et les sociétés brisées. Depuis son premier long métrage, Les Crimes de Snowtown (2011), Kurzel construit une filmographie obsédée par les hommes qui tuent, les environnements qui les façonnent, et les systèmes qui permettent – ou encouragent – leur brutalité.
Une filmographie sombre et envoûtante
Snowtown, adaptation d’un des pires faits divers australiens, racontait l’histoire du tueur en série John Bunting à travers le regard d’un adolescent abusé, manipulé puis complice. Le film glacial établissait déjà la marque de fabrique de Kurzel : une violence non spectaculaire mais d’autant plus insoutenable, une empathie pour les victimes sans jamais excuser les bourreaux, et une volonté de comprendre comment on en arrive à tuer. L’expérience est totale, envoutante et dérangeante à la fois.
Avec Macbeth (2015), adaptation viscérale de la tragédie shakespearienne avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, Kurzel transformait le classique en méditation sur la guerre, le deuil et la folie meurtrière.
Son Assassin’s Creed (2016), malgré ses défauts le rendant plus dispensable, explorait encore la violence comme héritage transgénérationnel.
Nettement meilleur, True History of the Kelly Gang (2019) revisitait le mythe du hors-la-loi australien Ned Kelly en déconstruisant la masculinité coloniale et ses fantasmes de violence rédemptrice.
Une obsession : comprendre sans justifier
Ce qui frappe dans le cinéma de Kurzel, c’est sa capacité à rester dans l’inconfort. Il ne donne jamais de réponses faciles, ne transforme jamais ses monstres en archétypes unidimensionnels. Ce n’est pas manichéen, c’est subtil bref, en totale opposition avec les évolutions de nombreux discours politiques actuels. Avec son directeur photo attitré Adam Arkapaw (son travail de photographie est éblouissant dans la saison 1 de True Detective ), son frère compositeur Jed Kurzel, et son scénariste Shaun Grant (pour Snowtown par exemple), il a développé un style reconnaissable : plans larges contemplatifs sur des paysages magnifiques et hostiles, violence soudaine et dévastatrice, silences pesants, personnages égarés dans leurs propres ténèbres.
Avec The Order, Kurzel franchit une nouvelle étape. Pour la première fois, il quitte l’Australie pour raconter une histoire américaine. Mais l’ADN reste le même : comprendre comment des hommes ordinaires deviennent des terroristes, comment une idéologie se cristallise en violence, comment des institutions démocratiques peinent à contenir la marée montante de la haine.
Le scénario est signé Zach Baylin, qui s’était fait connaître avec King Richard (2021), nommé aux Oscars. Son écriture épurée, presque documentaire, sert parfaitement la vision de Kurzel : laisser les faits parler, laisser le spectateur construire sa propre compréhension.
Le cinéma hollywoodien face au terrorisme domestique blanc : un tabou longtemps persistant
Si Hollywood a largement exploré le terrorisme international – particulièrement après le 11 septembre 2001 – le terrorisme domestique blanc est resté longtemps un angle mort du cinéma américain. Pourquoi cette réticence ?
L’inconfort du miroir
Raconter le terrorisme islamiste permet une forme d’extériorisation : l’ennemi vient d’ailleurs, il incarne l’altérité radicale. C’est simple et mobilisateur. Filmer des néonazis américains, c’est pointer du doigt une maladie interne à la société américaine. C’est reconnaître que la violence ne vient pas seulement de l’extérieur, mais qu’elle est consubstantielle à l’histoire et à la culture américaines : l’esclavage, le génocide des peuples autochtones, le Ku Klux Klan, la ségrégation… Comme American History X l’a illustré auparavant, c’est nettement plus complexe à assumer. Justement avant de plonger dans ce film, sondons quelques uns de ces prédécesseurs. Quelques films ont en effet osé aborder ces questions frontalement :
- Mississippi Burning (Alan Parker, 1988) racontait l’enquête du FBI sur le meurtre de trois militants des droits civiques par le KKK en 1964. Le film, malgré ses qualités, restait dans une perspective rassurante : le FBI comme sauveur, le racisme comme aberration du passé.
- American History X (Tony Kaye, 1998) avec le sublime Edward Norton reste une référence pour son portrait nuancé d’un néonazi qui tente de sortir du mouvement. Le film montrait la mécanique du recrutement, l’attrait communautaire du suprémacisme blanc pour des jeunes perdus. Mais sa fin ambiguë laissait le spectateur désemparé : peut-on vraiment sortir de la haine ?
- Imperium (Daniel Ragussis, 2016) avec Daniel Radcliffe montrait un agent du FBI infiltrant des groupes suprémacistes blancs. Efficace mais limité dans sa portée.
- BlacKkKlansman (Spike Lee, 2018), basé sur une histoire vraie des années 1970, utilisait l’ironie et la satire pour dénoncer la persistance du Klan. Sa conclusion montrait les images réelles de Charlottesville (2017), établissant le lien direct entre passé et présent.
The Order : une approche différente
The Order se distingue par son refus de la catharsis. Contrairement à American History X ou BlacKkKlansman, le film de Kurzel ne propose aucune rédemption, aucune victoire morale définitive. Bob Mathews meurt, certes, mais son héritage perdure. Les membres de The Order sont jugés, mais leurs idées se propagent. Le FBI gagne une bataille, mais la guerre continue et l’on peut se demander si elle n’est pas en train de basculer vers une victoire des des thèses de Mathews.
C’est cette lucidité qui rend le film si perturbant et nécessaire. Kurzel ne filme pas un accident de l’histoire, mais un symptôme récurrent, une fièvre chronique de la démocratie américaine. Et c’est ici que réside son principal inérêt.
Analyse du film : Une œuvre maîtrisée entre thriller et tragédie
Synopsis et structure narrative
Années 1980, Idaho. Terry Husk (Jude Law), agent vétéran du FBI, est muté dans une région reculée après des années épuisantes à traquer la mafia à New York. Il espère y trouver la paix. Mais une série de braquages audacieux – banques, camions blindés – attire son attention. Avec l’aide de Jamie Bowen (Tye Sheridan), jeune officier de police local, et de Joanne Carney (Jurnee Smollett), collègue du FBI, Husk comprend rapidement que ces crimes ne sont pas l’œuvre de gangsters ordinaires.
Ils sont l’action d’un groupe suprémaciste blanc mené par Bob Mathews (Nicholas Hoult), ancien mormon devenu révolutionnaire néonazi. Mathews et ses hommes ne volent pas pour l’argent : ils financent une insurrection. Inspirés par The Turner Diaries, ils veulent créer une « patrie blanche » dans le Nord-Ouest pacifique et précipiter l’effondrement du gouvernement fédéral, qu’ils appellent le « ZOG » (Zionist Occupation Government – gouvernement d’occupation sioniste).
Le film suit en parallèle Husk qui se rapproche inexorablement de Mathews, et Mathews qui radicalise son groupe, recrute, planifie. Kurzel construit un thriller méthodique, patient, qui culmine dans une confrontation finale sur l’île de Whidbey – siège réel et historique où Bob Mathews trouva la mort le 8 décembre 1984.
Une mise en scène sobre et obsédante
Kurzel fait le choix d’une sobriété formelle remarquable. Pas d’effets tape-à-l’œil, pas de ralentis glorifiants, pas de héroïsation de la violence. Adam Arkapaw, son directeur photo, baigne le film dans des tons hivernaux – gris, blancs, bruns – qui évoquent à la fois la beauté austère du Nord-Ouest américain et la froideur morale de ses protagonistes.
Les scènes d’action (le braquage du camion blindé en plein jour, le raid nocturne dans une ferme) sont filmées avec une tension maximale mais sans artifices inutiles. La violence surgit brutalement, salement, sans musique emphatique pour nous dire comment la ressentir. C’est la tradition du thriller des années 1970 ou encore de Heat de Michael Mann qui demeure une référence évidente, renouvelée par une approche quasi-documentaire.
Performances magnétiques
Jude Law livre peut-être sa meilleure performance depuis des années. Quel plaisir. Méconnaissable sous sa moustache fatiguée et sa bedaine de quinquagénaire épuisé, il incarne un flic intuitif mais brisé. Divorcé, séparé de ses filles, Husk est un homme qui n’a plus que son travail. Law joue en retenue : silences lourds, regards éteints, colères soudaines. C’est un homme qui sait reconnaître le mal parce qu’il l’a trop longtemps côtoyé.
Face à lui, Nicholas Hoult est absolument glaçant. Physiquement, il ressemble étrangement au vrai Bob Mathews : blond, mâchoire carrée, regard clair. Mais c’est son jeu qui impressionne. Hoult refuse la caricature du fanatique écumant. Son Mathews est calme, articulé, charismatique, déterminé, implacable. Il parle doucement à ses hommes, joue avec ses enfants, cite la Bible. C’est précisément cette normalité apparente qui terrifie. Hoult montre comment le mal peut porter un visage aimable, comment la haine peut se draper dans le langage de la fraternité et de la loyauté.
Tye Sheridan, en jeune flic local un peu naïf, apporte une innocence nécessaire au propos. Là encore rien de trop, simplement la justesse d’une interprétation servant le propos global. Son personnage représente l’Amérique qui refuse de voir le danger, qui veut croire que ces incidents sont isolés. Sa prise de conscience progressive structure le regard du spectateur. En fait nous sommes avec lui, dans les pas de Husk.
Jurnee Smollett, seule femme noire dans un monde d’hommes blancs (flics ou terroristes), incarne la marginalisation systémique. Son personnage aurait pu être purement symbolique ; elle lui donne une profondeur, une intelligence stratégique qui force le respect de Husk.
Une partition minimaliste et angoissante
La musique de Jed Kurzel est remarquable de retenue. La partition ne cherche jamais à nous dire quoi ressentir ; elle crée une tension de fond, un malaise constant. Certaines scènes se déroulent même en silence total, avec seulement les bruits ambiants – le vent, les voitures, les respirations.
Ce choix musical rappelle le travail de Jóhann Jóhannsson pour Sicario (Denis Villeneuve, 2015) : la musique comme présence spectrale, comme rappel constant du danger latent.
Attention, ce n’est pas un chef d’oeuvre absolu et il est certain que l’on pourra regretter une construction gloable finalement classique, dans le sens où nous ne sommes pas surpris par le déroulé. Peut-être est-ce trop pédagogique finalement.
Le contexte historique réel : The Order, une histoire terrifiante
Pour comprendre la portée du film, il est indispensable de revenir aux faits historiques, méticuleusement documentés dans le livre The Silent Brotherhood (1989) de Kevin Flynn et Gary Gerhardt, sur lequel est basé le scénario.
Bob Mathews : l’itinéraire d’un terroriste américain
Robert Jay Mathews naît le 16 janvier 1953 à Marfa, Texas, dans une famille méthodiste conservatrice. À 11 ans, il rejoint la John Birch Society, organisation anticommuniste d’extrême droite. Adolescent mormon, il développe une idéologie survivaliste et crée à 18 ans les « Sons of Liberty » (Fils de la Liberté), milice anti-gouvernementale.
Dans les années 1970, Mathews s’installe dans l’État de Washington et fréquente l’Aryan Nations (Nations Aryennes), organisation suprémaciste dirigée par le pasteur Richard Butler. Mais Mathews considère Butler trop prudent, trop légaliste. Il veut l’action immédiate, la révolution armée.
En septembre 1983, Mathews fonde The Order (aussi appelé The Silent Brotherhood – La Fraternité Silencieuse) avec huit complices. Le nom vient directement du roman The Turner Diaries de William Luther Pierce (pseudonyme : Andrew Macdonald), publié en 1978.
The Turner Diaries : le manuel du terroriste
Ce livre mérite qu’on s’y attarde, car il est la clé pour comprendre The Order, Oklahoma City (1995), et même le 6 janvier 2021. Et oui, clairement il y a des fans de Donald Trump qui ont lu ce livre.
The Turner Diaries raconte l’histoire d’Earl Turner, membre d’une organisation clandestine appelée… The Order. Le roman décrit minutieusement :
- Des braquages pour financer l’insurrection
- Des attentats à la bombe contre des bâtiments fédéraux
- L’assassinat de « traîtres » (journalistes, politiciens)
- Le « Jour de la Corde » (Day of the Rope) où les « traîtres raciaux » sont pendus
- Une guerre civile raciale qui aboutit au génocide des non-Blancs
- L’attaque nucléaire du Pentagone
Le FBI a qualifié ce livre de « bible de la droite raciste ». Il a été retrouvé en possession de :
- Timothy McVeigh, auteur de l’attentat d’Oklahoma City (1995, 168 morts)
- Membres de The Order dans les années 1980
- Plusieurs émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021Voir How ‘The Turner Diaries’ Incites White Supremacists
The Order : chronologie des crimes (1983-1984)
Automne 1983 : Formation du groupe. Cérémonie d’initiation dans la propriété de Mathews, serment de loyauté « jusqu’à la mort ».
Décembre 1983 : Premiers braquages de banques dans la région de Seattle. Butin : environ 26 000 $.
Avril 1984 : Braquage d’un camion blindé Continental Armored Transport. Butin : 500 000 $. L’argent est distribué à des fermiers blancs endettés, à l’Aryan Nations, et à d’autres groupes suprémacistes.
Juin 1984 : Assassinat d’Alan Berg, animateur radio juif et libéral à Denver. Berg critiquait régulièrement les néonazis à l’antenne. Il est abattu devant chez lui, criblé de 13 balles. Cet événement inspire directement le film Talk Radio (Oliver Stone, 1988), film qu’il faut (re)découvrir au passage tant il reste brûlant d’actualité.
Juillet 1984 : Braquage spectaculaire d’un camion Brink’s à Ukiah, Californie. Butin : 3,6 millions de dollars, l’un des plus gros braquages de l’histoire américaine à l’époque. Une partie de l’argent est envoyée à Louis Beam, figure du Klan, et à Tom Metzger, leader de White Aryan Resistance.
Automne 1984 : Le FBI, grâce à des indicateurs et au retournement de Tom Martinez (un membre arrêté pour usage de faux billets), identifie Mathews et son réseau. Plusieurs membres sont arrêtés.
8 décembre 1984 : Bob Mathews est localisé dans une maison sur l’île de Whidbey, État de Washington. Refusant de se rendre, il engage une fusillade avec plus de 400 agents du FBI et de l’ATF. Après des heures de siège, le FBI lance des grenades incendiaires. La maison brûle. Mathews meurt dans les flammes, un pistolet-mitrailleur à la main.
Son corps est découvert près d’une baignoire, avec le symbole de The Order – un soleil celtique – incrusté dans sa poitrine (il l’avait fait tatouer).
Le procès et l’héritage
23 membres de The Order sont arrêtés et jugés. Plusieurs sont condamnés à de longues peines de prison pour racket, vol, meurtre. David Lane, l’un des principaux lieutenants, meurt en prison en 2007. Il est l’auteur des « 14 Words » (Fourteen Words), slogan devenu credo du suprémacisme blanc mondial : « We must secure the existence of our people and a future for white children » (Nous devons assurer l’existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs).
Bob Mathews devient immédiatement un martyr pour l’extrême droite. Sa mort est commémorée chaque 8 décembre. Des groupes néonazis portent son nom. Son exemple inspire des générations de terroristes blancs.
Les échos prophétiques : de The Order au Capitole
Le film de Kurzel ne serait qu’un exercice historique compétent s’il ne résonnait pas si violemment avec l’actualité. Mais l’histoire de The Order n’est pas un événement isolé : c’est un symptôme récurrent d’une pathologie américaine.
The Turner Diaries : une influence mortifère continue
1995 – Oklahoma City : Timothy McVeigh, vétéran de la guerre du Golfe radicalisé par la droite milicienne, fait exploser un camion piégé devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City. 168 morts, dont 19 enfants. C’est l’attentat terroriste le plus meurtrier sur le sol américain avant le 11 septembre. Dans la voiture de McVeigh, la police trouve des pages de The Turner Diaries. La scène du livre décrivant l’attentat à la bombe contre le FBI ressemble trait pour trait à son crime.
2017 – Charlottesville : Rassemblement néonazi « Unite the Right ». Des suprémacistes blancs défilent aux flambeaux en scandant « Jews will not replace us » (Les Juifs ne nous remplaceront pas), référence directe à la théorie conspirationniste du « Grand Remplacement ». Une contre-manifestante, Heather Heyer, est tuée par un néonazi qui fonce en voiture dans la foule. Donald Trump, alors président, déclare qu’il y avait « des gens très bien des deux côtés ».
2018 – Pittsburgh : Robert Bowers entre dans la synagogue Tree of Life et ouvre le feu pendant un office de Shabbat. 11 morts. Avant l’attaque, il avait posté sur les réseaux sociaux des messages antisémites et anti-réfugiés, reprenant la rhétorique du « Grand Remplacement ».
2019 – El Paso : Patrick Crusius entre dans un supermarché Walmart à El Paso, Texas, et tue 23 personnes, ciblant délibérément la communauté latino. Son manifeste en ligne reprend la théorie du « Grand Remplacement » et cite The Turner Diaries.
2021 – Capitole : Le 6 janvier, une foule d’environ 2000 émeutiers prend d’assaut le Capitole pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Parmi eux : des membres des Proud Boys (groupe néofasciste), des Oath Keepers (milice d’extrême droite), des QAnon, et des néonazis affichés.
Plusieurs portent des tatouages de symboles nazis. Certains ont sur eux des copies de The Turner Diaries. Le « Jour de la Corde » (Day of the Rope) – fantasme génocidaire du roman – est scandé et écrit sur des pancartes.
L’un des émeutiers déclare à la caméra : « C’est aujourd’hui le Jour de la Corde » (This is the Day of the Rope).
Les Proud Boys et la normalisation de la violence
Les Proud Boys, groupe néofasciste fondé en 2016, jouent un rôle central dans l’assaut. Leur leader, Enrique Tarrio, est condamné en 2023 à 22 ans de prison pour conspiration séditieuse. Le groupe reprend l’esthétique et la rhétorique du suprémacisme blanc tout en prétendant ne pas être raciste (en ayant quelques membres non-blancs comme alibis).
Or, lors d’un débat présidentiel en septembre 2020, Donald Trump refuse de condamner les Proud Boys et leur lance : « Stand back and stand by » (Reculez et tenez-vous prêts). Le groupe interprète immédiatement cette phrase comme un ordre présidentiel et l’affiche sur ses réseaux sociaux comme slogan officiel.
Trump et l’héritage de The Order
Donald Trump n’est pas Bob Mathews. Il n’a jamais braqué de banque ni tué personne. Il a même été victime d’une tentative d’assassinat. Mais il a normalisé une rhétorique qui, pendant des décennies, était cantonnée aux marges suprémacistes :
- La dénonciation du gouvernement fédéral comme ennemi du peuple
- La théorie conspirationniste du « Deep State » (État profond)
- La déshumanisation des immigrés (« animals », « invasion »)
- La remise en cause de la légitimité des élections
- L’appel à la violence (« fight like hell », « trial by combat »)
- Le refus de condamner clairement le suprémacisme blanc
Après le 6 janvier, Trump a qualifié les émeutiers de « patriots » (patriotes) et a promis de les gracier s’il était réélu. Promesse qu’il a tenue dès ses premiers jours de son second mandat en janvier 2025.
Le film de Kurzel devient donc un miroir inquiétant : Bob Mathews voulait renverser le gouvernement américain. Il a échoué. Mais son idéologie, ses méthodes, son héritage ont contaminé le mainstream politique américain. Le danger n’est plus à la marge. Il est au centre.
Utiliser The Order avec des élèves ou étudiants
The Order constitue un outil pédagogique de premier plan pour aborder des questions contemporaines cruciales en HGGSP. Cependant le propos est sombre et en nos temps si troublés, il est à manier avec la plus extrême des précautions. Je le réserverais donc à une exploitation avec des élèves du supérieur. Il servira assurément pour alimenter les réflexions des collègues préparant des cours. Voici en ce sens des pistes de réflexions, structurées par niveau et par thème du programme de HGGSP qui semble le plus adapté.
PREMIÈRE – Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie
Axe 1 : Les menaces intérieures à la démocratie
Objectif : analyser comment des groupes radicaux peuvent menacer les fondements démocratiques depuis l’intérieur du système.
Problématique : Dans quelle mesure le terrorisme domestique constitue-t-il une menace existentielle pour la démocratie américaine ?
Démarche pédagogique :
- Visionner des extraits clés :
- La scène d’initiation de The Order (serment, rituel)
- Le braquage du camion blindé
- La confrontation finale sur l’île de Whidbey
- Analyse comparative :
- Comparer avec des extraits de documentaires sur le 6 janvier 2021
- Mettre en parallèle le discours de Bob Mathews dans le film avec des déclarations réelles de leaders Proud Boys ou Oath Keepers
- Travail sur documents :
- Extrait de la Constitution américaine (1er et 2e amendements)
- Déclaration du FBI sur le terrorisme domestique (2020-2024)
- Statistiques sur la violence d’extrême droite aux États-Unis (Anti-Defamation League, Southern Poverty Law Center)
Question de réflexion : une démocratie peut-elle tolérer ceux qui veulent la détruire ? Où placer la limite entre liberté d’expression et incitation à la violence ?
Axe 2 : Le rôle des institutions dans la défense de la démocratie
Objectif : comprendre le rôle du FBI et des institutions judiciaires dans la lutte contre le terrorisme domestique.
Le personnage de Terry Husk (Jude Law) permet d’aborder les dilemmes éthiques des agents fédéraux :
- Jusqu’où peut-on aller pour infiltrer un groupe terroriste ?
- Comment concilier sécurité nationale et libertés individuelles ?
- Que faire face à la complicité passive de certaines communautés locales ?
PREMIÈRE – Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
Axe 1 : La propagande et la radicalisation
Objectif : analyser comment The Turner Diaries fonctionne comme outil de radicalisation.
Démarche :
- Sans lire le livre (qui reste un texte de propagande néonazie et qui est interdit), étudier :
- Des analyses universitaires du livre (Southern Poverty Law Center)
- Des extraits d’articles de presse sur son influence
- Comparer avec d’autres formes de propagande radicale :
- Propagande djihadiste en ligne
- Théories conspirationnistes (QAnon, etc.)
- Travail sur la structure narrative de la radicalisation :
- Comment un récit fictionnel peut-il inciter au passage à l’acte ?
- Quel est le rôle des communautés en ligne dans la diffusion de ces idées ?
Production attendue : les élèves créent une campagne de sensibilisation sur les mécanismes de la radicalisation en ligne, destinée à un public de lycéens.
Axe 2 : Le journalisme face au terrorisme
Activité : comparer le traitement médiatique :
- Du terrorisme islamiste (post-11 septembre)
- Du terrorisme d’extrême droite (Oklahoma City, Christchurch, El Paso)
Question centrale : pourquoi le terme « terroriste » est-il appliqué différemment selon l’origine ethnique ou religieuse de l’auteur ?
Documents :
- Une du New York Times après le 11 septembre
- Une du New York Times après Oklahoma City
- Une du New York Times après El Paso
- Analyse sémantique : « terrorist » vs « lone wolf » vs « troubled individual »
Débat : en quoi le langage médiatique influence-t-il la perception publique des menaces ?
TERMINALE – Thème 1 : De nouveaux espaces de conquête
Application inattendue : le cyberespace comme espace de radicalisation
Et oui, il faut tenter des choses …
Problématique : Comment Internet est-il devenu le territoire de conquête des mouvements extrémistes ?
Dans les années 1980, Bob Mathews devait recruter en personne, imprimer des tracts, organiser des réunions clandestines. Aujourd’hui, les néonazis recrutent sur 4chan, 8kun, Telegram, Gab.
Travail de recherche :
- Les élèves enquêtent (avec l’accompagnement du professeur-documentaliste) sur :
- Les plateformes utilisées par l’extrême droite
- Les techniques de recrutement en ligne
- La réponse des plateformes (modération, bannissement)
- Cas d’étude : Le manifeste de Christchurch (2019)
- L’attaque a été diffusée en direct sur Facebook
- Le manifeste a circulé sur 8chan
- Analyse de la stratégie médiatique du terroriste
Question éthique : jusqu’où va la responsabilité des plateformes numériques ?
TERMINALE – Thème 3 : Histoire et mémoires
Axe : Mémoires conflictuelles aux États-Unis
Objectif : comprendre comment l’histoire de la violence raciale est instrumentalisée par différents groupes.
Problématique : Comment The Order s’inscrit-il dans une mythologie alternative de l’histoire américaine ?
Documents :
- Extraits du film montrant les références historiques de Bob Mathews (guerre de Sécession, Reconstruction)
- Textes de David Duke (ancien leader du KKK) sur la « vraie histoire » américaine
- Analyse de la théorie du « Grand Remplacement »
Activité : Les élèves pourraient créer une chronologie comparée :
- Colonne 1 : Histoire factuelle (abolition de l’esclavage, droits civiques, etc.)
- Colonne 2 : Récit suprémaciste blanc (oppression des Blancs, génocide blanc, etc.)
- Colonne 3 : Manifestations contemporaines de ces récits (Charlottesville, 6 janvier)
Question de fond : Comment lutter contre une « mémoire » alternative fondée sur des mensonges, tout en respectant la pluralité des points de vue historiques légitimes ?
PROPOSITION INTERDISCIPLINAIRE : HGGSP + ANGLAIS
Projet : Enquêter sur le 6 janvier comme si c’était The Order
Objectif : les élèves mènent une enquête type FBI/journalistique sur l’assaut du Capitole, en s’inspirant de la méthodologie du film.
Phase 1 – Sources primaires (en anglais) :
- Rapport de la Commission du 6 janvier (disponible en ligne)
- Articles de presse américains (New York Times, Washington Post, ProPublica)
- Témoignages filmés d’agents de police du Capitole
Phase 2 – Analyse comparative (en français) :
- Comparer les méthodes de The Order et celles des groupes du 6 janvier
- Identifier les continuités idéologiques
Phase 3 – Production :
- Les élèves créent un documentaire vidéo (style documentaire Netflix) de 15-20 minutes présentant leurs conclusions
- Ou : Un podcast analysant les événements
Compétences travaillées :
- Recherche documentaire
- Esprit critique
- Maîtrise de l’anglais
- Production multimédia
- Travail collaboratif
Corpus complémentaire : films et séries pour approfondir
Pour enrichir l’analyse de The Order, voici une sélection de films et séries qui explorent des thématiques connexes et qui pourrait donner des idées :
Sur le terrorisme domestique américain
Oklahoma City (documentaire, 2017, Barak Goodman) Excellent documentaire sur l’attentat de 1995, retraçant l’itinéraire de Timothy McVeigh et l’influence de The Turner Diaries. Indispensable pour comprendre la continuité entre The Order et les attentats suivants.
Waco: American Apocalypse (série documentaire Netflix, 2023) Sur le siège de Waco (1993) qui a radicalisé Timothy McVeigh. Montre comment un événement traumatique peut servir de catalyseur pour la violence.
Sur le FBI et les institutions
All the President’s Men (Alan J. Pakula, 1976) Le classique sur l’enquête Watergate. Montre le rôle de la presse et des institutions dans la défense de la démocratie.
The Report (Scott Z. Burns, 2019) Sur l’enquête du Sénat américain sur les tortures de la CIA post-11 septembre. Pertinent pour discuter des dérives institutionnelles face au terrorisme.
Sicario (Denis Villeneuve, 2015) Thriller sur la guerre contre les cartels mexicains. Pose la question : jusqu’où un État peut-il aller pour combattre ses ennemis ?
Sur la radicalisation et l’extrémisme
American History X (Tony Kaye, 1998) Déjà mentionné. Reste une référence incontournable. À comparer avec The Order : portrait individuel vs portrait collectif.
Imperium (Daniel Ragussis, 2016) Daniel Radcliffe en agent du FBI infiltrant des néonazis. Moins réussi que The Order mais documenté.
The Infiltrator (Brad Furman, 2016) Sur l’infiltration du cartel de Medellín. Permet de comparer les méthodes d’infiltration.
Mindhunter (série Netflix, David Fincher, 2017-2019) Sur la naissance du profilage psychologique au FBI dans les années 1970-80. Montre comment l’institution tente de comprendre la violence.
Sur le contexte politique américain
Vice (Adam McKay, 2018) Biopic satirique de Dick Cheney. Montre la dérive autoritaire post-11 septembre et la construction d’un « État sécuritaire ». Jubilatoire. Mais aussi effrayant.
The Comey Rule (mini-série, 2020) Sur James Comey, directeur du FBI limogé par Trump. Pertinent pour comprendre les tensions entre Trump et les institutions.
The Loudest Voice (série, 2019) Sur Roger Ailes et Fox News. Montre comment un média peut radicaliser l’opinion publique. Déjà étudié ici
Pour les plus audacieux : Propositions pédagogiques ambitieuses
Activité 1 : Uchronie – Et si The Order avait réussi ?
Inspiration : L’article sur Civil War proposait une uchronie sur les conséquences géopolitiques d’une guerre civile américaine. Ici, on va plus loin.
Consigne : Imaginez que le braquage de 3,6 millions de dollars ait permis à Bob Mathews de financer une insurrection armée réussie dans le Nord-Ouest pacifique. Une « République aryenne » de l’Idaho, du Montana et de l’Est de l’État de Washington proclame son indépendance en 1985.
Questions à explorer :
- Réaction du gouvernement fédéral : Intervention militaire ? Négociations ? Parallèle avec la guerre de Sécession ?
- Réaction internationale : L’ONU reconnaît-elle ce « pays » ? L’URSS (encore existante en 1985) tente-t-elle d’exploiter la situation ? L’Europe condamne-t-elle ?
- Conséquences à long terme : Ce territoire devient-il un refuge pour tous les suprémacistes blancs du monde ? Un narco-État ? Un échec économique ?
- Résonances contemporaines : Les mouvements sécessionnistes actuels (Texas, Californie) seraient-ils encouragés par ce précédent ?
Format : Les élèves travaillent en groupes (3-4) et produisent :
- Une chronologie détaillée (1985-2025)
- Une carte géopolitique montrant les alliances et les zones d’influence
- Un article de presse fictif publié en 2025 : « 40 ans de la République aryenne : bilan »
Objectif pédagogique : Comprendre que l’histoire n’est pas déterminée, que les choix individuels et collectifs ont des conséquences massives.
Activité 2 : Débat – Faut-il interdire les groupes suprémacistes ? (EMC, Philosophie)
Contexte : En France, des groupes comme Génération Identitaire ou Bastion Social ont été dissous. Aux États-Unis, le 1er amendement protège la liberté d’expression, rendant très difficile l’interdiction de groupes sur la base de leurs idées.
Problématique : Une démocratie peut-elle et doit-elle interdire les groupes qui prônent sa destruction ?
Organisation du débat :
- Équipe 1 : Pour l’interdiction (argument de la légitime défense démocratique)
- Équipe 2 : Contre l’interdiction (argument de la liberté d’expression, risque de créer des martyrs)
- Équipe 3 : Position nuancée (interdire les actes, pas les idées)
Documents fournis :
- 1er amendement de la Constitution américaine
- Jurisprudence de la Cour Suprême (Brandenburg v. Ohio, 1969 : limite entre discours protégé et incitation à la violence)
- Lois françaises sur la dissolution d’associations
- Témoignages d’anciens néonazis sur les raisons de leur sortie du mouvement
Déroulement :
- Phase de recherche (1 semaine)
- Débat en classe (1h30)
- Vote à bulletin secret : quelle position les élèves jugent-ils la plus convaincante ?
- Rédaction individuelle : essai argumenté sur la question
Conclusion : The Order, un film nécessaire
The Order n’est pas un film confortable. Il ne propose ni catharsis, ni rédemption, ni happy end. Bob Mathews meurt, mais ses idées survivent. Le FBI gagne une bataille, mais la guerre continue. En 2025, quarante ans après les événements du film, le danger suprémaciste blanc n’a jamais été aussi présent dans le débat public américain.
Alors pourquoi exploiter ce film ?
Précisément parce qu’ignorer le problème ne le fera pas disparaître. Pendant des décennies, le terrorisme domestique blanc a été minimisé, euphémisé, traité comme un épiphénomène. Les conséquences de ce déni sont aujourd’hui visibles : le 6 janvier 2021 n’est pas un accident, c’est l’aboutissement logique de décennies de complaisance.
The Order fait ce que le cinéma fait de mieux : il nous force à regarder ce que nous préférerions ignorer. Il nous montre que le mal n’est pas toujours spectaculaire, qu’il peut porter un visage banal, qu’il se construit lentement, méthodiquement. Il nous rappelle que les institutions démocratiques sont fragiles, que la vigilance est le prix de la liberté.
Pour des étudiants du supérieur, qui ont grandi dans un monde où la démocratie est ouvertement remise en cause, ce film est un outil essentiel pour comprendre le présent. Il leur donne les clés pour décrypter les discours, pour reconnaître les signaux d’alarme, pour ne pas tomber dans le piège de la banalisation.
Car au fond, la question que pose The Order est simple, terrible, et éternelle : Que faisons-nous quand la démocratie est attaquée de l’intérieur ?
La réponse ne peut venir que de citoyens informés, vigilants, critiques. C’est précisément le rôle de l’école.
The Order nous rappelle que l’histoire n’est pas une abstraction. Elle se joue ici, maintenant, dans les choix que nous faisons collectivement. Et que le silence, l’indifférence, la complaisance sont toujours les alliés de ceux qui veulent détruire.
Alors oui ce film est complexe, doit être manipulé avec précaution mais est exploitable dans le cadre de la réflexion des enseignants et, pourquoi pas, avec des étudiants post bac.
Parce que, comme le disait si bien Hannah Arendt : « La banalité du mal » commence toujours par le refus de voir.