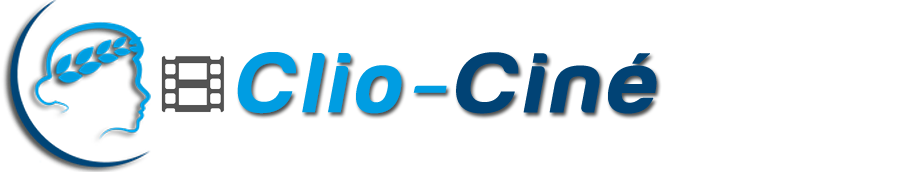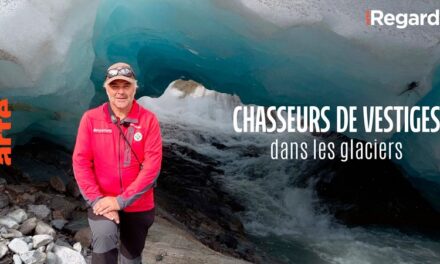En attendant la neige est un documentaire saisissant. L’arrivée de la neige est de plus en plus tardive et la période d’enneigement de plus en plus réduite. Quelles en seraient les conséquences ?
La neige sert de couverture isolante pour certains animaux comme les marmottes qui voient leur effectif se réduire. Les jeunes sont menacés car plus fragiles et les femelles qui doivent déjà essayer de survivre donnent naissance à moins de petits.
D’autres doivent aller plus haut et se raréfient. C’est le cas du lièvre variable. A 2000 mètres, il doit partager son territoire avec d’autres espèces comme le lièvre d’Europe. L’hydridation et, ensuite, la banalisation des espèces est à prévoir.
Les fleurs ont besoin de neige en épaisseur pour se mettre en « pause » l’hiver comme les rhododendrons. Ils maximisent la température et la lumière disponibles et font preuve d’une remarquable adaptation.
Les chutes du Niagara avec leurs lacs et rivières interconnectés constituent le plus grand réseau d’eau douce du monde. L’eau retient la chaleur plus efficacement que l’air. Et donc sur les grands lacs américains, on trouve des nuages chargés de neige qui donnent de la « neige à effet de lac ». Le vent peut emmener cette neige dans les zones habitées. Le phénomène se trouve aussi du côté de la mer du Japon. A court terme, pas d’inquiétude mais à plus long terme, le réchauffement climatique menacera ces phénomènes originaux.
Sur les arbres, les érables par exemple, des simulations de réchauffement du sol (câbles chauffants) ont lieu pour voir ce que des cycles plus courts et plus chauds pourraient engendrer sur la croissance des arbres. La croissance semble favorisée (avec une visée heureuse d’une plus forte séquestration du carbone) avec des températures plus douces mais, finalement, les racines s’en trouvent détériorées et les arbres fragilisés, c’est donc un mauvais calcul à long terme. Les espèces moins nordiques seront amenées à remplacer les espèces présentes au départ.
Certaines espèces se satisfont du réchauffement. Il y a, dans la topographie, des sortes de mini adrets et mini ubac qui peuvent voir des espèces végétales se déplacer au gré du changement des températures : là encore, il y a capacité d’adaptation mais jusque quand ?
La structure de la neige dépend des conditions de l’air et du sol. Elle est ainsi plus ou moins efficace en termes d’isolation thermique. On peut voir la présence de débris végétaux liée à des évènements venteux ayant amené de la mobilité.
La hauteur de neige varie beaucoup selon les années mais, malgré tout, on passe de 1m à 60 cm aujourd’hui (col de Porte en Isère). L’évolution de la température de l’air va également vers un réchauffement (+ 1° en 30 ans). Il y aura, là-bas, des hivers sans neige, c’est indéniable.
La station des Orres a été pensé, du point de vue architectural, pour se fondre dans le décor. Le nombre d’habitants permanents a augmenté avec les besoins du tourisme. Malgré tout, entre 1000 et 2000 m, les stations de moyenne montagne sont condamnées. 150 stations en France témoignent de cet âge d’or révolu. Aux Orres, plus haut, il y a encore matière à réfléchir pour survivre : énergies renouvelables via les torrents, des touristes venant en train, meilleure isolation des bâtiments, éclairage public moins gourmand. Les canons à neige sont parfois nécessaires.