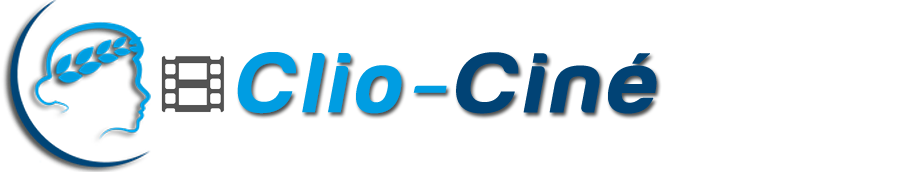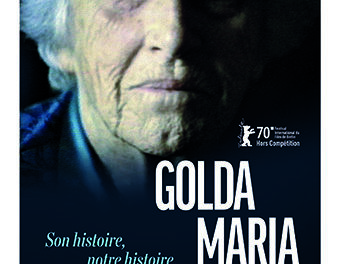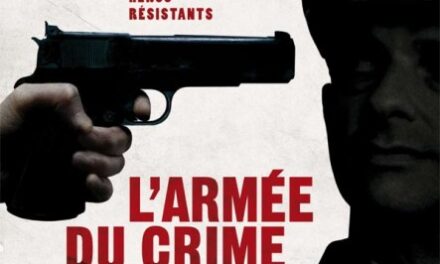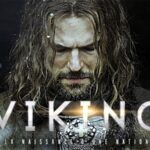Le 29 octobre 2025 nous offre une adaptation aussi audacieuse que nécessaire. François Ozon, avec « L’Étranger », adaptation du roman fondateur d’Albert Camus, nous confronte à l’une des œuvres les plus énigmatiques de la littérature française. Alors que les questions d’identité, de justice et de marginalité traversent notre époque, ce film interroge la place de l’individu face aux codes sociaux et aux attentes collectives.
Synopsis
Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.
Quand la littérature rattrape le cinéma
C’est sur les traces du roman publié en 1942 que François Ozon a construit son adaptation, mêlant fidélité au texte camusien et parti pris cinématographique fort. L’Étranger appartient au « Cycle de l’absurde » aux côtés de Caligula et du Mythe de Sisyphe, triptyque dans lequel Camus développe sa philosophie de l’absurde : ce sentiment de divorce entre l’homme et sa vie, entre l’acteur et son décor.
Ozon fait le choix audacieux de placer le spectateur dans la conscience fragmentée de Meursault plutôt que dans une position de jugement moral. Cette approche déstabilisante nous éloigne de l’identification compassionnelle habituelle pour nous confronter directement à l’étrangeté d’un être qui semble vivre hors des codes émotionnels de son époque. Meursault n’éprouve pas les sentiments qu’on attend de lui : face à cette béance, la société ne peut que le condamner.
« Cela ne veut rien dire »
La force du film réside dans cette exploration d’un homme qui refuse catégoriquement de jouer le jeu social. Loin de toute psychologisation rassurante, Meursault incarne ce que Camus appelait l’homme absurde : celui qui a pris conscience que l’existence n’a pas de sens préétabli et qui refuse d’en feindre un. Le réalisateur parvient à nous montrer cette étrangeté sans jamais verser dans l’explication facile ou la pathologisation du personnage.
Le procès, où Meursault découvre qu’on le juge moins pour son crime que pour son attitude lors de l’enterrement de sa mère, est un moment phare. Le projet offre de nombreuses réflexion qui révèlent l’acharnement de la société à faire rentrer l’individu dans ses catégories morales. Face à des juges et un procureur qui exigent des émotions codifiées, Meursault se révèle dans toute sa singularité : un homme incapable de mentir sur ce qu’il ressent, obsédé par la vérité de ses sensations plutôt que par les convenances.
L’Algérie coloniale : un système d’injustice
Le film dépeint avec justesse l’Algérie des années 1930, société coloniale profondément inégalitaire. Ozon ancre son récit dans cette réalité historique cruciale : l’Algérie française n’est pas simplement un décor exotique, mais un système politique qui structure l’ensemble du récit. C’est assurément une force pour nos enseignements.
La reconstitution historique met en lumière le statut de l’indigénat, cadre juridique d’exception qui régit la vie des Algériens musulmans depuis 1881. Ce régime discriminatoire crée deux catégories de citoyens sur le même territoire : les Européens jouissent de la pleine citoyenneté française, tandis que les « indigènes » sont soumis à un code spécial, peuvent être internés sans jugement et ne disposent pas des mêmes droits civiques. Cette ségrégation juridique trouve son écho dans la géographie urbaine qu’Ozon reconstitue : quartiers européens et quartiers arabes se côtoient sans se mélanger.
L’Arabe tué sur la plage reste un anonyme dans le roman comme dans le film. Ce choix, loin d’être anecdotique, révèle la violence symbolique du système colonial : l’effacement de l’identité de la victime, son absence de nom, sa quasi-disparition du procès traduisent la hiérarchie raciale qui sous-tend la société coloniale. Lors du procès, la justice française se préoccupe davantage de l’absence de larmes de Meursault à l’enterrement de sa mère que de la vie de l’homme qu’il a tué. Cette inégalité face à la justice illustre la double morale de l’Algérie coloniale. Elle résonne également dans les débats houleux de l’époque quant aux colonies dans leur ensemble.
Une République en crise, un intellectuel en formation
Le contexte de rédaction du roman (1940-1942) résonne avec celui du film. Camus écrit L’Étranger alors que la Troisième République s’effondre, emportée par la défaite de 1940. Le roman paraît en 1942, sous l’Occupation, dans une France coupée en deux, soumise à la censure du régime de Vichy et des autorités allemandes. Cette période trouble marque profondément l’œuvre : Meursault incarne peut-être aussi l’impossibilité de trouver du sens dans un monde qui vient de basculer dans l’horreur.
Le film permet ainsi d’aborder la naissance d’une pensée critique dans un contexte de crise démocratique. Camus, jeune journaliste algérois issu d’un milieu modeste, développe dans L’Étranger une contestation radicale des valeurs établies : la famille, la religion, la justice, toutes ces institutions sont interrogées, mises à distance. Cette posture critique annonce l’engagement qui sera le sien dans la Résistance, puis dans les débats de l’après-guerre dans un contexte de lutte pour l’indépendance.
Vivre sous le regard des autres
L’un des enjeux majeurs du film concerne la question du regard social et du conformisme émotionnel. À travers le personnage de Marie, interprétée avec justesse par Rebecca Marder, Ozon interroge la possibilité d’aimer un être qui échappe aux codes affectifs conventionnels. Comment vivre avec quelqu’un qui refuse de dire « je t’aime » parce qu’il pense que « cela ne veut rien dire » ?
Le film évite l’écueil de la simplification pour privilégier une approche nuancée : Meursault n’est pas un monstre d’insensibilité mais un homme d’une sensibilité autre, attentif aux sensations physiques (la chaleur, la lumière, le corps de Marie) plutôt qu’aux sentiments abstraits. Cette perspective permet de mieux comprendre les mécanismes de normalisation sociale et leurs violences symboliques.
La mémoire par l’art, entre fidélité et création
Comme le souligne le riche dossier pédagogique qui accompagne le film, cette œuvre s’inscrit dans une longue tradition d’adaptations littéraires au cinéma. François Ozon opère des choix esthétiques remarquables : une photographie écrasée de lumière qui rend presque physique la chaleur algéroise, un montage qui privilégie les silences et les temps morts, une voix off qui n’émerge qu’après le meurtre, comme si cet acte avait permis à Meursault d’accéder à une forme de conscience réflexive.
Le réalisateur français, habitué des adaptations littéraires et des sujets sensibles, apporte sa sensibilité particulière à ce récit. Son regard de cinéaste contemporain enrichit considérablement l’approche du roman en l’incarnant visuellement : le soleil n’est plus seulement une métaphore littéraire mais une présence physique, oppressante, qui pèse sur chaque plan.
Enjeux pédagogiques : entre littérature, histoire et philosophie
Cette œuvre s’avère particulièrement pertinente pour plusieurs niveaux et programmes, au-delà de l’Histoire :
Pour la Seconde
Objet d’étude « Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle » : le film permet d’appréhender concrètement ce qu’est la « modernité » littéraire. À travers les choix narratifs (narration à la première personne, style blanc, refus de la psychologie traditionnelle), les élèves peuvent comprendre comment le roman du XXe siècle rompt avec les codes du roman réaliste du XIXe.
Pour la Première
Parcours « Personnage marginal, plaisirs du romanesque » : Meursault incarne exemplairement la figure du marginal, non par choix social mais par impossibilité d’adhérer aux codes émotionnels de sa société. L’étude comparée du roman et du film permet d’interroger les modalités de construction d’un personnage « étranger » à son propre monde.
Pour la Terminale spécialité HLP
Les thèmes « La recherche de soi » et « L’humanité en question » trouvent dans cette œuvre un support d’exception :
- La sensibilité : comment Meursault exprime-t-il une sensibilité autre, fondée sur les sensations physiques ?
- Les métamorphoses du moi : la prise de conscience finale de Meursault face à l’absurde
- Histoire et violence : le contexte colonial, la violence de la justice
- Les limites de l’humain : qu’est-ce qui fait qu’on est « humain » aux yeux de la société ?
Le film peut également nourrir des réflexions en Philosophie sur l’existentialisme, l’absurde selon Camus (distinct du nihilisme), la liberté individuelle face aux déterminismes sociaux, ou encore la question de la responsabilité morale.
Pour la Terminale spécialité HGGSP
Le film constitue je pense un outil pédagogique exceptionnel pour aborder plusieurs thèmes du programme :
Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution
- Axe sur la dimension politique de la guerre : l’Algérie coloniale comme espace de violence structurelle. Le film permet d’interroger la notion de « pacification » coloniale et les formes de domination qui ne disent pas leur nom. La mort de l’Arabe sans nom peut ouvrir une réflexion sur les violences coloniales et leur invisibilisation.
- La justice et le droit dans les situations de conflit : comment le système judiciaire français traite-t-il différemment un Européen et un « indigène » ? Le procès de Meursault illustre l’inégalité juridique au cœur du système colonial.
Thème 3 – Histoire et mémoires
- Histoire et mémoires de l’Algérie française : le film s’inscrit dans un moment clé de réévaluation mémorielle. Comment représenter aujourd’hui l’Algérie coloniale ? Quels choix esthétiques et narratifs pour montrer ce passé ? La comparaison entre le roman de 1942 et le film de 2025 permet d’interroger l’évolution du regard sur la colonisation.
- Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale : le contexte de publication du roman (1942, sous Vichy) ouvre sur une réflexion sur la production intellectuelle en temps de crise. Comment publie-t-on un texte subversif sous l’Occupation ? Quels compromis, quelles résistances ?
- Le rôle des artistes et intellectuels dans la construction mémorielle : Camus comme figure d’intellectuel engagé. Sa trajectoire permet d’aborder la question de la responsabilité de l’écrivain face à l’histoire.
Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire
- Les sociétés face aux risques : une piste plus originale consiste à travailler sur le soleil comme élément environnemental déterminant. Comment le climat méditerranéen structure-t-il les modes de vie dans l’Algérie coloniale ? Le film permet une approche géographique et environnementale de l’espace colonial.
Thème 6 – L’enjeu de la connaissance
- Produire et diffuser des connaissances dans un contexte de censure : publier sous Vichy et l’Occupation. Le parcours éditorial de L’Étranger chez Gallimard malgré la censure.
- Le rôle de la littérature comme mode de connaissance du réel : le roman et son adaptation comme outils pour comprendre une société et une époque.
Pour l’Histoire en Première et Terminale
Première – Thème sur la colonisation
- Le film offre une reconstitution précise de l’Algérie des années 1930, permettant d’illustrer concrètement le système de l’indigénat, la ségrégation spatiale, et les contradictions entre les valeurs républicaines affichées et les pratiques coloniales.
- L’étude comparée de scènes du film avec des sources historiques (photographies d’époque, textes juridiques sur l’indigénat, témoignages) permet un travail sur le statut du film comme source historique.
Terminale – Thème sur la IIIe République et la Seconde Guerre mondiale
- Le contexte de production du roman (crise des années 1930, effondrement républicain, Occupation) permet d’aborder la question de la production culturelle en temps de crise démocratique.
Pistes d’exploitation concrètes en HGGSP
Le dossier pédagogique propose plusieurs activités qui peuvent être adaptées en HGGSP :
- Étude documentaire sur le statut de l’indigénat : confronter des extraits du film avec des textes juridiques d’époque (code de l’indigénat, débats parlementaires) pour comprendre le système colonial algérien.
- Analyse comparative des scènes de procès : comparer le traitement judiciaire de Meursault avec des procès réels dans l’Algérie coloniale pour mettre en lumière les inégalités de traitement selon l’origine ethnique.
- Recherche sur les réseaux d’édition sous l’Occupation : comment Gallimard a-t-il pu publier L’Étranger en 1942 ? Quels compromis, quelles stratégies de contournement de la censure ?
- Travail sur les sources : utiliser des archives (presse algéroise des années 1930, documents administratifs coloniaux) pour contextualiser le film et mesurer l’écart entre représentation artistique et réalité historique.
- Débat historiographique : comment les historiens ont-ils interprété L’Étranger au fil du temps ? Du roman « universel » sur l’absurde à une lecture postcoloniale qui interroge l’effacement de la victime arabe.
Une œuvre exigeante mais essentielle
« L’Étranger » de François Ozon n’est pas un film facile. Le réalisateur refuse les explications rassurantes et les jugements moraux simplistes pour nous confronter à la réalité crue d’une existence vécue hors des codes. Cette approche sans concession en fait un outil pédagogique précieux, capable de susciter chez les élèves une réflexion critique sur la conformité sociale, les attentes émotionnelles et la question de l’authenticité, tout en offrant un accès vivant et incarné à l’histoire coloniale française.
L’interprétation de Benjamin Voisin, remarquable de justesse et d’intelligence, évite l’écueil de la caricature pour livrer un portrait complexe et troublant. La direction artistique, entre reconstitution historique méticuleuse et stylisation esthétique, place l’accent sur l’essentiel : la lumière, les corps, les silences révélateurs d’une existence qui refuse de se justifier.
Largement exploitable avec des élèves de lycée, ce film constitue un support d’exception pour aborder les questions d’identité, de justice sociale, de marginalité et de liberté individuelle, mais aussi pour comprendre concrètement ce que fut l’Algérie coloniale et les contradictions de la République française face à son empire. Il s’inscrit dans la lignée des grandes œuvres qui articulent fiction littéraire et questionnement historique, de La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo à Indigènes de Rachid Bouchareb, avec lesquelles il dialogue naturellement. Le documentaire Ne nous racontez plus d’histoires de Carole Filiu-Mouhali et Ferhat Mouhali peut tout à fait prolonger le film de façon admirable.
François Ozon, 2025 / 2H / Drame historique
Avec : Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud
D’après le roman : L’Étranger d’Albert Camus (Gallimard, 1942)
Ressources pédagogiques : Le dossier pédagogique complet est disponible, proposant des pistes d’exploitation pour les programmes de Seconde, Première et Terminale (Lettres, HLP, Histoire), des fiches d’activités sur l’incipit, le procès, le personnage de Marie, ainsi que des éclairages historiques sur l’Algérie coloniale (statut de l’indigénat, Troisième République) et philosophiques sur l’absurde camusien. Une section spécifique est consacrée à la contextualisation historique avec bibliographie sélective.
Vous pouvez prévoir d’organiser une séance au cinéma avec votre classe à partir du 29 octobre, il vous suffit de contacter dès maintenant la salle de cinéma la plus proche de votre établissement et ainsi mettre en place une séance avec la direction du cinéma, au tarif Groupe ou en vous rendant sur l’application ADAGE pour bénéficier du « pass Culture part collective ».Toutes les salles sont susceptibles d’accueillir ce type de séance spéciale. Le cinéma se rapproche du distributeur GAUMONT pour demander le film.
Le site officiel du film www.letranger-lefilm.com, propose la liste complète des avant-premières organisées à travers la France. Vous y trouverez également toutes les informations relatives à la projection simultanée, suivie d’un débat retransmis en direct, qui aura lieu le jeudi 16 octobre à 18h30. Le débat sera retransmis dans les salles participantes dont voici la liste : https://devilleenville.unipop.fr/les-conferences/letranger-avant-premiere-en-presence-du-realisateur-francois-ozon-2/
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : sandrine@approches.net