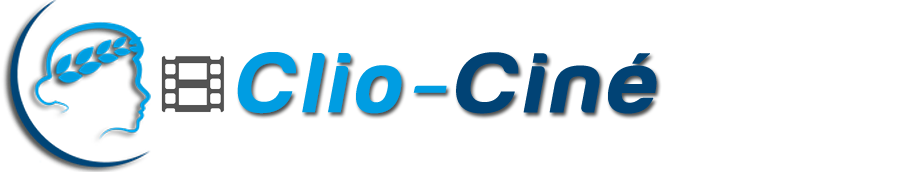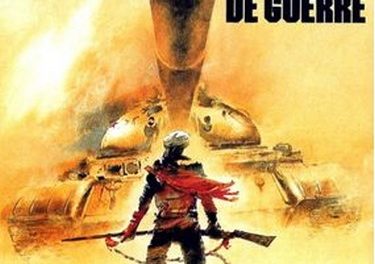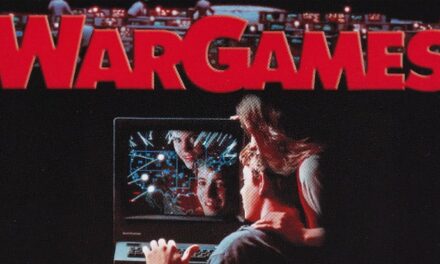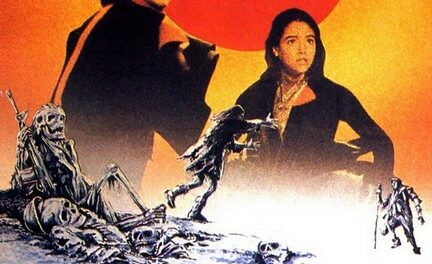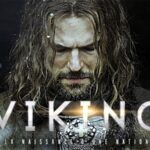La rentrée 2025 nous offre une œuvre cinématographique aussi dérangeante que nécessaire. Kirill Serebrennikov, avec « La disparition de Josef Mengele« , adaptation du roman d’Olivier Guez, nous confronte à l’une des figures les plus sinistres du nazisme. Alors que les questions mémorielles traversent notre époque et que la montée des extrémismes inquiète, ce film interroge la persistance du mal et les mécanismes de la transmission idéologique.
Synopsis
Après la chute du Reich, Josef Mengele, l’« Ange de la mort » d’Auschwitz-Birkenau, entame une fuite qui durera des décennies. De l’Argentine au Brésil, en passant par le Paraguay, il tente d’échapper à la justice tout en préservant ses convictions nazies. Le film suit ce criminel de guerre dans sa quête obsessionnelle de légitimation et de transmission de son héritage idéologique, jusqu’à sa mort en 1979, sans jamais avoir été jugé.
Quand l’Histoire rattrape le bourreau
C’est sur les traces documentées de la fuite de Josef Mengele qu’Olivier Guez a construit son récit, mêlant faits historiques avérés et reconstruction romanesque. Le romancier français s’appuie sur un travail d’archives minutieux pour reconstituer l’itinéraire de celui qui supervisa personnellement l’extermination de milliers de déportés et pratiqua des expériences médicales d’une cruauté inouïe.
Kirill Serebrennikov fait le choix audacieux de placer le spectateur face au criminel plutôt qu’aux victimes. Cette approche déstabilisante nous éloigne de l’identification compassionnelle habituelle pour nous confronter directement aux mécanismes de la négation et de la perpétuation du mal. Mengele n’éprouve aucun remords : il reste persuadé de la justesse de ses actes et de la validité de l’idéologie nazie, même dans l’exil.
« Tu ne comprends donc pas que nous étions les sauveurs de l’humanité ? »
La force du film réside dans cette exploration psychologique d’un homme qui refuse catégoriquement de reconnaître ses crimes. Loin de toute rédemption, Mengele incarne ce que Hannah Arendt appelait la « banalité du mal » : un bureaucrate de la terreur convaincu de servir une cause supérieure. Le réalisateur parvient à nous montrer cette persistance idéologique sans jamais verser dans la complaisance ou la fascination malsaine.
Les scènes les plus marquantes du film sont celles où Mengele tente de transmettre ses convictions à son fils Rolf, venu le retrouver au Brésil. Ces séquences révèlent l’acharnement du criminel à légitimer son passé et à perpétuer son héritage. Face à ce fils qui le rejette, Mengele se révèle dans toute sa pathologie : un homme incapable de concevoir l’humanité de ses victimes et obsédé par la pureté raciale.
Une communauté allemande en exil, entre nostalgie et complicité
Le film dépeint avec justesse la communauté allemande de Buenos Aires, véritable sanctuaire pour les anciens nazis. Ces émigrés, souvent complices actifs ou passifs du régime hitlérien, reconstituent une micro-société où l’idéologie nazie peut perdurer en sourdine. Serebrennikov montre comment cette communauté protège Mengele tout en gardant ses distances lorsque les risques deviennent trop grands.
Cette reconstitution éclaire un aspect souvent méconnu de l’après-guerre : l’existence de réseaux d’entraide entre anciens nazis, facilités par la complaisance de certains gouvernements sud-américains. Le film évoque ainsi les « ratlines », ces filières d’évasion qui permirent à de nombreux criminels de guerre d’échapper aux poursuites.
Grandir dans l’ombre de l’Histoire
L’un des enjeux majeurs du film concerne la transmission et la responsabilité des générations suivantes. À travers le personnage de Rolf, le fils de Mengele, Serebrennikov interroge la possibilité de rompre avec l’héritage familial. Comment grandir quand on porte le nom de l’un des plus grands criminels de l’Histoire ? Cette question résonne particulièrement avec les problématiques contemporaines liées à la mémoire et à la transmission.
Le film évite l’écueil de la psychologisation excessive pour privilégier une approche sociologique : Mengele n’est pas un « monstre » isolé mais le produit d’un système idéologique et institutionnel. Cette perspective permet de mieux comprendre les mécanismes du totalitarisme et leurs possibles résurgences.
La mémoire par l’art, entre histoire et fiction
Comme le souligne le riche dossier pédagogique qui accompagne le film, cette œuvre s’inscrit dans une longue tradition de représentation cinématographique de la Shoah et du nazisme. Serebrennikov opère des choix esthétiques remarquables : une mise en scène dépouillée qui évite le spectaculaire au profit de l’analyse psychologique, un montage qui alterne passé et présent pour mieux saisir la persistence du traumatisme.
Le réalisateur russe, habitué des sujets sensibles et de la censure dans son pays, apporte sa sensibilité particulière à ce récit. Son regard d’européen de l’Est, nourri d’une autre expérience du totalitarisme, enrichit considérablement l’approche occidentale traditionnelle de ces questions.
Enjeux pédagogiques : déconstruire les mécanismes du mal
Cette œuvre s’avère particulièrement pertinente pour le programme de Terminale spécialité HLP, notamment les thèmes « L’humanité en question » et « Histoire et violence ». Elle permet d’aborder plusieurs problématiques essentielles :
- La notion de crime contre l’humanité : à travers le parcours de Mengele, les élèves peuvent appréhender concrètement ce que recouvre cette qualification juridique apparue avec les procès de Nuremberg.
- La persistance des idéologies totalitaires : le film montre comment le nazisme survit à la chute du Reich et continue d’influencer certaines communautés en exil.
- Les questions mémorielles : l’œuvre interroge les modalités de transmission du passé et les enjeux de la reconnaissance des crimes.
- L’art face à l’indicible : comment représenter le mal absolu sans tomber dans la fascination ou la banalisation ?
Le film peut également nourrir des réflexions en HGGSP sur les mémoires, l’histoire de la justice internationale, ou encore les migrations forcées du XXe siècle.
Une œuvre dérangeante mais nécessaire
« La disparition de Josef Mengele » n’est pas un film facile. Serebrennikov refuse les consolations et les explications rassurantes pour nous confronter à la réalité crue de la perpétuation du mal. Cette approche sans concession en fait un outil pédagogique précieux, capable de susciter chez les élèves une réflexion critique sur l’Histoire et ses résurgences contemporaines.
L’interprétation de l’acteur principal, remarquable de justesse et d’intelligence, évite l’écueil de la caricature pour livrer un portrait complexe et dérangeant. La direction artistique, sobre et efficace, place l’accent sur l’essentiel : la parole et les gestes révélateurs d’une idéologie mortifère.
Largement exploitable avec des élèves de lycée, ce film constitue un support d’exception pour aborder les questions de responsabilité individuelle, de mémoire collective et de vigilance démocratique. Il s’inscrit dans la lignée des œuvres essentielles sur cette période, de « Shoah » de Claude Lanzmann aux « Bienveillantes » de Jonathan Littell, avec lesquelles il dialogue naturellement.
Kirill Serebrennikov, 2025 / 2h15min / Drame historique
Titre original : La disparition de Josef Mengele
Réalisateur : Kirill Serebrennikov
Scénariste : Kirill Serebrennikov, d’après le roman d’Olivier Guez
Ressources pédagogiques : le dossier pédagogique complet est disponible, proposant des pistes d’exploitation pour les programmes de Terminale HLP, des documents historiques et des activités d’accompagnement pour la lecture du roman d’Olivier Guez. Nous sommes heureux de la partager dans le cadre de notre partenariat avec l’agence Approches.
Pour organiser une séance au cinéma, il vous suffit de contacter la salle de cinéma de votre choix. Tous les cinémas sont en mesure d’accueillir des projections avec un tarif réduit pour les scolaires. Le film sort au cinéma le 22 octobre 2025.
En vous rendant sur l’application ADAGE, vous pouvez bénéficier, pour cette sortie scolaire au cinéma, du pass Culture part collective. Si vous désirez les coordonnées d’un cinéma, n’hésitez pas à le demander à cette adresse : a.wacquin@bacfilms.fr