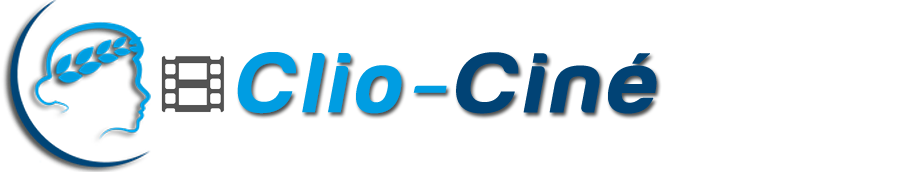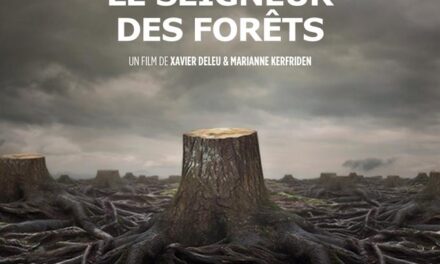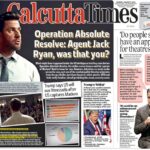Le reportage s’articule autour de l’idée que les jardins botaniques n’ont plus la même fonction que par le passé. Les plantes rares ne sont plus un objet de contemplation mais des espèces à protéger.
Un rapide détour historique évoque le premier jardin botanique universitaire, créé en 1545 à Padoue, puis celui que Louis XIII a fait ouvrir un en 1640.
Ce sont surtout trois jardins majeurs qui sont présentés : celui de Berlin, celui de Londres (Kew) et celui du Lautaret dans les Alpes. Le jardin botanique de Berlin recense presque toutes les zones du Monde. A Londres, les jardins botaniques de Kew accueillent 2 millions de visiteurs par an et comptent 50000 spécimens de collection (le plus gros stock du Monde, notamment les plus grands nénuphars du Monde). Et si cet écosystème ne représente que 7% de la surface terrestre, il concentre 50 % de la diversité végétale mondiale. Le jardin du Lautaret dans les Alpes a été créé en 1899 et compte plus de 2000 espèces. En extérieur, il faut traiter les environs et ôter les adventices pour que chaque plante ait les meilleures chances.
Si la face sombre de l’histoire des jardins botaniques est évoquée avec les « chasseurs de plantes » qui ont décimé divers espaces sauvages (avec, en arrière-plan, l’idée de multiplier en Europe des espèces exotiques pour aller les recultiver après encore ailleurs : cas de l’Hévéa du Brésil ayant transité par Londres pour finir en Asie coloniale), le reste du propos est résolument plus positif.
La coopération internationale est indispensable désormais pour parvenir à une préservation optimale. Si une plante disparait, les insectes qui s’en nourrissent sont touchés aussi. 20 % de la flore sauvage est menacé d’extinction par la pression humaine. Le prélèvement d’une espèce menacée permet une culture intérieure contrôlée pour une réintroduction ultérieure.
Un tiers de toutes les espèces de plantes connues sont cultivées dans les divers jardins botaniques du Monde. Il faut tâcher d’y reproduire la température, le taux d’humidité et le sol d’origine pour que la prise soit optimale.
A Londres, il y a une banque de semences où plus de 2 milliards de graines sont stockées. Elles font office d’une sorte de « double de sécurité « (à l’abri du vol et des catastrophes naturelles) en plus du pays d’origine. Pour l’instant, 40000 espèces ont été traitées et proviennent de 97 pays. Elles sont ensuite congelées pour celles qui peuvent tenir ces conditions. Cela servira aux générations futures. Tous les deux ans, les graines sont décongelées pour y travailler, le but est de trouver, à chaque fois, le meilleur site de destination. 10000 graines par espèces sont nécessaires pour préserver de la variabilité génétique.
Dans le Lautaret, des morceaux d’alpage ont été prélevés pour être analysés 600 m plus bas, là où il fait 3 degrés de plus pour simuler l’évolution du climat futur. La reproduction des plantes est plus lente et sont concurrencées avec d’autres espèces.
Les herbiers historiques permettent de faire des cartes de répartitions par période. 4 millions de planches sont stockés à Londres. Des amateurs peuvent alimenter les collections. Une numérisation est en cours mais l’entreprise est titanesque.
Le propos se termine sur le fait que les artistes contribuent à l’identification des plantes en les dessinant avec précision, aidant ainsi les botanistes.
Voici l’adresse sur laquelle on pouvait trouver ce documentaire. Il ne semble plus être accessible mais nous espérons qu’il le sera à nouveau !
https://www.arte.tv/fr/videos/118621-000-A/les-jardins-botaniques/