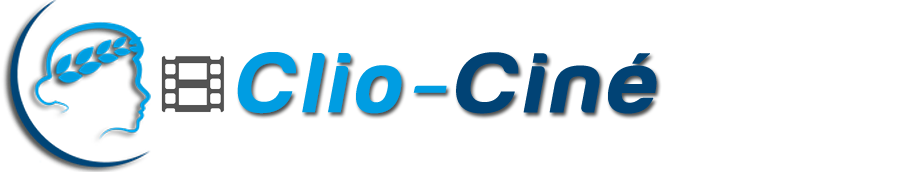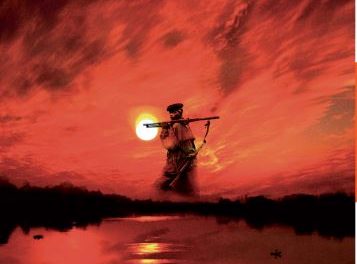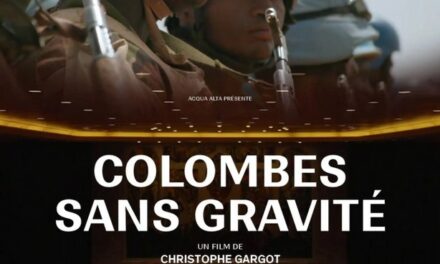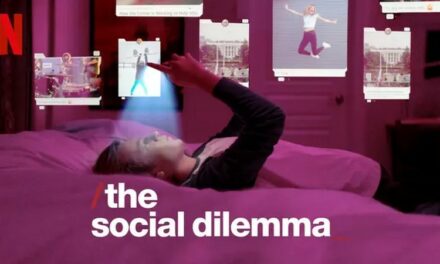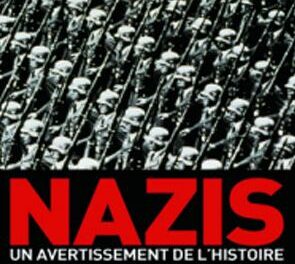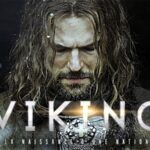20 Jours à Marioupol est un film documentaire ukrainien sorti le 20 janvier 2023.
Les images du reporter de guerre Mstyslav Chernov nous plongent dans l’atroce réalité de la guerre en Ukraine. C’est une immersion visuelle et sonore dans le conflit mais aussi une réflexion sur le guerre.
Synopsis
Février 2022, la Russie lance l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Des journalistes ukrainiens de l’Associated Press sont alors pris au piège dans la ville assiégée de Marioupol. Ils sont les seuls journalistes internationaux ayant choisi de rester sur place pour témoigner de la guerre au plus proche des civils. Les images font le tour du monde et offrent un récit déchirant sur la réalité des conflits armés ainsi qu’une réflexion profonde sur la responsabilité des reporters en temps de guerre.
Récompensé du Prix Pulitzer et de l’Oscar du meilleur documentaire, 20 Jours à Marioupol nous offre un réel témoignage historique venant construire l’Histoire et les mémoires de la guerre en Ukraine. Les images et l’information forment un enjeu central dans les conflits armés en cherchant à la fois à témoigner d’une réalité aussi brutale qu’elle soit mais également à éveiller les consciences sur ce qui se passe sous nos yeux.
Témoigner au nom de l’Histoire : les événements de la guerre en Ukraine
« Les guerres ne commencent pas par des explosions, mais par le silence. »
La guerre en Ukraine qui s’est ouverte en 2014 à prit un nouveau tournant en février 2022 avec l’invasion à grande échelle du territoire ukrainien par la Russie. Marioupol est une ville portuaire et industrielle de la région du Donbass. Le 24 février 2022 l’offensive russe est lancée, Marioupol est alors assiégée par les forces armées russes. Avec le siège, les journalistes internationaux quittent la ville, seuls Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka, journalistes ukrainiens à l’agence Associated Press, décident de rester.
Durant 20 jours, les deux journalistes ont documenté à travers leurs images la guerre qui s’installe à Marioupol. Les reporters sont au contact de la population ukrainienne essayant de survivre comme eux dans un environnement des plus hostiles. Ils ont vécu coupé du monde pendant ces 20 jours, sans électricité et en quête perpétuelle d’un fragment de réseau afin d’envoyer au monde entier leurs images quotidiennes. Pour eux, il s’agit d’un document pour l’histoire qui sert de témoignage sur la réalité de la guerre. Filmer la guerre n’est pas sans danger, la violence augmente crescendo sous les bombardements constants des troupes russes sur la ville. Dans cette tragédie humaine, le journalisme est bien plus qu’un témoignage, il est une aide précieuse pour les individus isolés de leurs proches, leurs permettant de dire au reste du monde ce qu’il se passe.
Après 20 jours passés à Marioupol, les deux reporters n’ont d’autres choix que de partir face à la menace d’être arrêtés, torturés et contraints par l’armée russe à dire publiquement que ces images sont fausses. Les images des journalistes de l’Associated Press font rapidement le tour des télévisions du monde ce qui gêne fortement le Kremlin et sa propagande. Dans cette guerre de l’information, les autorités russes vont jusqu’à affirmer que les images de Marioupol ne sont que le fruit d’un plateau de cinéma établi dans la ville et les victimes de simples acteurs. Au quinzième jour à Marioupol, les journalistes sont pris pour cible alors qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’hôpital N°2, un site encerclé par l’armée russe.
Des images sans filtre dénonçant une violence absolue
« C’est douloureux à regarder, mais nécessaire. »
Les images chocs de 20 Jours à Marioupol dénoncent les différentes formes de violence qui sont utilisées pour assiéger la ville et qui ciblent directement les civils. Le documentaire a vocation à être diffusé à grande échelle, dans cette volonté il est disponible gratuitement sur le site France.TV.
Le film s’ouvre sur le portrait d’une vieille dame en pleurs qui ne comprend pas ce qui est en train d’arriver à la ville de Marioupol au premier jour de la guerre. Le journaliste cherche à la rassurer en disant « Rentrez et restez chez vous, ils ne tirent pas sur les civils ». Rapidement ce quartier résidentiel est bombardé, l’idée que les Russes ne visent pas les civils ukrainiens s’est révélée entièrement fausse : « J’avais tort, reprend le reporter. Je lui présente mes excuses. ». Durant ces 20 jours, les bombardements des habitations se multiplient avec l’avancée progressive de l’armée russe dans la ville. Marioupol est encerclée par l’armée ne laissant aucune porte de sortie aux civils et rendant des plus complexes la tenue de couloirs humanitaires. Ainsi, les 450 000 personnes vivant à Marioupol sont isolées du reste du monde et réduites au silence.
Les deux reporters passent ensuite quelques jours au coeur des hôpitaux de la ville où ils assistent à des scènes déchirantes. Les urgences sont sous une extrême pression avec des blessés toujours plus nombreux sans compter les pénuries en médicaments et antalgiques. Les enfants font partie des nombreuses victimes de ce siège. Une petite fille de quatre ans meurt sous la caméra des journalistes témoignant de la cruauté humaine de la guerre. Les médecins demandent aux reporters de filmer ces moments, de les diffuser afin de montrer au monde entier comment les Russes protègent les civils ukrainiens. Les urgences sont elles-même ciblées par les bombardements russes. Les reporters révèlent aux yeux du monde le bombardement de la maternité de Marioupol le 9 mars 2022. Si les blessés sont nombreux, les morts se multiplient. Les journalistes montrent l’entassement des cadavres dans les morgues et sous-sols des hôpitaux de la ville. Les employés municipaux sont contraints de creuser des fosses communes pour y enterrer les corps qui se propagent dans les rues de la ville.
La presse et la guerre, une longue histoire en perpétuelle évolution
« Celui qui gagne la guerre de l’information gagnera la guerre psychologique. »
Les médias ont dès le XXe siècle entretenu une certaine relation avec les conflits armés. Les belligérants ont pour habitude d’instrumentaliser la presse à des fins politiques de propagande, leurs permettant de légitimer leur cause et leurs actions. Une réelle guerre de l’information se met alors en place pour conquérir l’opinion publique.
La Guerre du Vietnam (1955-1975) a été la première guerre dont les images ont été largement diffusées à la télévision. Certains experts parlent de la première « living room war », guerre des salons, avec des images violentes diffusées de façon quotidienne aux informations envahissant ainsi les foyers américains. De nombreux reporters ont été présents sur place aux côtés de l’armée américaine pour filmer la réalité de la guerre. Néanmoins, filmer la guerre pose diverses questions déjà à cette époque : la banalisation de la violence est pointée du doigt, la présence de la presse déstabilise les soldats, seules les actions menées par les États-Unis sont filmées ayant donc de réelles répercussions sur l’opinion publique. La série de Zev Braun l’Enfer du devoir met en scène la présence des journalistes lors de la guerre du Vietnam.
La relation entre les médias et la guerre a connu un point de bascule avec l’émergence d’internet et des réseaux sociaux. Avec ces outils de communication, les soldats n’hésitent pas à enfreindre la loi en se filmant et diffusant eux-mêmes les images de la guerre. Sur les réseaux sociaux sont diffusées en direct les opérations militaires. Cette diffusion massive et accessible de la guerre pose cependant une réelle problématique autour de la diffusion massive de fausses informations.
20 Jours à Marioupol et la spécialité HGGSP
Le documentaire 20 Jours à Marioupol peut faire l’objet d’un usage lié à la spécialité HGGSP au lycée. Le film peut être traité lors du thème de première « S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication ». Il est possible de rapprocher le documentaire de la question des médias et de leur rôle en temps de guerre.
Aussi, il est envisageable d’aborder 20 Jours à Marioupol en terminale avec le thème « histoire et mémoire » autour du rôle des images dans la construction mémorielle et la justice des conflits armés le réalisateur affirmant « Je souhaite que la Russie soit dénoncée pour avoir tué des dizaines de milliers de mes compatriotes ukrainiens. ».
Enfin, le film peut être utilisé avec le thème « faire la guerre, faire la paix » en étant un support d’étude de la guerre autour de ses différentes notions et évolutions. La guerre en Ukraine est une guerre classique entre États autour d’enjeux territoriaux et politiques.
L’épreuve du grand oral est aussi l’occasion de mettre en avant ce film et les différents aspects du programme de HGGSP.
20 Jours à Marioupol, en libre accès
Le documentaire est disponible en libre accès sur le site France TV. De nombreux cinémas proposent également des séances spéciales du film suivies généralement d’un débat.
Pour aller plus loin :
• La série L’enfer du devoir et la HGGSP : https://cinehig.clionautes.org/films-et-series-pour-lapremiere-specialite-hggsp.html
• Interview de Paolo Modugno sur le film :
• Lien direct vers le film : https://www.france.tv/films/longs-metrages/5707716-20-jours-amarioupol.html
• Interview du réalisateur : https://www.france.tv/documentaires/societe/5737941-interview-demstyslav-tchernov-realisateur-de-20-jours-a-marioupol.html