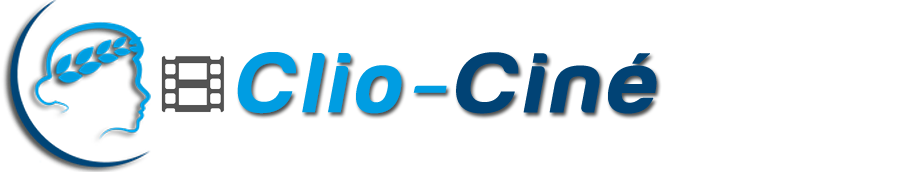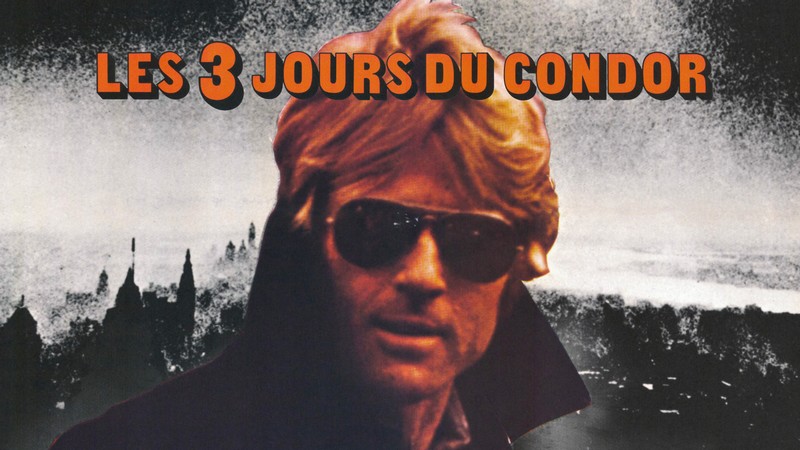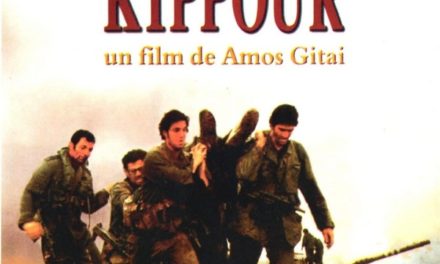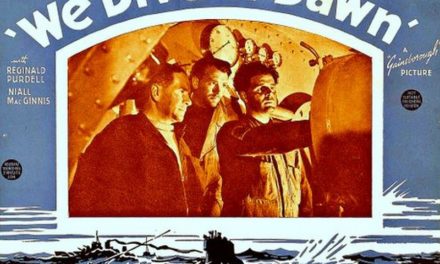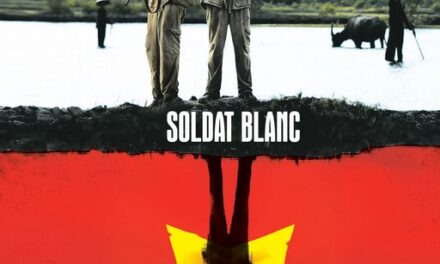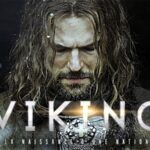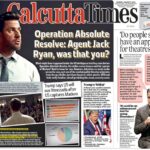Ainsi donc, Robert Redford, héros ordinaire dans Les trois jours du Condor, nous a quittés. L’Amérique perd l’un de ses derniers héros solaires, celui qui incarnait encore, dans les années 70, une certaine idée de l’intégrité face au pouvoir. Une star qui l’est devenue non point à coup de vidéos sur les réseaux sociaux, même si ses « meme » sont devenus légendaires, mais par son talent, ses convictions, ses combats.
Quelle ironie du sort que de voir partir l’homme qui, plus que tout autre, aura donné corps à la défiance américaine envers ses propres institutions, alors même que le locataire de la maison Blanche semble bien décidé à pousser plus loin que jamais les pires travers de Nixon !
Alors que les hommages se multiplient, ce sont souvent les mêmes titres qui reviennent, à commencer par Out of Africa. Mais pour moi Robert Redford ce sont les années 70, la décennie paranoïaque. Dans cette perspective Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack s’impose comme un must. Non pas tant pour ses qualités cinématographiques – quoique indéniables – mais pour ce qu’il révèle de l’âme américaine à un moment charnière de son histoire. Et aussi parce qu’il me parle pour des raisons bien plus personnelles.
En cette période où les deepfakes saturent nos écrans et où chaque révélation géopolitique semble sortir d’un scénario hollywoodien, il est temps de revisiter cette œuvre prophétique qui, il y a près de cinquante ans, posait déjà toutes les bonnes questions sur la surveillance, les opérations clandestines et la manipulation de l’information par l’État.
Un thriller né dans les décombres de l’innocence américaine
Sorti en 1975, Les Trois Jours du Condor arrive pile au moment où l’Amérique traverse sa plus grave crise de conscience depuis la Guerre de Sécession. Nixon a démissionné en août 1974 – première dans l’histoire présidentielle américaine – et les derniers hélicoptères ont quitté Saïgon en avril 1975. Entre temps, le premier choc pétrolier de 1973 a révélé brutalement la dépendance énergétique du pays : le prix du baril quadruple en quelques mois, passant de 3 à 12 dollars, et les files d’attente devant les stations-service deviennent le symbole d’une puissance américaine soudain fragilisée.
Sydney Pollack et Robert Redford – leur quatrième collaboration après Propriété interdite, Jeremiah Johnson (qui va en faire un meme absolu sur les réseaux sociaux) et Nos plus belles années – s’emparent du roman de James Grady Six Days of the Condor pour en faire un concentré de toutes les angoisses de l’époque. Le passage de six à trois jours dans le titre n’est pas anodin : il faut resserrer l’étau, accélérer le rythme, car l’Amérique découvre que ses ennemis les plus redoutables se trouvent peut-être dans ses propres rangs.
Joseph Turner, alias « Condor« , travaille dans une section ultra-secrète de la CIA déguisée en « Société de Littérature Américaine« . Sa mission ? Décrypter les romans d’espionnage pour y détecter d’éventuelles fuites ou techniques utilisables. Métaphore parfaite de cette époque où la fiction et la réalité se mélangent dangereusement, où l’art devient un outil de renseignement. Forcément à titre personnel, rien que cette approche assure mon intérêt.
Mais quand Turner découvre tous ses collègues massacrés pendant sa pause déjeuner, il bascule d’un coup du côté des traqués.
Pollack, maître de l’angoisse urbaine
Visuellement, le film fonctionne comme un piège qui se referme. Owen Roizman, directeur de la photographie, baigne New York dans une lumière blafarde qui transforme la ville en labyrinthe hostile. Les tours jumelles toisent cette foule qui se presse au rythme d’une musique typique des années 70. Dave Grusin livre une partition qui résume à elle seule l’esthétique musicale de cette décennie, dans un style jazz-fusion, alors en plein essor, mélange habile d’instruments acoustiques et de synthétiseurs naissants. Chaque plan semble épié, chaque reflet dans une vitrine peut dissimuler un danger, chaque voiture pourrait nous renverser. Pollack maîtrise parfaitement les codes du film paranoïaque : la caméra scrute, filme à distance, suggère plus qu’elle ne montre, c’est du grand art.
Contrairement à ses prédécesseurs dans le genre – pensons au Un crime dans la tête de Frankenheimer – Les Trois Jours du Condor ne désigne pas d’ennemi extérieur clairement identifiable. Pas de communistes, pas d’aliens, pas même de mafieux. L’ennemi, c’est le système lui-même, c’est cette CIA qui se retourne contre ses propres agents pour protéger des opérations que même ses dirigeants officiels ignorent.
Max von Sydow, génial en tueur professionnel amateur de petits soldats de plomb de la période napoléonienne, incarne cette nouvelle figure du mal : l’exécutant froid et cultivé, presque courtois, qui philosophe sur son métier entre deux meurtres. « Je ne m’intéresse pas aux raisons, monsieur Turner. Je m’intéresse seulement au fait qu’il y a des raisons. » Cette réplique résume parfaitement l’époque : les individus ne sont plus que des pions dans des stratégies qu’ils ne comprennent pas.
Le pétrole comme révélateur géopolitique
Mais attention à ne pas se laisser hypnotiser par la mécanique du thriller. Car au cœur de l’intrigue, Pollack place un enjeu éminemment contemporain : le contrôle des ressources énergétiques. Quand Turner découvre enfin la vérité, l’explication donnée par Cliff Robertson (Higgins) est d’une actualité saisissante :
« It’s simple economics. Today it’s oil, right? In ten or fifteen years, food. Plutonium. Maybe even sooner. Now, what do you think the people are gonna want us to do then? »
Cette réplique, il faut la mesurer à l’aune du premier choc pétrolier qui vient de frapper de plein fouet les États-Unis. En octobre 1973, suite à la guerre du Kippour et au soutien américain à Israël, l’OPEP impose son embargo pétrolier. Soudain, l’Amérique découvre sa dépendance : elle qui atteignait son pic de production pétrolière en 1971 se retrouve à la merci de pays qu’elle considérait encore comme des « stations-service » quelques années plus tôt.
Le film de Pollack anticipe avec une prescience troublante les dérives à venir. Cette économie simple invoquée par Higgins, nous la retrouverons dans toutes les interventions militaires américaines des décennies suivantes, du Golfe à l’Irak. Le plan pétrolier fictif du film préfigure les véritables stratégies de contrôle des ressources que mettra en œuvre Washington.
La CIA, laboratoire de la raison d’État
Plus troublant encore, Les Trois Jours du Condor dévoile les mécanismes d’une CIA en roue libre. Car l’opération que découvre Turner n’émane pas des instances dirigeantes officielles de l’Agence, mais d’une faction interne qui agit selon sa propre logique. Nous voilà face à ce que les politologues appelleront plus tard l’État profond – cette nébuleuse d’intérêts bureaucratiques, économiques et sécuritaires qui développe sa propre agenda, indépendamment du pouvoir politique élu.
Le « plan pétrolier » révélé dans le film s’inscrit parfaitement dans ce que les géostratèges appellent le « Grand Jeu » – cette partie d’échecs planétaire où les grandes puissances déplacent leurs pions pour contrôler les zones névralgiques. Halford Mackinder parlait déjà du pivot géographique de l’histoire, mais c’est Nicholas Spykman qui, dans les années 40, théorise le contrôle du Rimland – cette ceinture maritime qui entoure l’Eurasie et dont le Moyen-Orient constitue un segment crucial.
Quand Zbigniew Brzezinski publiera Le Grand Échiquier en 1997, il ne fera que systématiser ce que le film de Pollack anticipait déjà : l’obsession américaine pour le contrôle des « États pivots » et des ressources énergétiques. Le conseiller de Carter – qui prendra ses fonctions en 1977, deux ans après la sortie du film – appliquera d’ailleurs cette logique dans sa gestion de la crise iranienne et son soutien aux moudjahidines afghans contre l’URSS.
Cette représentation n’a rien de fantaisiste. Elle s’appuie sur une réalité que les révélations post-Watergate commencent à mettre au jour. En 1975, la Commission Church du Sénat enquête sur les activités de la CIA et révèle au grand public l’ampleur des opérations clandestines : tentatives d’assassinats de dirigeants étrangers, expériences de manipulation mentale (programme MK-Ultra), surveillance illégale de citoyens américains…
Le personnage de John Houseman – Mr. Wabash, patron occulte de l’opération – incarne parfaitement cette technocratie de l’ombre qui pense le monde comme un plateau de Risk géant. Cet homme élégant et cultivé, qui évoque autant Henry Kissinger que les futurs wise men de la politique étrangère américaine, dirige ses pions depuis les beaux quartiers de Washington avec la certitude tranquille de servir les intérêts supérieurs du pays. Sa froide explication du « plan pétrolier » résonne comme un cours de géopolitique appliquée : contrôler les ressources, c’est contrôler les nations qui en dépendent.
Il y a quelque chose de fascinant à voir Turner – le geek nourri de comics et de romans d’espionnage – découvrir que les vrais maîtres du jeu appliquent littéralement les théories qu’il ne connaît que par la fiction populaire. Sauf que dans la réalité, les conséquences des coups sur l’échiquier ne sont pas virtuelles : elles se mesurent en vies humaines et en déstabilisations régionales.
Turner le geek : quand la pop culture sauve l’intellectuel
Mais voici peut-être l’aspect le plus personnel de mon attachement à ce film – et le plus prémonitoire – du personnage de Turner : sa relation intime avec la culture populaire. Car attention, Joseph Turner n’est pas un agent d’élite formé à Langley. C’est un rat de bibliothèque, un dévoreur de romans d’espionnage, un amateur de bandes dessinées qui garde précieusement ses comics de Dick Tracy dans son bureau. C’est un Geek, fidèle au roman original.
Cette passion pour la pop culture n’est pas un détail anecdotique. Elle constitue le cœur même de sa capacité de survie. Quand le monde réel bascule dans la violence et la paranoïa, Turner puise dans son imaginaire nourri de fictions populaires les schémas mentaux qui vont lui permettre de comprendre ce qui lui arrive. Il reconnaît les codes du thriller parce qu’il en a lu des centaines. Il anticipe les retournements de situation parce que Dick Tracy l’a préparé à déjouer les pièges des méchants.
Là où ses supérieurs hiérarchiques – ces technocrates aux diplômes prestigieux – pensent en termes de géostratégie et de rapport de forces, Turner applique une logique narrative populaire. Il pourrait se demander en off : « Si j’étais dans un roman de John le Carré, que ferait le héros à ma place ? » Cette approche décalée, loin des grilles de lecture académiques, lui permet paradoxalement de mieux comprendre la réalité de ce qu’il vit. Robert Redford excelle à incarner cette approche.
La mise en abyme est saisissante : Turner survit parce qu’il a appris à décoder les récits d’espionnage, et nous, spectateurs, comprenons l’intrigue parce que Pollack utilise les codes de ces mêmes récits. La fiction éclaire la réalité qui s’inspire de la fiction qui révèle la vérité… Nous voilà au cœur de ce que les théoriciens de la postmodernité appelleront plus tard l’hyperréalité.
Cette dimension préfigure notre époque avec une prescience troublante. Combien de lanceurs d’alerte contemporains – des Anonymous aux leakers de WikiLeaks – se sont-ils nourris de culture geek pour développer leur conscience critique ? Combien de révélations sur la surveillance de masse ont-elles été anticipées par la science-fiction ? Edward Snowden lui-même n’était-il pas un passionné d’informatique et de culture numérique avant de devenir le plus célèbre espion du XXIe siècle ?
Turner incarne cette figure nouvelle : l’intellectuel geek qui tire sa force de sa marginalité culturelle. Face aux manipulateurs en costume-cravate qui évoluent dans les cercles du pouvoir, il oppose une forme de résistance par la culture « basse ». Ses références ne sont pas uniquement Clausewitz ou Machiavel, mais les héros de papier qui ont bercé son enfance américaine.
Et c’est là que réside le génie de l’œuvre littéraire et de son adaptation cinématographique : montrer que la culture populaire peut être un outil d’émancipation intellectuelle plus efficace que la culture élitiste. Les romans d’espionnage que lit Turner contiennent plus de vérités sur le fonctionnement réel du pouvoir que les manuels de sciences politiques. Dick Tracy, avec ses méchants aux motivations claires et ses bons aux motivations pures, offre une grille de lecture plus pertinente que les analyses géopolitiques byzantines.
Cette leçon résonne avec une force particulière à notre époque de démocratisation culturelle par Internet. Combien de citoyens développent-ils aujourd’hui leur compréhension du monde à travers des séries, des mangas, des jeux vidéo, des memes ? La pop culture est devenue notre mythologie contemporaine, notre façon collective de donner du sens au chaos de l’information.
Redford, incarnation de l’Américain moyen face au Léviathan
Robert Redford trouve dans Les Trois Jours du Condor l’un de ses rôles les plus aboutis à mon sens. Son Joseph Turner n’est ni un héros d’action ni un génie de l’espionnage, mais un intellectuel casanier projeté malgré lui dans un monde de violence. Il est ordinaire et c’est crucial : Redford incarne l’Américain moyen découvrant l’envers du décor de son propre pays.
Mais cet Américain moyen a ceci de particulier qu’il possède une culture alternative, décalée, qui va s’avérer être sa planche de salut. Turner ne survit pas grâce à son entraînement militaire ou ses relations dans les services – il n’en a pas. Il survit grâce à son imagination nourrie de récits populaires, grâce à sa capacité à lire les situations comme s’il s’agissait de fictions.
Sa romance avec Kathy Hale (Faye Dunaway) – qu’il kidnappe d’abord avant de la séduire – pose évidemment problème par les standards contemporains. À dire vrai c’est le point faible du film. Elle n’apporte pas grand-chose et son rôle de femme qui tombe très vite dans les bras du bel intellectuel, pourrait sans doute aujourd’hui poser quelques questions. Mais au-delà de ces considérations, cette relation peut fonctionner comme une métaphore de la société civile prise en otage par les appareils sécuritaires. Kathy représente l’Amérique paisible et insouciante, brutalement confrontée à une réalité qu’elle préférait ignorer.
La scène finale, sur les marches du New York Times, constitue l’un des moments les plus marquants du cinéma politique américain. Turner révèle toute l’affaire au journal, mais l’échange avec Higgins laisse planer le doute :
– Ils l’imprimeront ? – Qu’est-ce qui vous fait croire qu’ils l’imprimeront ?
Cette interrogation sur le pouvoir réel de la presse face aux appareils d’État résonne étrangement aujourd’hui, à l’heure où l’information se fragmente et où la notion même de vérité factuelle vacille.
Un laboratoire pour comprendre les enjeux contemporains
Pour les classes de Première – HGGSP : comprendre un régime politique : la démocratie
Les Trois Jours du Condor offre un support d’une richesse exceptionnelle pour analyser les tensions au cœur des démocraties contemporaines. Le film permet d’aborder concrètement la question des contre-pouvoirs : quel rôle jouent les médias face aux dérives sécuritaires ? Comment les institutions démocratiques peuvent-elles contrôler leurs propres appareils de renseignement ?
L’intrigue soulève des questions d’une actualité brûlante : jusqu’où l’État peut-il aller au nom de la sécurité nationale ? Quelle légitimité ont les opérations clandestines dans un État de droit ? Le personnage de Turner, révélant l’affaire à la presse, illustre parfaitement le dilemme contemporain entre secret défense et transparence démocratique.
Exploitation pédagogique concrète :
- Étude comparative avec l’affaire Snowden : dans les deux cas, un agent découvre des opérations qu’il juge contraires aux valeurs démocratiques
- Débat argumenté : les révélations de presse sont-elles toujours compatibles avec la sécurité nationale ?
- Analyse de documents : comparer les méthodes de surveillance représentées dans le film avec les pratiques actuelles (NSA, DGSE…)
Pour les classes de Première – HGGSP : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
La mise en abyme est saisissante : Turner travaille pour la CIA en analysant des romans d’espionnage, et le spectateur découvre les rouages de l’espionnage à travers un film inspiré d’un roman. Cette circularité interroge directement les rapports entre fiction et réalité dans la construction de l’information.
L’enjeu de la culture populaire comme outil de décryptage devient ici central pour les élèves. Comment la pop culture – comics, séries, mangas, jeux vidéo – influence-t-elle notre compréhension des enjeux contemporains ? Turner tire sa lucidité de sa culture geek : ne peut-on pas y voir une métaphore de notre époque où les citoyens s’informent autant par les memes que par les journaux, autant par les séries que par les documentaires ?
Le film questionne également les sources : qui détient la vérité ? Turner dispose-t-il de suffisamment d’éléments pour révéler l’affaire ? Higgins ment-il quand il présente le « plan pétrolier » comme une opération de survie nationale ? Ces interrogations préparent parfaitement les élèves à l’analyse critique des sources et à la compréhension des enjeux contemporains de la désinformation.
Activité pratique testée avec des élèves : demander aux élèves d’analyser comment une série contemporaine (House of Cards, 24, Homeland…) influence leur perception de la politique. Puis organiser une simulation où ils jouent alternativement les rôles de journalistes enquêteurs, d’agents de renseignement et de responsables politiques autour d’une affaire fictive inspirée de l’univers de leurs séries préférées. L’exercice permet de comprendre concrètement comment la fiction façonne notre grille de lecture du réel.
Pour les classes de Terminale – HGGSP : Thème de la Connaissance // questionnement sur les évolutions de la puissance
Les Trois Jours du Condor illustre parfaitement les mutations de la puissance américaine dans les années 70. Le plan pétrolier évoqué dans le film préfigure les stratégies de contrôle des ressources énergétiques que développeront les États-Unis dans les décennies suivantes.
Le film permet d’analyser les liens entre enjeux énergétiques et stratégies géopolitiques : comment le premier choc pétrolier de 1973 a-t-il modifié l’approche américaine du Moyen-Orient ? En quoi la dépendance énergétique constitue-t-elle un facteur de vulnérabilité pour les grandes puissances ?
Ouverture comparative : mettre en parallèle les préoccupations énergétiques américaines des années 70 avec les enjeux contemporains autour des terres rares, de l’indépendance numérique ou de la transition écologique. Les mêmes mécanismes de dépendance/autonomie se retrouvent-ils aujourd’hui dans d’autres domaines ? La Chine d’aujourd’hui ne joue-t-elle pas le même rôle que l’OPEP des années 70, mais avec les semi-conducteurs et les métaux rares ?
Résonances contemporaines et prolongements
Le génie du film réside dans sa capacité à anticiper les dérives qui marqueront les décennies suivantes. Le film préfigure l’ère post-11 septembre, où la « guerre contre le terrorisme » justifiera l’extension considérable des pouvoirs de surveillance. Il annonce les révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage de masse, les débats autour des « programmes noirs » de la CIA, la militarisation de la politique énergétique américaine.
Mais plus encore, il anticipe l’émergence d’une génération de résistants geeks qui utilisent leur culture populaire comme outil de décryptage du monde contemporain. Des hacktivistes d’Anonymous aux youtubeurs d’enquête, des créateurs de memes politiques aux influenceurs engagés, tous puisent dans un imaginaire nourri de fictions pour comprendre et critiquer le réel.
Filmographie complémentaire pour approfondir Les trois jours du Condor :
- Les Hommes du Président (Pakula, 1976) : pour comprendre le rôle du journalisme d’investigation dans la démocratie américaine
- Conversation secrète (Coppola, 1974) : sur les dérives de la surveillance technologique
- WarGames (Badham, 1983) : le premier film à montrer un adolescent geek affrontant l’appareil militaro-industriel
- JFK (Stone, 1991) : pour une vision plus polémique mais stimulante des zones d’ombre du pouvoir américain
- « Mr. Robot« (série, 2015-2019) : l’héritage direct de Turner dans l’ère numérique
Et si on transposait cette histoire en 2025 : serait-il un analyste de données ? Un modérateur de contenu ? Un développeur découvrant une backdoor gouvernementale ? Comment sa passion pour la pop culture l’aiderait-elle à survivre dans l’écosystème numérique contemporain ? Cette transposition permet de mesurer l’évolution du paysage médiatique et de ses enjeux, tout en valorisant la culture geek des élèves comme outil de compréhension du monde.
Condor, l’adaptation en série, offre une excellente base de réflexion complémentaire.
L’héritage de Redford : l’art de résister par l’image
Robert Redford nous laisse bien plus qu’une filmographie. À travers nombre de ses films il aura incarné une certaine idée de la résistance civique face aux manipulations du pouvoir. Ses personnages ne sont jamais des héros au sens traditionnel, mais des citoyens ordinaires qui refusent de fermer les yeux sur les compromissions de leur époque.
Avec Turner, Redford pousse cette logique encore plus loin : il incarne le geek avant la lettre, celui qui tire sa force de sa marginalité culturelle, qui transforme sa passion pour la sous-culture en outil de résistance politique. En cela, Les Trois Jours du Condor peut être lu comme un manifeste : la pop culture n’est pas un opium du peuple, mais un arsenal intellectuel pour qui sait s’en servir.
Cette leçon résonne avec une force particulière aujourd’hui, où la multiplication des sources d’information s’accompagne paradoxalement d’une crise de la vérité factuelle. Turner nous rappelle que la vigilance démocratique n’est jamais acquise, qu’elle doit sans cesse se réinventer face aux nouveaux défis technologiques et géopolitiques. Et que parfois, un comic de Dick Tracy en apprend plus sur le monde que tous les briefings de la CIA.
Alors oui, l’Amérique a perdu l’un de ses derniers héros solaires. Mais elle garde, gravées dans la mémoire collective, ces images d’un homme seul face aux appareils d’État, armé seulement de ses bouquins et de son imagination, choisissant la vérité contre la raison d’État. Dans notre époque de fake news et de surveillance numérique, ce message n’a jamais été aussi actuel.
Au fond, nous sommes tous des Turner traqués dans les rues de nos démocraties fragiles, nos smartphones pleins de memes et de séries. À nous de choisir si nous préférons scroller passivement ou révéler l’affaire au New York Times de notre époque. Dick Tracy nous regarde.
Fiche technique
Dino De Laurentiis Company, Paramount Pictures / 1975/ 1h 57min / Drame, Espionnage
Titre original Three Days of the Condor
Réalisateur : Sidney Pollack
Scénariste : Lorenzo Semple, Jr. David Rayfiel (en)
Musique : Dave Grusin
Avec Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow