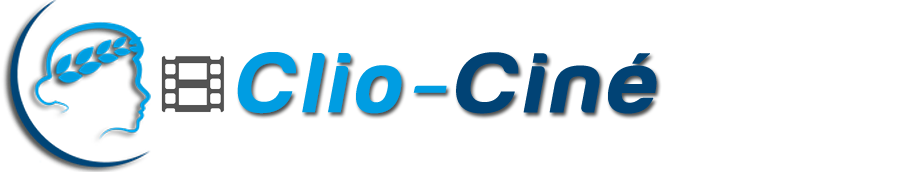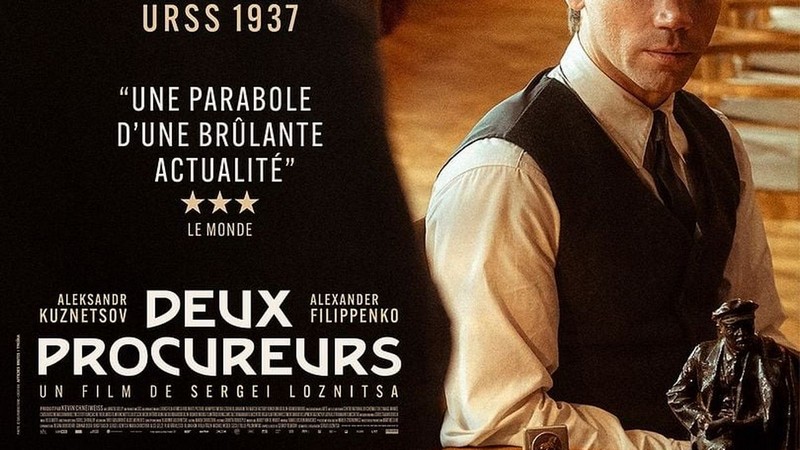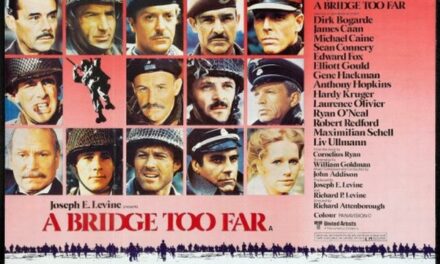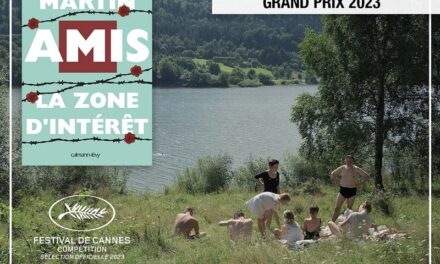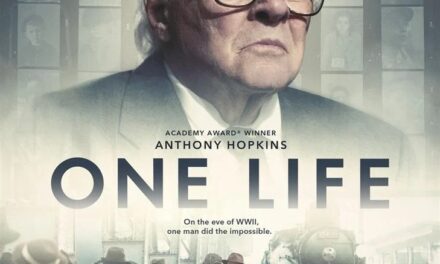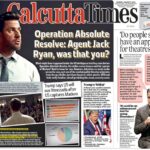Le 5 novembre 2025 marque l’arrivée dans les salles d’une œuvre aussi nécessaire que dérangeante. Sergei Loznitsa, avec Deux procureurs, nous confronte à l’un des chapitres les plus sombres du XXe siècle : la Grande Terreur stalinienne de 1937-1938. Alors que les questions de justice, d’État de droit et de totalitarisme traversent nos programmes et notre actualité, ce film interroge avec une rigueur kafkaïenne les mécanismes d’un système qui broie l’individu au nom d’une idéologie devenue folle.
Synopsis
Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Écrite avec du sang sur un morceau de carton, cette requête exceptionnelle pousse ce jeune bolchevique intègre à se démener pour rencontrer le prisonnier, Ivan Spetniak, victime des agents de la police secrète, la NKVD. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur général Andreï Vyshynsky à Moscou. À l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.
Quand la nouvelle rattrape le cinéma
Deux procureurs trouve son origine dans une nouvelle écrite en 1969 par Gueorgui Demidov, physicien et victime des Grandes Purges. Après avoir passé de nombreuses années dans les camps de la Kolyma en Sibérie, qu’il définit comme un Auschwitz sans les chambres à gaz
, Demidov ne sera réhabilité qu’en 1958. Ses manuscrits circulent alors sous forme de samizdat, ces textes clandestins diffusés sous le manteau dans l’URSS brejnévienne. Il ne sera édité que de manière posthume et incomplète dans les années 1990.
Cette adaptation cinématographique s’inscrit dans la filmographie cohérente de Sergei Loznitsa, réalisateur ukrainien né en 1964 en Biélorussie soviétique. Diplômé du prestigieux VGIK en 1997, Loznitsa a d’abord travaillé comme documentariste avant de se tourner vers la fiction. Il avait déjà abordé la question des purges staliniennes avec Le Procès (2017), documentaire constitué d’archives d’un procès-spectacle, dont Deux procureurs constitue le pendant fictionnel.
Pour Loznitsa, comme il l’explique dans ses entretiens, la question centrale reste celle de la survivance dans un système totalitaire où il faut toujours faire un pas de côté, ce qui suppose une certaine duplicité ou une fracture de la personnalité
. Cette réflexion traverse tout le film et donne sa force à la trajectoire du jeune procureur Kornev.
Un cercle infernal : de l’idéalisme à la désillusion
La force du film réside dans sa construction rigoureusement circulaire. L’ouverture montre des prisonniers détruisant les lettres de leurs codétenus. La fermeture montre Kornev, devenu prisonnier à son tour, franchissant les mêmes portes pour ne plus en ressortir. Entre ces deux moments, le spectateur accompagne la descente aux enfers d’un homme qui croyait servir la justice et découvre progressivement l’ampleur de la machine à broyer.
Le personnage d’Alexandre Kornev incarne l’idéaliste trahi. Jeune procureur fraîchement diplômé, bolchevique convaincu, il croit sincèrement à un dysfonctionnement du système. Son parcours le confronte à une série d’obstacles qui révèlent progressivement la nature systémique de la terreur : attente interminable dans les bureaux, menaces voilées, regards pesants, questions indiscrètes. Chaque séquence resserre l’étau autour de lui.
Loznitsa opère des choix de mise en scène d’une rigueur remarquable : photographie en noir, gris, brun, bleu foncé, blanc et rouge sang ; plans fixes qui encadrent les personnages dans des espaces de plus en plus étouffants, d’une cellule de prison, au wagon d’un train, en passant par les couloirs et salles d’attente. Spatialement la machine bureaucratique communiste écrase littéralement les personnages. La séquence de la visite au prisonnier Spetniak constitue le cœur ténébreux du film : vingt minutes dans les méandres de la prison, cadrages oppressants, confession d’un héros de la Révolution devenu ennemi du peuple
. Y répond avec brio le voyage en train dans un wagon bondé, animé par le récit pathétique du vieux soldat qui a été délaissé par mépris par Lénine, le héros fantasmé de la Révolution.
Kafka en URSS : l’absurde totalitaire
L’ombre de Kafka plane sur le film, comme le reconnaît Loznitsa lui-même : Kafka s’est invité tout seul
. Le procureur K., comme Joseph K., tient à comprendre et rationaliser l’impensable. Sa recherche du bureau du Procureur Général à Moscou devient une odyssée absurde où chaque geste peut se révéler une erreur. Lorsque Kornev ramasse par correction les feuilles tombées du dossier d’une jeune femme dans un escalier, l’activité bourdonnante se fige soudainement autour de lui, comme si le monde entier le guettait.
Cette dimension grotesque trouve son expression dans plusieurs scènes : le vieux combattant qui raconte sa rencontre décevante avec Lénine dans un train, les deux ingénieurs
qui fraternisent avec Kornev avant de se révéler agents du NKVD. Le film alterne moments de terreur implacable et passages apparemment plus légers, créant un malaise constant.
La rencontre finale avec le Procureur Général Vyshynsky (personnage historique) cristallise cette dimension kafkaïenne. La distance physique entre les deux hommes, accentuée par une longue table de réunion, symbolise l’abîme qui sépare l’individu du pouvoir totalitaire. Vyshynsky, impassible sous le buste de Staline, considère le petit morceau de carton écrit au sang avec le même détachement qu’un dossier administratif quelconque.
L’URSS de 1937 : anatomie d’un régime totalitaire
Le film offre une plongée dans l’URSS de 1937, à l’apogée de ce que les historiens nomment la Grande Terreur ou Iejovchtchina (du nom de Nikolaï Iejov, chef de la NKVD). Cette période, qui s’étend de 1936 à 1938, voit l’arrestation de plus d’un million de personnes, dont environ 700 000 seront exécutées. Les purges visent d’abord les cadres du Parti communiste, puis s’étendent à l’ensemble de la société soviétique.
Le système du NKVD
La police politique, héritière de la Tchéka léniste, dispose de pouvoirs illimités. Elle peut arrêter sans mandat, torturer pour obtenir des aveux, condamner sans procès. Le film montre comment le NKVD constitue un État dans l’État, au-dessus même de la justice officielle que représente Kornev.
Les aveux
Point central de la terreur stalinienne, les aveux sont obtenus par la torture physique et psychologique. Le film suggère ces pratiques sans les montrer frontalement, créant un hors-champ d’autant plus oppressant. Ces aveux permettent au régime de donner une apparence de légalité à la répression et de nourrir la paranoïa collective en prouvant
l’existence de complots contre-révolutionnaires.
La foi brisée
Kornev incarne ces communistes convaincus qui découvrent progressivement la trahison de leurs idéaux. Le prisonnier Spetniak, héros de la Révolution et de la guerre civile, représente cette génération sacrifiée. L’ironie tragique du terme justice communiste
, prononcé par un détenu, résonne comme une condamnation sans appel.
L’atmosphère de suspicion généralisée
Chaque regard, chaque parole, chaque geste peut vous condamner. Le film restitue magistralement cette ambiance où personne ne peut faire confiance à personne, où les dénonciations alimentent la machine répressive. D’ailleurs assez vite il n’est fait aucun mystère de ce qui attend Kornev.
Le contexte historique : 1937, année de tous les dangers
Pour comprendre la Grande Terreur, il faut replacer 1937 dans le contexte plus large de la construction du stalinisme. Depuis l’assassinat de Kirov en décembre 1934, Staline a entrepris d’éliminer tous les opposants potentiels à son pouvoir absolu. Les grands procès de Moscou (1936-1938) mettent en scène la confession
publique de figures historiques du bolchevisme comme Zinoviev, Kamenev ou Boukharine, accusés de trahison et de complot.
Mais 1937 marque une escalade quantitative et qualitative. Les arrestations ne visent plus seulement les cadres politiques mais touchent l’ensemble de la société : ingénieurs, militaires (la purge de l’Armée rouge décapite l’état-major avant la Seconde Guerre mondiale), écrivains, artistes, simples citoyens. Les quotas d’arrestations sont fixés par Moscou et les exécuteurs locaux rivalisent de zèle pour les dépasser.
Le film illustre également les opérations nationales
qui ciblent certains groupes ethniques soupçonnés de former une cinquième colonne
. Cette dimension préfigure les déportations massives de populations entières pendant la Seconde Guerre mondiale.
Enjeux mémoriels : contre l’oubli et le révisionnisme
La sortie de Deux procureurs intervient dans un contexte de recul mémoriel inquiétant. L’association Memorial, prix Nobel de la paix 2022, a été interdite en Russie en 2021. Cette organisation, créée à la fin des années 1980, s’était donné pour mission de documenter les crimes du stalinisme, de préserver la mémoire des victimes et de défendre les droits de l’homme.
L’interdiction de Memorial s’inscrit dans une politique plus large de réhabilitation de Staline menée par le régime de Vladimir Poutine. Les manuels scolaires russes minimisent désormais les purges, présentent Staline comme un dirigeant efficace
ayant modernisé
le pays. En Russie, il devient de plus en plus difficile d’enseigner la vérité sur les purges staliniennes.
Deux procureurs s’inscrit ainsi dans un combat pour la mémoire. Le film rappelle qu’un régime totalitaire ne se contente pas de réprimer au présent : il cherche à contrôler le passé pour mieux dominer l’avenir. La citation d’Orwell résonne avec force : Qui contrôle le passé contrôle l’avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé.
La dimension universelle du film dépasse le seul contexte russo-ukrainien. Comme le souligne l’excellent dossier pédagogique monté pour le site Zérodeconduite, Deux procureurs constitue une saisissante expérience physique dans l’antre de la bête totalitaire, qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui
. Les mécanismes révélés (suspension de l’État de droit, culte du chef, terreur d’État, aveux forcés, justice aux ordres) se retrouvent dans d’autres contextes historiques et géographiques.
Enjeux pédagogiques : entre histoire, philosophie et citoyenneté
Cette œuvre s’avère particulièrement pertinente pour plusieurs niveaux et programmes en plus de ceux proposés par le dossier pédagogique proposé :
Pour la Terminale spécialité HLP
Thème : L’Humanité en question – Les limites de l’humain : qu’est-ce qui fait qu’on reste humain
dans un système qui nie l’humanité ? Kornev incarne cette tension entre l’individu et le système. Histoire et violence : la violence d’État comme instrument politique.
Thème : La recherche de soi – Les métamorphoses du moi : la prise de conscience progressive de Kornev face à l’absurde.
Pour la Terminale spécialité HGGSP
Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : la Grande Terreur peut être analysée comme une forme de guerre civile menée par l’État contre sa propre population. Comment un système judiciaire devient-il l’instrument de la terreur ?
Thème 3 – Histoire et mémoires : les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, le rôle des artistes et intellectuels dans la construction mémorielle (Demidov comme témoin et écrivain clandestin, Loznitsa comme passeur de mémoire), enjeux contemporains (la lutte mémorielle en Russie, l’interdiction de Memorial).
Thème 6 – L’enjeu de la connaissance : les samizdat comme forme de résistance intellectuelle, le film comme mode de connaissance du réel.
Je vous propose à la suite un dossier pédagogique complémentaire pour la spécialité HGGSP :
Deux Procureurs – Dossier pédagogique HGGSP – Clionautes
Une œuvre exigeante et nécessaire
Deux procureurs n’est pas un film facile. Loznitsa refuse les explications rassurantes, les musiques emphatiques, les élans émotionnels. Sa mise en scène ascétique, presque documentaire, place le spectateur dans une position d’observateur lucide plutôt que de témoin compatissant. Cette distance sert le propos : il ne s’agit pas de pleurer sur le destin de Kornev, mais de comprendre les mécanismes qui l’ont broyé.
L’interprétation d’Aleksandr Kunetsov (acteur russe exilé en Angleterre) évite tout pathos pour livrer un portrait en demi-teinte : Kornev n’est ni un héros ni une victime passive, mais un homme ordinaire confronté à une situation extraordinaire. Sa progression du doute à la prise de conscience constitue le véritable arc narratif du film.
Le son, travaillé avec une précision redoutable, alterne silences pesants et bruits métalliques angoissants. La géographie distillée, à base de couloirs, de pièces, d’une immensité soviétique qui se traverse dans des trains est très bien travaillée. La première séquence du train est ainsi un grand moment, touchant, de vie dans ce système communiste qui a offert des espoirs, vite douchés par la réalité terrible d’un système construit pour détruire l’humanité des gens ordinaires.
Pour aller plus loin
Littérature
- Vassili Grossman, Vie et destin (1959, publié en 1980)
- Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag (1973)
- Eugenia Guinzbourg, Le Vertige et Le Ciel de la Kolyma (1967)
- Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma (1954-1973)
- Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini (1940)
Ouvrages historiques
- Nicolas Werth, L’Ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un massacre de masse 1937-1938 (2009)
- Nicolas Werth, La Terreur et le désarroi. Staline et son système (2007)
- Robert Conquest, La Grande Terreur (1968, rééd. 2020)
- Stéphane Courtois (dir.), Le Livre noir du communisme (1997)
Films
- L’Aveu de Costa-Gavras (1970)
- Le Procès de Sergei Loznitsa (2017)
- L’Ombre de Staline d’Agnieszka Holland (2019)