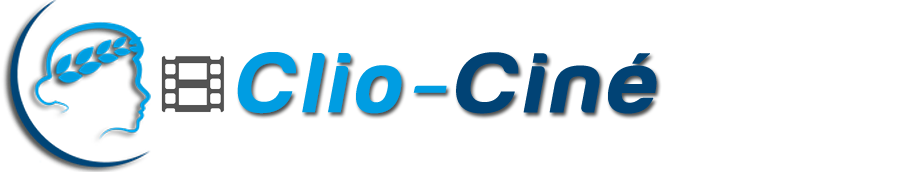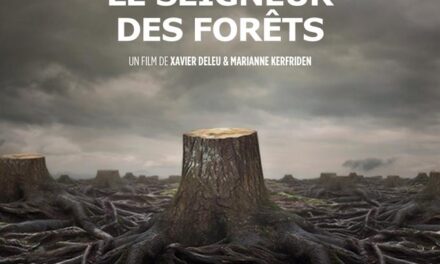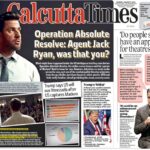20 juillet 1969. Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov pose le premier pied humain sur la Lune, devançant Neil Armstrong d’un mois. Cette divergence historique mineure – un simple renversement de calendrier – déclenche dans la série de Ronald D. Moore For All Mankind une révolution narrative majeure : la course spatiale, loin de s’achever avec Apollo, s’intensifie et se perpétue sur cinq décennies, transformant radicalement l’histoire de l’humanité.
Lancée en 2019 sur Apple TV+, cette uchronie spatiale semblait initialement relever de la pure spéculation fictionnelle : et si la guerre froide spatiale avait continué ? Et si l’espace était devenu un véritable théâtre géopolitique ? Et si l’humanité avait industrialisé le cosmos dès les années 1980 ? Quatre saisons et cinq années plus tard, For All Mankind révèle aujourd’hui une dimension inattendue : cette fiction alternative s’est muée en troublante grille de lecture du présent.
Car pendant que la série imaginait l’émergence d’entrepreneurs spatiaux disruptifs comme Dev Ayesa et sa société Helios Aerospace, Elon Musk révolutionnait l’industrie spatiale réelle avec SpaceX. Tandis qu’elle questionnait la militarisation progressive de l’espace et les tensions autour des ressources cosmiques, les États-Unis créaient leur Space Force à la fin 2019 et la Chine poursuivait le développement de ses capacités anti-satellites. Alors qu’elle dépeignait la transformation de l’espace sacré en territoire économique ordinaire, les méga-constellations commerciales envahissaient nos orbites et le tourisme spatial devenait réalité.
Cette convergence troublante entre fiction uchronique et évolution géopolitique contemporaine interpelle. Comment une série télévisée, prétendant réécrire le passé spatial, accompagne-t-elle les mutations de notre présent cosmique ? Cette forme de prescience révèle-t-elle des dynamiques profondes de l’expansion spatiale humaine, par-delà les contingences historiques particulières ?
L’éclairage de Xavier Pasco : géopolitique spatiale contemporaine
 Pour comprendre cette troublante synchronie, il convient de confronter l’anticipation fictionnelle aux analyses géopolitiques les plus pointues de notre époque spatiale. Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste reconnu des questions spatiales civiles et militaires, offre dans ses travaux « Le nouvel âge spatial », « La ruée vers l’espace » et en ce mois de septembre « Géopolitique de l’espace » et ses interventions médiatiques une grille d’analyse particulièrement éclairante de ces mutations en cours.
Pour comprendre cette troublante synchronie, il convient de confronter l’anticipation fictionnelle aux analyses géopolitiques les plus pointues de notre époque spatiale. Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste reconnu des questions spatiales civiles et militaires, offre dans ses travaux « Le nouvel âge spatial », « La ruée vers l’espace » et en ce mois de septembre « Géopolitique de l’espace » et ses interventions médiatiques une grille d’analyse particulièrement éclairante de ces mutations en cours.
Xavier Pasco diagnostique en effet une « transformation paradigmatique » majeure de l’ère spatiale contemporaine. Nous sommes passés de l’époque géopolitique (prestige national, démonstration de puissance) à l’ère du « New Space » (industrialisation, rentabilité, technologies de l’information). Cette mutation s’accompagne de l’émergence de « nouveaux acteurs » issus de la tech plutôt que de l’aérospatiale traditionnelle, d’une « militarisation silencieuse » de l’espace, d’un « vide juridique structurel » face à l’explosion des activités cosmiques.
Plus profondément, Xavier Pasco identifie une mutation anthropologique fondamentale : la « banalisation » de l’espace, qui perd son statut de sanctuaire transcendant pour devenir une « banlieue de la Terre industrialisée ». Cette « désacralisation progressive » transformerait l’espace de « bien commun de l’humanité » en « ressource économique » ordinaire, avec toutes les conséquences géopolitiques, environnementales et philosophiques que cela implique.
Fiction prospective et analyse géopolitique
Cette convergence entre l’anticipation narrative de For All Mankind et l’analyse géopolitique de Xavier Pasco ouvre un champ qui me semble fécond : comment la fiction peut-elle éclairer la compréhension des enjeux géopolitiques contemporains ? En quoi l’imagination prospective disciplinée complète-t-elle l’analyse scientifique pour saisir les dynamiques de transformation civilisationnelle ?
L’hypothèse directrice de cette analyse est que For All Mankind constitue bien plus qu’un simple divertissement spatial : elle représente un laboratoire narratif sophistiqué pour comprendre les mécanismes profonds de l’expansion spatiale humaine. En accélérant de cinq décennies l’industrialisation cosmique, la série nous offre un aperçu temporel unique des conséquences à long terme des choix géopolitiques contemporains que Xavier Pasco analyse dans l’urgence de l’actualité.
Plus encore, cette série révèle les dimensions humaines et existentielles cachées derrière les évolutions géopolitiques. Là où l’analyse de Xavier Pasco excelle dans la compréhension des mécanismes systémiques, For All Mankind dévoile leur traduction concrète : que signifie pour les individus, les communautés, l’humanité elle-même, cette transformation de l’espace transcendant en territoire d’exploitation ?
Problématique et méthode
Cette étude s’inscrit dans la droite ligne du partenariat entre les Clionautes et la FMES organisant les RSMED. Cet événement majeur d’échanges, de conférences géopolitiques à Toulon est aussi l’occasion pour des lycéens de suivre un parcours géopolitiques au cours duquel une analyse des enjeux spatiaux sera proposée. Je me propose donc de confronter systématiquement l’univers narratif de For All Mankind à la grille d’analyse géopolitique de Xavier Pasco, selon une problématique centrale :
Comment la série For All Mankind anticipe-t-elle et éclaire-t-elle les enjeux géopolitiques spatiaux contemporains identifiés par Xavier Pasco ?
L’analyse suivra la structure conceptuelle développée par Xavier Pasco dans ses travaux, organisée en six axes thématiques complémentaires : la transformation paradigmatique de l’ère spatiale (du géopolitique à l’économique), l’émergence de nouveaux écosystèmes d’acteurs (hybridation public-privé), l’évolution des enjeux militaires et sécuritaires (de la coopération à la confrontation), les défis de gouvernance et de régulation (du cadre westphalien au Far West contrôlé), les nouveaux enjeux environnementaux (de l’Eden spatial à l’Anthropocène cosmique), et enfin les mutations anthropologiques profondes (de l’Homo spatialis à l’Homo economicus cosmique).
Chaque axe sera exploré selon une méthodologie comparative rigoureuse : identification des représentations narratives, confrontation avec les recherches en cours, mise en évidence des convergences et divergences, évaluation de la capacité d’anticipation de la fiction sur l’évolution géopolitique réelle.
L’enjeu : fiction et citoyenneté spatiale
Au-delà de l’exercice intellectuel, cette analyse vise un objectif plus ambitieux : révéler comment la fiction peut éclairer les choix civilisationnels contemporains. Car l’expansion spatiale que nous vivons aujourd’hui n’est pas qu’une évolution technique : elle engage l’avenir de l’humanité, ses valeurs, son rapport au cosmos et à elle-même. J’ai eu l’occasion de le proposer à travers Godzilla dernièrement, cette série est l’occasion de laisser le monstre se reposer un peu pour explorer d’autres chemins.
En nous montrant les futurs possibles de notre expansion cosmique – ses promesses et ses dangers, ses grandeurs et ses dérives – For All Mankind accomplit peut-être sa mission la plus noble : non pas seulement divertir, mais former notre intelligence prospective face aux défis spatiaux contemporains. Car comme le démontre Xavier Pasco, l’espace devient « un secteur économique de premier rang » qui déterminera les équilibres géopolitiques du XXIe siècle.
L’analyse croisée de la fiction et de la géopolitique spatiale révèle ainsi que nous ne sommes plus spectateurs de l’expansion cosmique, mais acteurs d’une révolution civilisationnelle en cours. À nous de choisir, en connaissance de cause, quel avenir spatial nous voulons construire.
L’infini cosmique reste ouvert. Cette analyse propose les clés pour le comprendre et, peut-être, le mériter. En fin de parcours je proposerai quelques pistes pour l’enseignement de HGGSP. Avec les allègements en cours, il semble possible de dégager quelques heures pour sortir des sentiers battus …. En attendant les prochains aménagements, contradictoires …
L’uchronie spatiale devient prospective citoyenne : tel est l’enjeu de cette rencontre inédite entre For All Mankind et les analyses géopolitiques de Xavier Pasco. Attention : pour les besoins de ce travail il y aura nécessairement des spoils. Il est encore temps de regarder les saisons pour revenir ici …
LA BANALISATION SPATIALE : DU SANCTUAIRE À LA BANLIEUE TERRESTRE
Xavier Pasco et la « Désacralisation » de l’espace
Dans son interview France 24, Xavier Pasco formule une observation saisissante : « Aujourd’hui on banalise l’espace. L’espace était sacré y compris dans les mythes. Les dieux sont toujours au-delà des cieux. » Cette mutation anthropologique fondamentale – le passage du spatial transcendant au spatial utilitaire – trouve dans For All Mankind son illustration la plus éclatante et prophétique.
La série de Ronald D. Moore nous offre en effet un laboratoire temporel unique : observer, sur quatre décennies narratives, la transformation progressive de l’espace sacré en banlieue de la Terre industrialisée. Cette évolution, que nous vivons aujourd’hui avec SpaceX et les méga-constellations, la série l’a accompagné avec une réelle justesse.
Saisons 1-2 : l’Âge d’Or du spatial sacré (1969-1983)
L’espace sanctuaire
Dans les premières saisons, For All Mankind nous plonge dans un univers où l’espace conserve encore toute sa dimension sacrée. Les astronautes y sont littéralement des héros nationaux, des rock-stars de leur époque selon la formule d’Apple TV+. Ed Baldwin (Joel Kinnaman), Tracy Stevens (Sarah Jones), ou encore Molly Cobb (Sonya Walger) évoluent dans un monde où chaque mission lunaire relève de l’épopée nationale, chaque pas sur la Lune résonne comme un acte civilisationnel majeur. Le casting est parfait. Véritablement.
La série illustre parfaitement ce que Xavier Pasco identifie comme l’époque où « l’espace servait aussi à réguler, à équilibrer la relation stratégique » entre superpuissances. Les bases lunaires Jamestown (américaine) et Zvezda (soviétique) ne sont pas de simples avant-postes techniques : elles incarnent la projection de la souveraineté terrestre vers les cieux. Lorsque les marines lunaires américains s’affrontent avec les cosmonautes soviétiques dans la saison 2, nous assistons à la sacralisation militaire de l’espace.
Le rituel héroïque
Chaque départ vers la Lune conserve sa dimension rituelle. Les familles d’astronautes – Karen Baldwin (Shantel VanSanten), les épouses de Tracy et Gordo Stevens – vivent ces missions comme des pèlerinages modernes. La société entière se mobilise, la télévision retransmet, l’Amérique retient son souffle. L’espace demeure cet au-delà mystérieux que seule une élite choisie peut fouler.
Saison 3 : l’amorce de la normalisation (1995)
L’irruption du privé
Avec l’arrivée de Dev Ayesa (Edi Gathegi) et de sa société Helios Aerospace, la série amorce la transformation décisive : l’entrée en scène des acteurs qui viennent de la tech, de l’information, du monde de l’information. Dev, inspiré d’Elon Musk, incarne parfaitement ces nouveaux entrepreneurs spatiaux qui n’appartiennent pas à la communauté spatiale traditionnelle issue de la NASA mais apportent une logique industrielle et commerciale.
La construction de l’hôtel spatial Polaris marque un tournant symbolique majeur : l’espace devient accessible au tourisme. Cette démocratisation relative préfigure la transformation de l’espace en secteur économique de premier rang.
Mars : nouveau sanctuaire ou première usine ?
La course vers Mars illustre la tension entre ancien et nouveau paradigme. D’un côté, Mars conserve sa dimension épique – première planète colonisée par l’humanité. De l’autre, les motivations deviennent déjà plus prosaïques : ressources, avantage géostratégique, profit. La tragédie du forage martien en fin de saison révèle que l’espace peut désormais tuer par négligence industrielle, et non plus seulement par héroïsme exploratoire.
Saison 4 : l’industrialisation totale (2003-2012)
L‘espace prolétarisé
C’est dans la quatrième saison que For All Mankind accomplit pleinement la prophétie de l’industrialisation spatiale. L’introduction de Miles (Toby Kebbell), ouvrier d’Helios envoyé sur Mars, marque une révolution narrative : l’espace n’est plus le domaine exclusif de l’élite astronaute, mais devient un lieu de travail ordinaire pour des prolétaires spatiaux.
La série développe alors une critique sociale saisissante. Les privilèges persistent : d’un côté, les cadres de la NASA avec leurs fenêtres sur Mars, de l’autre, les halls labyrinthiques aux couleurs froides des ouvriers. L’espace reproduit et exporte les inégalités terrestres. Clairement on retrouve ici les approches déjà évoquées dans d’autres œuvres visionnaires telle la saga Alien ou The Expanse.
L’astéroïde « Boucle d’Or » : vers la ruée spatiale
L’exploitation de l’astéroïde « Boucle d’Or » constitue l’aboutissement de cette transformation paradigmatique. Plus question d’exploration héroïque : il s’agit désormais d’une « nouvelle ruée vers l’or » (selon la promotion d’Apple TV+), d’extraction industrielle d’iridium, de rentabilité économique. L’espace devient littéralement une mine à ciel ouvert.
Cette évolution valide intégralement l’analyse projetant une industrialisation progressive de l’espace. L’astéroïde minier préfigure les projets contemporains d’exploitation spatiale que défendent aujourd’hui les entreprises comme Planetary Resources ou Deep Space Industries.
La station Kuznetsov : symbole de la banalisation achevée
Le flash-forward final nous montre la station minière Kuznetsov installée sur l’astéroïde. Cette image constitue l’aboutissement narratif de la banalisation spatiale : une installation industrielle banale, peuplée d’ouvriers, puisant les ressources comme n’importe quelle mine terrestre. L’espace a perdu tout mystère, toute transcendance.
Ainsi se vérifient les analyses géopolitiques : l’espace sacré devient spatial banalisé, et For All Mankind nous en offre la chronique anticipée avec quatre décennies d’avance sur notre réalité.
NOUVEAUX ACTEURS ET HYBRIDATION PUBLIC-PRIVÉ : LA PROPHÉTIE HELIOS
La révolution des acteurs spatiaux
« Ce qui est frappant, c’est que les acteurs qui investissent dans l’espace ne sont pas les acteurs traditionnels spatiaux […] mais sont des acteurs qui viennent de la tech, de l’information, du monde de l’information. » Cette observation cruciale de Xavier Pasco dans son interview France 24 trouve dans For All Mankind une illustration saisissante, particulièrement à travers l’évolution du personnage de Dev Ayesa et de sa société Helios Aerospace.
Plus encore, Xavier Pasco souligne la complexité de cette mutation : « L’argent qui circule dans l’espace reste majoritairement de l’argent public, mais les États se servent de ces acteurs pour créer de grandes infrastructures qu’ils ne veulent pas mettre en place eux-mêmes. » Cette hybridation sophistiquée public-privé, la série l’anticipe et la décortique avec une finesse remarquable, révélant les mécanismes profonds de la transformation spatiale contemporaine.
Saisons 1-2 : l’hégémonie Étatique absolue (1969-1983)
Le monopole des agences spatiales
Dans les deux premières saisons, For All Mankind nous plonge dans un univers spatial encore intégralement dominé par les États. NASA et programme spatial soviétique se livrent une compétition frontale sans intermédiaires privés significatifs. Les entreprises existantes – Grumman, North American Aviation – ne sont que de simples contractants exécutant les cahiers des charges gouvernementaux.
Cette configuration illustre parfaitement l’époque révolue où « pendant plus d’un demi-siècle, ce sont les États, avec les agences spatiales qui ont déterminé les politiques spatiales à mettre en œuvre. » Margo Madison (Wrenn Schmidt), brillante ingénieure NASA, ou Sergei Nikulov côté soviétique, incarnent cette génération de cadres techniques entièrement dévoués aux programmes nationaux.
La logique de prestige national
L’argent coule à flots – bases lunaires, réacteurs nucléaires spatiaux, marines lunaires – mais selon une logique purement géopolitique. Le président Nixon finance massivement Jamestown non pour sa rentabilité économique, mais pour restaurer le prestige américain face à l’humiliation lunaire soviétique.
Saison 3 : L’irruption du privé (1995) – La révolution Dev Ayesa
Portrait d’un entrepreneur spatial post-moderne
L’apparition de Dev Ayesa en saison 3 marque un tournant historique dans la série. Milliardaire de la tech, fondateur d’Helios Aerospace, Dev incarne parfaitement ces nouveaux acteurs: il ne vient pas du sérail spatial traditionnel, mais du monde de l’information et des technologies. Sa fortune, bâtie sur l’internet et l’informatique, lui permet d’investir massivement dans l’espace selon des logiques entrepreneuriales inédites.
La série, créée en 2019, accompagne déjà avec une précision troublante le profil d’Elon Musk et sa révolution SpaceX. Dev partage avec le patron de Tesla cette obsession martienne, cette approche disruptive, cette capacité à mobiliser des capitaux privés pour des projets spatiaux d’envergure étatique.
La stratégie de « Surfing » Étatique
Plus subtilement, la série illustre parfaitement les analyses sur l’hybridation financière. Helios ne fonctionne pas en totale autonomie : la société bénéficie de contrats NASA, d’accès aux infrastructures publiques, de partenariats technologiques avec les agences spatiales. Dev « surfe » sur l’intérêt des États tout en développant sa propre vision martienne. Cette stratégie hybride préfigure exactement le modèle SpaceX contemporain, largement financé par les contrats gouvernementaux tout en poursuivant des objectifs privés.
L’hôtel Polaris : commercialisation de l’espace
La construction de l’hôtel spatial Polaris symbolise cette mutation paradigmatique. Pour la première fois dans la série, l’espace devient un secteur commercial direct, générateur de revenus civils. Cette « commercialisation » correspond exactement à la première vague de privatisation spatiale américaine sous Clinton.
Saison 4 : l’hybridation complexifiée (2003-2012)
Helios, acteur géopolitique majeur
En saison 4, Helios a acquis un statut quasi-étatique. L’entreprise possède ses propres infrastructures martiennes, emploie des milliers de travailleurs, développe des technologies de pointe. Dev Ayesa négocie d’égal à égal avec les représentants gouvernementaux américains et soviétiques pour l’exploitation de l’astéroïde « Boucle d’or ».
Cette évolution valide les analyses sur la complexification des rapports public-privé. Helios n’a pas remplacé la NASA, mais s’est intégré dans un écosystème hybride où acteurs publics et privés coopèrent et rivalisent simultanément.
La prolétarisation spatiale : conséquence de la privatisation
L’introduction de Miles (Toby Kebbell), ouvrier d’Helios, révèle les conséquences sociales de cette privatisation spatiale. Contrairement aux astronautes-fonctionnaires des premières saisons, Miles représente cette nouvelle classe de travailleurs spatiaux précaires, employés par des entreprises privées selon des logiques de rentabilité.
Cette évolution illustre la transformation contemporaine : la privatisation spatiale n’élimine pas seulement la dimension héroïque de l’espace, elle y introduit les rapports de classe capitalistes traditionnels. Les « petites mains » d’Helios subissent des conditions de travail difficiles tandis que Dev Ayesa accumule les bénéfices. Ceci nous ramène à Alien et ses échanges savoureux sur les primes.
Le sabotage de « Boucle d’or » : clash des logiques
Le climax de la saison 4 – le détournement de l’astéroïde vers Mars plutôt que vers la Terre – illustre parfaitement la tension entre logiques publiques et privées. Aleida Rosales (Coral Peña), ingénieure d’Helios, sabote la mission officielle pour servir les intérêts martiens contre les intérêts terrestres.
Ce conflit révèle la complexité géopolitique des nouveaux acteurs privés : ils ne sont ni purement marchands ni purement patriotiques, mais développent leurs propres agenda stratégiques, parfois contradictoires avec les politiques étatiques. Helios devient un quasi-État spatial avec sa propre diplomatie.
La validation contemporaine
Cette évolution narrative de For All Mankind trouve aujourd’hui sa validation éclatante dans la réalité. Quand Xavier Pasco analyse le rôle de SpaceX – « 60 à 70% des satellites en service aujourd’hui » appartenant à des opérateurs privés – il décrit exactement la configuration proposée par la série.
La relation ambiguë entre Elon Musk et l’État américain – contrats NASA massifs, mais diplomatie spatiale autonome avec Starlink en Ukraine – reproduit fidèlement la dynamique Helios/gouvernement américain dépeinte dans la série.
Plus encore, l’analyse de l’hybridation financière trouve dans SpaceX sa parfaite illustration : entreprise « privée » largement financée par l’argent public, mais poursuivant des objectifs propres (Mars) que l’État n’oserait assumer directement.
L’uchronie spatiale rejoint ainsi l’analyse géopolitique : For All Mankind et Xavier Pasco décrivent, chacun à sa manière, la même révolution en cours.
MILITARISATION ET SÉCURISATION : DE LA COOPÉRATION FORCÉE À LA CONFRONTATION SPATIALE
La mutation sécuritaire de l’espace
« L’espace jusqu’à présent était un peu au-delà des affrontements parce que l’espace servait aussi à réguler, à équilibrer la relation stratégique entre les États-Unis […] Aujourd’hui la dissuasion existe toujours mais l’espace prend une place plus importante dans les opérations militaires. » Cette analyse de Xavier Pasco sur la transformation sécuritaire contemporaine trouve dans For All Mankind son illustration la plus saisissante et prophétique.
La série anticipe avec une précision troublante cette évolution observée aujourd’hui : le passage d’un espace « sanctuaire » régulateur à un espace « théâtre » d’affrontement. Plus encore, elle révèle les mécanismes profonds de cette militarisation progressive, depuis la coopération contrainte jusqu’à la confrontation ouverte.
Saison 1 : l’espace sanctuaire militarisé (1969-1974)
La militarisation défensive initiale
Dès la première saison, la série explore la militarisation spatiale sous l’angle défensif. Face à l’humiliation lunaire soviétique, Nixon ordonne la construction d’une base militaire permanente sur la Lune (Jamestown). Cette décision illustre parfaitement ce que Pasco identifie comme la logique spatiale de guerre froide : l’espace devient un lieu de démonstration de force, mais selon des règles tacites de non-confrontation directe.
La présence du général Arthur Weber (Dan Warner), officier de liaison de l’US Air Force avec la NASA, symbolise cette hybridation civilo-militaire croissante. L’espace reste officiellement « pacifique », mais la dimension militaire s’impose par nécessité géostratégique.
Les marines lunaires : anticipation prophétique
L’établissement des marines lunaires américains en saison 1 constitue une anticipation remarquable. Quand la série montre en 2019 des soldats patrouillant sur la Lune, elle préfigure la création en 2019 (dans notre réalité) de la Space Force américaine. Cette synchronicité troublante révèle la capacité d’anticipation de la fiction sur les évolutions militaires spatiales.
Saison 2 : L’escalade et la confrontation (1983)
La Guerre Froide « chaude » spatiale
La saison 2 développe magistralement la mutation contemporaine et l’accroissement des activités militaires. L’apogée de la guerre froide terrestre (1983, missiles Pershing, « Evil Empire » de Reagan) se traduit par une militarisation spatiale assumée.
Le colonel Alex Rossi (Scott Michael Campbell) commande désormais une base Jamestown lourdement armée. Les marines lunaires, menés par le colonel Vance Paulson (Connor Tillman), patrouillent armés sur la surface sélénite. L’espace n’est plus ce au-delà des affrontements mais devient un théâtre potentiel de guerre chaude.
La crise des ressources lunaires
L’épisode climax de la saison – la confrontation armée entre Américains et Soviétiques pour le contrôle d’une mine de glace lunaire – illustre parfaitement l’analyse sur l’évolution des enjeux spatiaux. Ce n’est plus la pure géopolitique de prestige qui motive les acteurs, mais la maîtrise de « ressources lunaires » stratégiques.
Cette séquence préfigure les analyses contemporaines sur la course aux ressources spatiales. Le point culminant de la saison – l’incident armé lunaire qui manque de déclencher une guerre nucléaire – révèle la prescience de la série sur les nouveaux risques militaires spatiaux.
Saison 3 : coopération forcée et nouveaux risques (1995)
L’interdépendance comme régulateur
La mission martienne tripartite (USA-URSS-Helios) de la saison 3 accompagne ce que Xavier Pasco identifie comme le principal « garde-fou » spatial contemporain : « L’interdépendance […] L’espace, c’est le seul environnement où si vous vous comportez mal, tout le monde va payer la facture. »
La mission de sauvetage conjointe après la tragédie du forage martien démontre cette logique : malgré les rivalités géopolitiques, la survie dans l’espace hostile impose la coopération. Cette dynamique représente exactement le cas de l’ISS.
Les nouveaux acteurs sécuritaires
L’entrée d’Helios dans la compétition spatiale complexifie les enjeux sécuritaires. Dev Ayesa développe ses propres technologies, ses propres infrastructures, ses propres intérêts stratégiques. Cette multipolarisation anticipe l’analyse sur les nouveaux défis : comment réguler un espace où coexistent acteurs étatiques et privés aux logiques divergentes ?
Saison 4 : vers la fragmentation sécuritaire (2003)
Mars : nouveau théâtre de tensions
La base internationale de Happy Valley devient le laboratoire des nouvelles tensions sécuritaires spatiales. Les incidents entre ouvriers d’Helios, personnel NASA, et représentants soviétiques illustrent la complexification des enjeux.
Surveillance et attribution
L’intrigue autour de Margo Madison, réfugiée en URSS et soupçonnée d’espionnage, anticipe parfaitement les préoccupations contemporaines sur la surveillance spatiale. La série développe cette problématique à travers les difficultés d’attribution des responsabilités dans les incidents spatiaux. Qui est responsable de quoi ? Qui surveille qui ? Ces questions, centrales traversent toute la saison 4.
La rébellion de « Boucle d’or » : nouveau type de conflit
Le climax de la saison – la « rébellion » des travailleurs d’Helios et le détournement de l’astéroïde – révèle l’émergence de nouveaux types de conflits spatiaux. Il ne s’agit plus d’affrontements inter-étatiques classiques, mais de tensions socio-économiques exportées dans l’espace.
Cette évolution valide l’analyse de la banalisation spatiale : en industrialisant l’espace, on y transpose la coopération, la compétition, les points positifs, les points négatifs terrestres, y compris les conflits sociaux.
La dimension militaire validée
Cette évolution narrative de For All Mankind trouve aujourd’hui sa validation dans les analyses de Xavier Pasco. Quand il observe que « les satellites deviennent aussi des cibles et donc on a une activité militaire qui s’intensifie dans l’espace », il décrit exactement la trajectoire que la série avait anticipée.
L’exercice AsterX français – simulation d’une guerre spatiale – correspond précisément aux scenarii développés par la série. La France développe des « nanosatellites garde-du-corps » (programme YODA – Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile) exactement comme la série montrait l’évolution vers la militarisation défensive spatiale.
L’espace perdu
For All Mankind révèle ainsi que la militarisation spatiale n’est pas qu’une évolution technique, mais une perte civilisationnelle : l’espace, dernier sanctuaire de coopération humaine, devient progressivement un théâtre de confrontation comme les autres.
Cette évolution trouve dans la série sa chronique anticipée. De l’espace régulateur des années 1970 à l’espace conflictuel des années 2000, la série nous montre la banalisation militaire d’un domaine jadis transcendant.
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET TECHNIQUES : DE L’EDEN SPATIAL À L’ANTHROPOCÈNE COSMIQUE
La crise écologique spatiale
« Le syndrome de Kessler, c’est-à-dire des effets en cascade, une réaction en chaîne […] Une bille d’1 cm peut traverser un satellite. » Cette formulation inquiétante de Xavier Pasco révèle l’un des défis les plus méconnus de l’expansion spatiale contemporaine : la transformation progressive de l’espace circumterrestre en dépotoir cosmique potentiellement mortel. Là encore le cinéma nous avait averti …
Plus encore, le chercheur souligne l’irréversibilité temporelle du problème : « Les objets restent des siècles » dans certaines orbites, créant un risque de « gel des orbites » qui pourrait fermer définitivement l’accès spatial aux générations futures. Cette vision d’un « Anthropocène cosmique » trouve dans For All Mankind son illustration la plus saisissante, bien que souvent en creux.
La série, en accélérant de cinq décennies l’industrialisation spatiale, nous offre un aperçu prophétique des défis environnementaux identifiés aujourd’hui. De l’Eden spatial des années 1960 à l’industrialisation massive des années 2000, For All Mankind chronique l’émergence d’une crise écologique inédite : la pollution de l’infini.
Saisons 1-2 : l’innocence écologique spatiale (1969-1983)
L’espace vierge et infini
Dans les premières saisons, For All Mankind nous plonge dans un univers spatial encore marqué par l’innocence écologique. L’espace y apparaît comme un domaine infini, inépuisable, capable d’absorber sans limite l’expansion humaine. Les missions Apollo prolongées, les bases lunaires permanentes, les navettes régulières s’accumulent sans que jamais ne soit évoquée leur empreinte environnementale spatiale.
Cette vision correspond à l’époque de l’insouciance spatiale, où la question du coût environnemental ne se pose pas face aux enjeux géopolitiques. L’espace semble trop vaste pour être pollué, trop mystérieux pour être dégradé.
Les premiers signes : accumulation silencieuse
Cependant, la série suggère subtilement l’accumulation progressive d’objets spatiaux. Chaque mission laisse ses traces : étages de fusées, modules abandonnés, équipements défaillants. La base Jamestown elle-même génère ses déchets, ses rejets, ses équipements obsolètes. Sans le dire explicitement, la série amorce la chronique de cette pollution spatiale que Xavier Pasco analyse aujourd’hui.
L’incident du réacteur nucléaire lunaire en saison 2 préfigure ces préoccupations environnementales : quand la technologie nucléaire spatiale dysfonctionne, elle crée une contamination durable, illustrant la persistance temporelle des pollutions spatiales.
L’orbite terrestre : zone de passage
Significativement, ces premières saisons se concentrent sur la Lune, évitant largement la question de l’orbite terrestre basse. Cette focalisation lunaire masque le vrai problème environnemental spatial : la congestion orbitale terrestre, où se concentrent les orbites utiles.
Saison 3 : l’amorce de la congestion (1995)
La multiplication des acteurs
L’entrée d’Helios marque un tournant dans l’empreinte environnementale spatiale. Dev Ayesa lance ses propres satellites, développe ses constellations, multiplie ses infrastructures orbitales. Cette prolifération d’acteurs anticipe exactement ce que Xavier Pasco observe aujourd’hui : « 90 pays présents » dans l’espace avec une « industrialisation exponentielle. »
La construction de l’hôtel Polaris symbolise cette mutation : l’espace devient un lieu de consommation, générant déchets, rejets, obsolescence programmée. Le tourisme spatial introduit la logique de rotation rapide, de remplacement fréquent, d’accumulation détritus que Pasco identifie dans les méga-constellations contemporaines.
Mars : l’exportation de la pollution
La colonisation martienne illustre subtilement l’exportation des logiques polluantes terrestres. La tragédie du forage martien – explosion industrielle causée par négligence technique – préfigure l’industrialisation dangereuse de l’espace que craint Pasco.
Plus encore, cette catastrophe révèle l’irréversibilité des pollutions spatiales : les débris de l’explosion, dans l’atmosphère martienne ténue, persistent durablement et menacent les futures missions.
L’interdépendance technique fragilisée
La mission de sauvetage martienne révèle la vulnérabilité croissante des infrastructures spatiales. Plus elles se multiplient, plus elles s’interconnectent, plus leur défaillance cascade menace l’ensemble du système. Cette dynamique préfigure le « syndrome de Kessler » : effets en cascade, réaction en chaîne.
Saison 4 : l’anthropocène cosmique accompli (2003-2012)
L’industrialisation massive de l’espace
La quatrième saison accomplit pleinement les problématiques environnementales posées. L’exploitation intensive de l’astéroïde « Boucle d’or », la multiplication des infrastructures martiennes, la banalisation des transports spatiaux créent un écosystème spatial industriel dense et polluant.
La station minière Kuznetsov, révélée dans le flash-forward final, symbolise cette mutation : l’espace devient un lieu de production industrielle intensive, générant déchets, pollutions, dégradations environnementales comme n’importe quelle zone industrielle terrestre.
La prolétarisation environnementale
L’introduction des ouvriers spatiaux révèle la dimension sociale de la crise environnementale spatiale. Miles et ses collègues subissent directement les conséquences de cette industrialisation : environnement de travail dégradé, exposition aux risques, précarité écologique.
Cette évolution illustre parfaitement la « banalisation » spatiale : on y transpose les points négatifs terrestres, y compris l’inégalité face aux risques environnementaux. Les élites spatiales (astronautes, cadres) évoluent dans des environnements protégés, tandis que les prolétaires spatiaux assument les risques écologiques. C’est une approche classique de la SF, mais c’est très bien fait.
Le détournement de « Boucle d’or » : catastrophe annoncée
Le climax de la saison – le sabotage qui envoie l’astéroïde vers Mars plutôt que vers la Terre – illustre magistralement les nouveaux risques environnementaux spatiaux. Cette masse de plusieurs millions de tonnes, déviée de sa trajectoire, crée un risque permanent pour toutes les infrastructures martiennes.
L’irréversibilité temporelle
La série développe subtilement la question de l’irréversibilité environnementale spatiale. Les choix industriels des années 2000 – exploitation intensive, infrastructure lourde, pollution généralisée – déterminent durablement l’avenir spatial. Et oui, les objets restent des siècles…
Plus inquiétant encore, la série suggère que cette dégradation environnementale spatiale pourrait devenir un facteur géopolitique majeur : qui contrôle les « orbites propres » contrôle l’avenir spatial de l’humanité.
La lacune : ce que la série n’aborde point
L’orbite terrestre basse : le grand absent
Paradoxalement, For All Mankind rate partiellement la dimension environnementale en négligeant l’orbite terrestre basse, véritable épicentre de la crise que Xavier Pasco analyse aujourd’hui. En se concentrant sur la Lune et Mars, la série évite le problème le plus urgent : la saturation des « orbites utiles » circumterrestres.
Cette lacune est significative : elle révèle que même une fiction prospective peut sous-estimer l’ampleur d’une crise environnementale émergente. Les méga-constellations contemporaines (Starlink, OneWeb) créent une congestion orbitale que la série ne traite absolument pas.
Le syndrome de Kessler : menace invisible
Plus encore, la série n’explore jamais explicitement le scénario cauchemardesque du syndrome de Kessler. Cette réaction en chaîne où les collisions de débris génèrent d’autres débris dans un processus auto-entretenu jusqu’à rendre certaines orbites inaccessibles reste le grand impensé de For All Mankind.
Cette omission révèle aussi les limites de l’anticipation fictionnelle, qu’il faut garder à l’esprit : certains risques systémiques, trop abstraits ou techniques, échappent à la dramatisation narrative. Il existe aussi un risque de “rétro-projection” : on voit dans la série des éléments qui ressemblent à notre présent, mais cela peut être dû à une conception finalement assez prévisible des scénarios futurs par les auteurs, ou des choix narratifs répondant aux attentes du public. La série, comme beaucoup de fictions, exagère ou accélère des dynamiques (ce qui est normal), ce qui peut rendre la comparaison fiction/réalité utile mais partiellement biaisée. Une série reste une série !
L’industrialisation polluante validée
Malgré ces lacunes, l’évolution environnementale de For All Mankind valide largement les inquiétudes actuelles. La transformation de l’espace en zone industrielle polluante, l’accumulation de déchets spatiaux, la dégradation des environnements cosmiques correspondent exactement aux tendances observées aujourd’hui.
La série révèle que l’expansion spatiale n’échappe pas aux logiques environnementales terrestres : industrialisation rapide, externalisation des coûts écologiques, inégalité face aux risques. L’espace n’est pas l’Eden écologique que promettaient les pionniers, mais reproduit et amplifie les crises terrestres.
L’urgence temporelle
Plus encore, la série illustre l’urgence temporelle. Chaque décennie d’industrialisation spatiale accroît exponentiellement les risques futurs. Les décisions d’aujourd’hui déterminent la viabilité spatiale de demain, créant une responsabilité intergénérationnelle inédite.
Cette dimension temporelle – visible dans la structure narrative décennale de la série – révèle que l’environnement spatial n’obéit pas aux logiques de réversibilité terrestre. Dans l’espace, les erreurs persistent « des siècles. »
DIMENSIONS PHILOSOPHIQUES : DE L’HOMO SPATIALIS À L’HOMO ECONOMICUS COSMIQUE
Une mutation anthropologique spatiale ?
« Il y a toujours cette idée que l’espace c’est hostile à l’être humain et que quand on s’y trouve […] on s’y trouve en situation de vulnérabilité […] Il y a toujours eu cet esprit de découverte. » Cette tension fondamentale identifiée par Xavier Pasco – entre l’esprit d’exploration transcendant et la vulnérabilité technique contraignante – révèle l’enjeu philosophique central de l’expansion spatiale contemporaine.
Plus profondément, Xavier Pasco diagnostique une mutation anthropologique majeure : l' »augmentation du globe terrestre » par l’espace, qui transforme le cosmos de sanctuaire mystérieux en « ressource économique. » Cette révolution civilisationnelle, qui voit l’humanité perdre son dernier horizon transcendant pour gagner un nouveau territoire d’exploitation, trouve dans For All Mankind son illustration la plus subtile et prophétique.
La série nous offre en effet le laboratoire temporel d’une transformation philosophique que nous vivons aujourd’hui en accéléré : l’observation, sur quatre décennies narratives, de la mutation de l’Homo spatialis héroïque en Homo economicus cosmique. Cette évolution For All Mankind l’avait anticipée dès 2019 avec une profondeur saisissante.
Saisons 1-2 : L’épopée de l’Homo Spatialis (1969-1983)
L’esprit de découverte pur
Dans les premières saisons, For All Mankind nous plonge dans l’univers de l’Homo spatialis authentique. Ed Baldwin (Joel Kinnaman), Molly Cobb (Sonya Walger), Tracy Stevens (Sarah Jones) incarnent cette humanité spatiale transcendante, motivée par la pure exploration plutôt que par le profit.
Cette génération pionnière illustre parfaitement les missions Voyager ou James Webb : l’espace comme horizon de connaissance désintéressée, domaine de dépassement de soi, sanctuaire où l’humanité exprime sa nature la plus noble. Chaque pas sur la Lune relève du pèlerinage civilisationnel, chaque mission de l’épopée métaphysique.
La vulnérabilité comme révélateur
La série développe magistralement la dimension existentielle que l’espace révèle, l’essence humaine authentique. Face au vide cosmique, aux pannes techniques, aux dangers mortels, les astronautes révèlent leur véritable nature : solidarité, courage, dépassement de soi.
L’épisode de la saison 2 où Molly Cobb reste aveuglée par les radiations solaires pour sauver ses collègues illustre cette anthropologie spatiale héroïque. Dans l’espace hostile, l’humanité découvre sa grandeur possible, loin des mesquineries terrestres.
La coopération transcendante
Significativement, même en pleine guerre froide, la série montre des moments de coopération spatiale spontanée entre Américains et Soviétiques. Cette coopération résiduelle que l’on identifie à l’ISS trouve dans la série sa justification anthropologique : l’espace révèle l’humanité commune au-delà des divisions politiques.
La mission de sauvetage conjointe soviéto-américaine en fin de saison 2 illustre cette transcendance spatiale : face au cosmos hostile, les astronautes redeviennent simplement humains, dépassant leurs appartenances nationales.
Saison 3 : La tension exploration/exploitation (1995)
Dev Ayesa : L’ambivalence anthropologique
L’apparition de Dev Ayesa marque l’entrée en scène d’une figure anthropologique inédite : l’entrepreneur spatial, hybride complexe entre Homo spatialis et Homo economicus. Dev incarne parfaitement la tension entre « esprit de découverte » et « logique commerciale. »
D’un côté, Dev partage la vision transcendante des pionniers : Mars comme nouveau monde, expansion interplanétaire comme destin humain, espace comme horizon de dépassement. De l’autre, il applique à cette vision les logiques entrepreneuriales terrestres : rentabilité, efficacité, disruption technologique.
Cette ambivalence philosophique anticipe exactement les figures contemporaines : Elon Musk, Jeff Bezos, ces entrepreneurs qui mélangent authentique passion spatiale et logiques capitalistes terrestres.
L’Hôtel Polaris : démocratisation ou profanation ?
La construction de l’hôtel spatial Polaris pose la question philosophique centrale : la démocratisation spatiale constitue-t-elle un progrès humaniste ou une profanation commerciale ? En rendant l’espace accessible au tourisme, Helios démocratise l’expérience transcendante, mais la banalise simultanément.
Cette tension illustre la désacralisation progressive spatiale. L’espace accessible à tous perd-il son caractère initiatique ? Le tourisme spatial révèle-t-il l’essence démocratique de l’exploration ou la détruit-il par sa marchandisation ?
Mars : dernier sanctuaire ou première colonie ?
La course vers Mars cristallise cette tension philosophique fondamentale. Pour Ed Baldwin et la génération pionnière, Mars représente l’aboutissement de l’épopée spatiale, le dernier horizon transcendant. Pour Dev Ayesa, Mars constitue la première étape d’une expansion interplanétaire industrielle.
La tragédie du forage martien révèle les conséquences existentielles de cette mutation : quand l’exploration devient exploitation, l’espace transcendant devient espace mortel par négligence humaine plutôt que par hostilité cosmique.
Saison 4 : l’Homo economicus cosmique triomphant (2003-2012)
L’espace prolétarisé : fin de l’Élite transcendante
L’introduction de Miles et des ouvriers spatiaux marque l’aboutissement de la mutation anthropologique. L’espace n’est plus le domaine réservé de l’Homo spatialis héroïque, mais devient le lieu de travail ordinaire de l’Homo economicus cosmique.
Cette prolétarisation spatiale illustre parfaitement l’extension des logiques socio-économiques terrestres à l’ensemble du cosmos. L’espace reproduit les hiérarchies, les inégalités, les aliénations terrestres.
Miles, ouvrier d’Helios sur Mars, incarne cette nouvelle humanité spatiale : ni héros ni explorateur, mais simple travailleur exporté dans le cosmos pour des raisons économiques. Sa condition révèle que l’expansion spatiale n’élève pas nécessairement l’humanité, mais peut l’exporter avec ses misères.
L’astéroïde « Boucle d’or » : l’espace réduit à la ressource
L’exploitation intensive de l’astéroïde symbolise l’aboutissement de la désacralisation spatiale. « Boucle d’or » n’est plus un objet cosmique mystérieux, mais une simple mine à ciel ouvert, réduite à sa valeur d’extraction d’iridium.
Cette réduction de l’espace à la ressource économique illustre la victoire finale de l’Homo economicus cosmique sur l’Homo spatialis transcendant. Le cosmos devient littéralement un « gisement » à exploiter, perdant toute dimension spirituelle ou contemplative.
La nostalgie de l’Âge d’Or
Significativement, la série développe chez ses personnages pionniers une nostalgie croissante de « l’âge d’or » spatial. Ed Baldwin, vieillissant sur Mars, regrette l’époque héroïque où l’espace était encore mystérieux. Cette nostalgie illustre la conscience douloureuse de la perte anthropologique en cours.
La série suggère que la nostalgie est inévitable, révélant la conscience diffuse qu’une certaine grandeur humaine disparaît avec la banalisation spatiale.
Le sabotage de « Boucle d’or » : rébellion philosophique
Le climax de la saison – le détournement de l’astéroïde vers Mars – peut se lire comme une rébellion philosophique contre la réduction économique de l’espace. En privant la Terre de ses ressources astéroïdales, Aleida Rosales et l’équipe martienne affirment une autre conception de l’espace : territoire d’autonomie plutôt que gisement d’exploitation.
Cette rébellion illustre l’émergence d’une troisième voie anthropologique : ni Homo spatialis héroïque ni Homo economicus cosmique, mais Homo martialis autonome, développant sa propre relation au cosmos.
La coopération résiduelle : l’ISS comme exception
Happy Valley : laboratoire de coopération post-nationale
La base martienne internationale de Happy Valley illustre la coopération résiduelle spatiale. Malgré les tensions terrestres, les communautés spatiales développent leurs propres logiques coopératives, imposées par l’hostilité cosmique commune.
Cette coopération spatiale transcende progressivement les appartenances terrestres, préfigurant l’émergence d’une identité spatiale autonome. Les « Martiens » de Happy Valley développent des solidarités qui échappent aux logiques géopolitiques terrestres.
Cependant, la série montre aussi la fragilité de cette exception coopérative. Les conflits sociaux (ouvriers contre cadres), les tensions géopolitiques (espionnage de Margo), les logiques économiques (exploitation d’Helios) menacent constamment cette coopération résiduelle.
Cette évolution accompagne une forme de pessimisme : même la coopération spatiale n’échappe pas totalement à la banalisation terrestre. L’espace transcendant devient progressivement espace ordinaire, soumis aux mêmes tensions que la Terre.
Le rapport civilisationnel à l’espace : territorialisation croissante
De l’espace commun à l’espace approprié
L’évolution narrative de For All Mankind le passage de l’espace « bien commun » à l’espace « ressource économique. » Chaque saison accentue la territorialisation spatiale : bases nationales, concessions minières, propriétés privées, souverainetés autonomes.
Cette évolution répond à une question centrale : l’espace est-il territorialisé ou reste-t-il commun ? La série suggère une territorialisation progressive et inexorable, malgré les idéaux initiaux de partage cosmique.
Les droits d’accès et d’usage : vers l’inégalité cosmique
La série développe subtilement la question des « droits d’accès et d’usage » spatiaux. Progressivement, l’espace devient un domaine de privilèges : élites astronautes, touristes fortunés, ouvriers précaires. Cette stratification spatiale reproduit et amplifie les inégalités terrestres.
Cette évolution illustre l’échec de l’utopie spatiale égalitaire. L’espace, qui devait révéler l’humanité commune, devient un nouveau terrain d’inégalités et d’exclusions.
L’Homo cosmicus : synthèse dialectique ?
La série suggère cependant l’émergence possible d’une synthèse dialectique : l’Homo cosmicus, qui intégrerait l’héritage de l’Homo spatialis (esprit d’exploration, coopération transcendante) et les réalités de l’Homo economicus (efficacité technique, organisation industrielle) dans une nouvelle forme d’humanité adaptée au cosmos.
Cette synthèse, encore fragile et incertaine dans la série, pourrait représenter l’enjeu philosophique central de notre expansion spatiale : préserver l’esprit de découverte et la grandeur humaine tout en maîtrisant l’industrialisation cosmique nécessaire.
L’uchronie rejoint une dernière fois la réflexion anthropologique : For All Mankind explore à sa manière la mutation civilisationnelle en cours de notre rapport au cosmos.
SYNTHÈSE CONCLUSIVE : FOR ALL MANKIND, PROPHÉTIE ACCOMPLIE DE L’ÈRE SPATIALE CONTEMPORAINE
Les joies de l’Uchronie
Cinq ans après la diffusion de sa première saison, For All Mankind révèle aujourd’hui sa finesse la plus saisissante : cette fiction uchronique, qui prétendait réécrire l’histoire spatiale passée, accompagne en réalité l’évolution spatiale contemporaine que Xavier Pasco analyse aujourd’hui. L’uchronie se fait prospective, la fiction alternative en chronique du présent.
Cette convergence n’est pas fortuite. Elle révèle que Ronald D. Moore et son équipe ont intuitivement saisi les dynamiques profondes de l’expansion spatiale humaine, par-delà les contingences historiques particulières. En accélérant de cinq décennies l’industrialisation spatiale, For All Mankind nous a offert un laboratoire temporel unique : observer en temps réel les mutations que nous vivons aujourd’hui en accéléré.
Plus encore, cette série constitue désormais le complément narratif indispensable aux analyses géopolitiques. Là où le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique décortique avec rigueur scientifique les mécanismes de la révolution spatiale contemporaine, For All Mankind nous en offre la traduction dramatique et humaine. L’analyse géopolitique et la fiction prospective se révèlent complémentaires pour comprendre l’enjeu civilisationnel de notre expansion cosmique.
L’apport de la fiction à l’analyse géopolitique
La dimension humaine de la géopolitique
Là où l’analyse géopolitique excelle dans la compréhension des mécanismes systémiques, la fiction révèle leur traduction humaine concrète. Les nouveaux acteurs, l’hybridation public-privé, la militarisation silencieuse – prennent chair dans les personnages de Dev Ayesa, Margo Madison, ou Miles l’ouvrier spatial.
Cette incarnation dramatique n’est pas qu’un artifice narratif : elle révèle les enjeux existentiels cachés derrière les évolutions géopolitiques. For All Mankind nous montre ce que cela signifie concrètement pour les individus, les familles, les communautés humaines.
Le laboratoire temporel accéléré
Plus encore, la structure narrative décennale de la série offre un avantage unique à l’analyse prospective : observer les conséquences à long terme des choix contemporains. En compressant cinquante ans d’évolution spatiale en quatre saisons, la série révèle les dynamiques historiques invisibles à l’échelle humaine ordinaire.
Cette capacité d’anticipation temporelle complète parfaitement l’analyse géopolitique, souvent contrainte par l’urgence de l’actualité. For All Mankind nous montre où mènent, sur plusieurs décennies, les tendances identifiées aujourd’hui.
L’imagination prospective disciplinée
Contrairement à la science-fiction spéculative, For All Mankind développe une imagination prospective disciplinée : ses extrapolations restent rigoureusement ancrées dans les contraintes techniques, économiques et géopolitiques réelles. Cette discipline narrative produit des anticipations plus fiables que l’extrapolation purement théorique.
Et si nous faisions à notre tour de la prospective pour la Saison 5 ?
L’économie spatiale post-terrestre
Le flash-forward final vers la station minière Kuznetsov (2012) ouvre des perspectives fascinantes pour la saison 5. Cette vision d’une économie spatiale autonome, déconnectée des logiques terrestres, pose des questions inédites : comment Mars finance-t-elle son indépendance économique ? Comment l’exploitation astéroïdale transforme-t-elle les équilibres géopolitiques terrestres ?
Ces questions anticipent exactement les préoccupations contemporaines sur l’autonomie stratégique spatiale et la course aux ressources cosmiques. La saison 5 pourrait explorer comment l’économie spatiale mature bouleverse les hiérarchies géopolitiques terrestres.
La génération spatiale native
Plus fascinant encore, la saison 5 introduira vraisemblablement une génération née et éduquée dans l’espace – Martiens natifs, ouvriers astéroïdaux de seconde génération. Cette génération spatiale native poserait des questions anthropologiques inédites : quelle identité développent les humains qui n’ont jamais connu la Terre ? Quelle loyauté politique ? Quels rapports aux logiques terrestres ? Nous nous rapprochons ici des pistes de The Expanse.
Cette évolution anticipera les défis futurs que nous pouvons pressentir : comment gouverner des communautés spatiales qui développent leurs propres intérêts, parfois divergents des métropoles terrestres ?
L’expansion vers les lunes de Jupiter ?
Le flash-forward pourrait aussi annoncer l’expansion vers les lunes de Jupiter (Europa, Ganymède), ouvrant de nouveaux horizons d’exploration mais aussi de nouveaux défis géopolitiques. Comment réguler l’expansion dans le système solaire externe ? Quelles nouvelles formes de coopération/compétition internationale ?
Vers la saison 5 : retrouver nos héros dans l’espace balisé
L’héritage des pionniers
La saison 5 nous retrouvera vraisemblablement face à l’héritage complexe des choix des saisons précédentes. Comment les enfants d’Ed Baldwin, les héritiers de Dev Ayesa, les disciples de Margo Madison gèrent-ils l’espace industrialisé qu’ils ont hérité ? Cette question générationnelle enrichira la réflexion sur la transmission des idéaux spatiaux.
Les nouveaux héros de l’espace Ordinaire
Plus encore, la saison 5 devra inventer de nouveaux types d’héroïsme adaptés à l’espace balisé. Dans un cosmos industrialisé et routinier, comment redécouvrir l’épique et le transcendant ?
Conclusion : l’espace commun perdu et retrouvé
For All Mankind et l’analyse géopolitique de Xavier Pasco convergent vers le même diagnostic : nous vivons une révolution spatiale comparable à la révolution industrielle terrestre, avec ses promesses d’expansion et ses risques de dégradation. L’espace, dernier domaine « commun » de l’humanité, devient progressivement un territoire d’appropriation, de compétition et d’exploitation.
Cette mutation n’est ni nécessairement positive ni nécessairement négative : elle est historiquement inévitable. Comme la révolution industrielle terrestre, elle ouvre des possibilités inédites d’expansion humaine tout en créant des risques civilisationnels nouveaux.
La série révèle cependant que cette transformation peut préserver l’essentiel : l’esprit d’exploration, la coopération internationale, la transcendance de nos limitations terrestres. Mais cela exige une vigilance constante, une intelligence politique raffinée, une éthique spatiale encore à inventer.
En cela, cette série accomplit sa mission la plus noble : non pas seulement divertir, mais éclairer les enjeux contemporains de notre expansion cosmique. En nous montrant les futurs possibles, elle nous aide à choisir le futur désirable.
L’uchronie spatiale devient ainsi prospective citoyenne. Et nous retrouverons nos héros en saison 5 avec cette question en suspens : quelle humanité voulons-nous devenir dans l’espace que nous sommes en train de conquérir ?
L’infini cosmique reste ouvert. À nous de le mériter.
L’analyse de For All Mankind révèle ainsi que cette série constitue bien plus qu’un divertissement spatial : elle représente le laboratoire narratif le plus sophistiqué de notre époque pour comprendre les enjeux géopolitiques de l’expansion spatiale contemporaine. Fiction prospective et analyse géopolitique se révèlent complémentaires pour penser l’avenir spatial de l’humanité.
La série explore de nombreuses autres pistes pour qui chercherait plus que des questionnements géopolitiques.
La révolution féministe spatiale constitue l’un des fils rouges les plus puissants de la série. L’arrivée forcée des femmes dans le programme spatial américain en réaction aux cosmonautes soviétiques révèle les mécanismes complexes de l’émancipation féminine dans un environnement ultra-masculinisé. La série illustre magistralement comment ces femmes – astronautes, personnel au sol, et épouses/mères prennent toute leur place dans cette quête. Naviguant entre ambitions professionnelles et attentes sociales, elles sont essentielles. L’évolution de personnages comme Ellen Wilson – astronaute homosexuelle devenue présidente – ou Karen Baldwin – de femme au foyer traditionnelle à entrepreneure spatiale – révèle les transformations anthropologiques profondes qu’impulse l’expansion cosmique.
Les sacrifices familiaux traversent toute la narrative avec une intensité dramatique saisissante. Les couples d’astronautes – Ed et Karen Baldwin, Tracy et Gordo Stevens – incarnent les tensions impossibles entre carrière spatiale et vie familiale. La série explore avec une justesse psychologique remarquable le stress quasi-constant des familles d’astronautes, la solitude des conjoints, le poids des absences prolongées, le deuil, l’effondrement des couples, leurs tentatives de reconstruction.
Les relations amoureuses complexifient encore cette fresque, de l’amour secret d’Ellen Wilson et Pam Horton – contraintes au silence par l’homophobie institutionnelle – aux liaisons interdites comme l’affaire controversée entre Karen Baldwin et Danny Stevens.
L’héroïsme initial des pionniers – Ed Baldwin, Molly Cobb – cède progressivement place à des motivations plus complexes, mêlant idéal national et ambitions personnelles.
L’expansion cosmique transforme nos rapports de genre, nos structures familiales, nos codes amoureux, nos identités nationales. La géopolitique spatiale devient ainsi anthropologie spatiale, révélant que conquérir l’espace, c’est aussi se conquérir soi-même – avec tous les drames et grandeurs que cela implique.
***
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE : FOR ALL MANKIND EN TERMINALE HGGSP
Cadrage
Thème 1 : De nouveaux espaces de conquête
Axe 1 : Conquêtes et colonisation
Axe 2 : De la conquête de l’espace aux enjeux actuels
Capacités travaillées :
Analyser les enjeux géopolitiques contemporains
Confronter fiction et réalité géopolitique
Développer l’esprit critique face aux représentations médiatiques
Maîtriser l’argumentation historique et géopolitique
Problématique Générale
Comment la série ‘For All Mankind’ éclaire-t-elle les enjeux géopolitiques spatiaux contemporains ?
Séquence pédagogique : fiction et prospective géopolitique (4-5 heures)
Alors oui c’est beaucoup, 4 à 5 heures. Je me mets dans la perspective des allègements de programme parus ces dernières semaines. Libre à chacun de puiser ici une ou plusieurs idées pour alléger le projet.
Concernant les droits il importe de se contenter d’extraits. Il n’est pas question ici de montrer la série en entier. Il faudra donc se munir légalement de la série et sélectionner les extraits les plus efficaces. Doit-on inciter les élèves à regarder la série ? Il n’est point question de ceci. Il faut ouvrir le champ culturel, élargir les horizons. Libre à chacun ensuite de regarder ou pas la série, en fonction de ses possibilités et envies.
Séance 1 : « L’Espace dans la Guerre Froide » (1h)
Support : Extraits saison 1 + interview de Xavier Pasco ou lecture en amont de ses écrits (les deux ne sont pas incompatibles) sur l’ère géopolitique spatiale.
Activité : tableau comparatif réalité/fiction
- Comparer la vraie course à l’espace (1957-1975) avec l’uchronie de la série
- Analyser les « motivations spatiales » selon Pasco : prestige, vitrines technologiques
Trace écrite : Les logiques géopolitiques de la conquête spatiale
Séance 2 : « Nouveaux Acteurs, Nouveaux Enjeux » (1h30)
Support : Extraits saisons 3-4 + analyses de Xavier Pasco sur SpaceX/nouveaux acteurs
Activité : Étude de cas croisée Dev Ayesa/Elon Musk
- Identifier les convergences fiction/réalité
- Analyser l’hybridation public-privé spatiale
- Débat : « La privatisation spatiale : progrès ou danger ? »
Production : Fiche personnage comparée Dev Ayesa/Elon Musk
Séance 3 : « Militarisation et Régulation Spatiales » (1h)
Support : Extraits confrontation lunaire S2 + analyses sur militarisation
Activité : Simulation diplomatique
- Les élèves incarnent différents acteurs (USA, URSS, entreprises privées)
- Négociation d’un « traité spatial » pour réguler l’exploitation lunaire
- Confrontation avec les analyses de Pasco sur le « Far West contrôlé »
Synthèse : Les défis de la gouvernance spatiale contemporaine
Séance 4 : « Enjeux Environnementaux et Durabilité » (1h)
Support : Extraits industrialisation Mars S4 + dossier sur la pollution spatiale
Activité : Diagnostic prospectif
- Identifier les risques environnementaux spatiaux dans la série
- Confronter avec les analyses Xavier Pasco (syndrome Kessler, débris)
- Concevoir des solutions de « développement spatial durable »
Séance 5 : rédaction d’un article diffusé pourquoi pas au sein de l’établissement ou création d’une émission de web radio interne.
Sujet : « L’espace, ‘nouveau Far West’ ou laboratoire de coopération internationale ? Vous appuierez votre réflexion sur l’analyse de Xavier Pasco et les représentations de la série ‘For All Mankind’. »
Dossier Documentaire Élève
Document 1 : extraits interview Xavier Pasco France 24 (2024) + articles et extraits de ses livres
Document 2 : synopsis « For All Mankind » + chronologie narrative
Document 3 : infographie « La militarisation de l’espace, illustration de l’ambition des grandes puissances » tiré des publication de la FMES
Document 4 : carte géopolitique spatiale actuelle (nombre de satellites par pays)
Document 5 : extraits « Le nouvel âge spatial » « Géopolitique de l’espace » (Xavier Pasco)
Prolongements Possibles
Interdisciplinarité :
- SES : Économie spatiale, nouveaux modèles économiques
- Physique : Contraintes techniques de l’exploration spatiale
- Philosophie : Éthique de l’expansion spatiale, transhumanisme
Projet d’établissement :
- Création d’un « club géopolitique » analysant séries et actualité, par exemple au sein d’une webradio (je l’ai expérimenté, ça fonctionne très bien)
- Partenariat avec planétarium/cité de l’espace
- Conférence avec spécialiste géopolitique spatiale
Orientation :
- Découverte métiers : géopolitique, recherche stratégique, industrie spatiale
- Préparation Sciences Po : analyse prospective et géopolitique
Cet article touche à sa fin. J’espère que cette approche transforme For All Mankind d’objet de consommation culturelle en outil d’analyse géopolitique, révélant aux élèves et citoyens en général que la fiction peut être un laboratoire de compréhension du monde contemporain. Afin de pousser le plaisir un peu plus loin, de le prolonger, dans quelques temps je proposerai une exploration d’un film fortement lié à cette oeuvre : « L’étoffe des Héros ».
L’objectif ultime : former des citoyens capables de décrypter les enjeux géopolitiques cachés derrière les représentations culturelles qu’ils consomment quotidiennement !