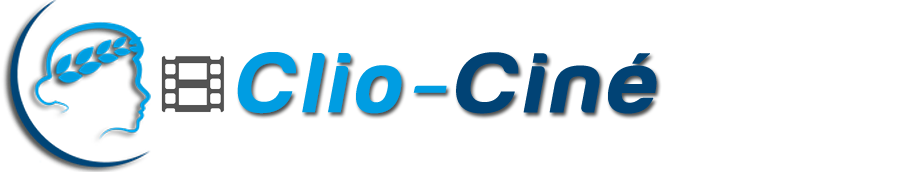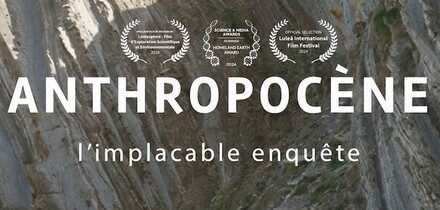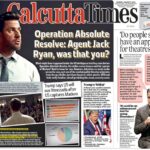Si 75 % de la population mondiale vit aujourd’hui sur le littoral, le fait d’habiter réellement sur l’eau reste minoritaire à l’image des maisons sur pilotis qui existent pour des raisons culturelles ou défensives (Venise).
Pendant longtemps, la mer a représenté une menace mais aujourd’hui, nous sommes plus ouverts à l’idée de vivre sur l’eau. Jules Verne a joué un rôle majeur puis Jacques-Yves Cousteau.
Avec le contexte de montée des eaux lié au réchauffement climatique, la question de pose de manière plus concrète.
Au début du XXème siècle, Richard Buckminster Fuller avait suggéré des projets architecturaux de vie sur l’eau avec un fonctionnement par l’énergie nucléaire mais aussi marémotrice, éolienne et solaire, « Triton city », mais l’idée n’était pas réalisable au niveau matériel.
Aujourd’hui, il y a un retour de cette idée de ville flottante. La « Révolution bleue » est un mouvement qui prend ça au sérieux, les technologies ayant évolué. Les villes sont trop statiques, l’usage de l’eau les rendrait plus flexibles et mobiles.
Ce pourrait être une prochaine « révolution » après l’électricité, les transports et la construction en hauteur : les logements peuvent être construits ailleurs qu’in situ et il serait possible de les placer après. La ville pourrait être saisonnière : l’écartement en été pour laisser sa place à la compacité en hiver pour garder la chaleur.
Une piste est également l’usage des conteneurs, empilables sur un ponton flottant car ils sont relativement légers.
Les Pays-Bas et le Danemark sont pionniers en la matière mais aux Maldives, il y a urgence. Dans la capitale, Malé, il n’y a plus de place du tout. La population est tout à fait ouverte à cette idée. La configuration en lagon est particulière, il faut veiller aux « longues vagues ». Ces futures îles flottantes devront être ancrées dans le fond marin.
La question des tsunamis se pose de manière aiguë. En haute mer, pourrait-on bâtir également ? Il faudra surélever pour faire face aux vagues (20 mètres au-dessus du niveau de la mer). Un assemblage en triangles semble optimal.
En Corée du Sud, il y a déjà une structure flottante opérationnelle, la plus grande de la planète. Trois iles sont connectées et ancrées au fond du fleuve. Les coordonnées GPS sont recalculées pour corriger les mouvements qui les feraient trop dériver.
Qu’en est-il de la pollution du monde sous-marin ? Des déchets ? Des fermes d’algues pourraient absorber le CO² et permettraient de produire des biocarburants.
Des panneaux de simili bois faits à partir d’algues et de déchets agricoles pourraient devenir des matériaux de construction, le « sea wood ». Les algues n’ont pas besoin d’eau douce et elles se développent vite.
De manière plus large, des fermes flottantes seraient une piste pour réduire les importations.
En Italie, on chercher à faire une serre sous-marine, cultiver des plantes sous l’eau via des dômes qui, via la condensation, génère une « pluie d’eau douce » nécessaire à la croissance. Il n’y a pas besoin de terre.
Le dessalement de l’eau de mer à grande échelle est un grand défi d’avenir. De manière mécanique, cela semble possible. La saumure est rejetée loin des côtes et remélangée facilement.
La ville de Busan en Corée du Sud pourrait être précurseur de ce cumul des pistes précitées.
Il demeure le problème du coût, de l’acceptation large des habitants et des souhaits de riches libertaires de s’affranchir des lois et de se construire sa propre nation sur l’eau…dans les eaux internationales mais celles-ci sont très agitées d’où la recherche de la part des « sea steaders » de relations de proximités avec des eaux calmes. Le reportage se termine sur le cas de la Polynésie où la population locale n’y a pas vu son intérêt (préservation de la pêche locale) face à des milliardaires investisseurs américains vus comme des intrus colonialistes.